À LA UNE
Le spectacle proposé à Villedieu le 2 décembre dernier, dans le cadre du Festival après les vendanges, était un one man show intitulé « L'Éloge de la pifométrie ».
Luc Chareyron a remporté un franc succès dans sa peau de conférencier diplômé de L'École nationale supérieure d'ingénieurs en pifométrie (E.N.S.I.P). Une sorte de professeur Nimbus qui, sous ses airs de chercheur brouillon, décortique notre quotidien avec une lucidité qui n'a rien d'approximatif. Le canular est d'autant plus efficace qu'il s'agit d'une mise en boîte de la science par ses moyens mêmes, un appel à la résistance contre tout expert. Cet ingénieur divulgue son savoir avec une passion sans borne, et si les calembours et les jeux de mots sont nombreux, on évite véritablement l'écueil de la caricature grossière. Hilarant, intelligent et fort à propos, ce spectacle est une belle réussite, alliant forme originale et vrai fond.
L'affluence a été telle (environ 180 personnes) que les organisateurs ont eu du mal à « caser » dans la salle des fêtes le public qui n'avait pas réservé. La Gazette, qui présentait ce spectacle en collaboration avec Les ateliers du regard, n'a eu que des « éloges » de la part des spectateurs qu'elle a côtoyés après la représentation.
Cette réussite a motivé les bénévoles de La Gazette qui souhaitent continuer à proposer et à soutenir ce festival à l'avenir.
Rendez-vous donc l'année prochaine, fin novembre ou début décembre, pour un nouveau spectacle de qualité.
Le site internet de Luc Chareyron :
www.pifometrie.net
Luc Chareyron a remporté un franc succès dans sa peau de conférencier diplômé de L'École nationale supérieure d'ingénieurs en pifométrie (E.N.S.I.P). Une sorte de professeur Nimbus qui, sous ses airs de chercheur brouillon, décortique notre quotidien avec une lucidité qui n'a rien d'approximatif. Le canular est d'autant plus efficace qu'il s'agit d'une mise en boîte de la science par ses moyens mêmes, un appel à la résistance contre tout expert. Cet ingénieur divulgue son savoir avec une passion sans borne, et si les calembours et les jeux de mots sont nombreux, on évite véritablement l'écueil de la caricature grossière. Hilarant, intelligent et fort à propos, ce spectacle est une belle réussite, alliant forme originale et vrai fond.
L'affluence a été telle (environ 180 personnes) que les organisateurs ont eu du mal à « caser » dans la salle des fêtes le public qui n'avait pas réservé. La Gazette, qui présentait ce spectacle en collaboration avec Les ateliers du regard, n'a eu que des « éloges » de la part des spectateurs qu'elle a côtoyés après la représentation.
Cette réussite a motivé les bénévoles de La Gazette qui souhaitent continuer à proposer et à soutenir ce festival à l'avenir.
Rendez-vous donc l'année prochaine, fin novembre ou début décembre, pour un nouveau spectacle de qualité.
Le site internet de Luc Chareyron :
www.pifometrie.net

Luc Chareyron, ingénieur pifomètre
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Il est 14 heures, ce lundi 28 novembre 2011. Les enfants du cycle 3 de l'école de Villedieu, accompagnés de leur institutrice Christine Hecquet, sont arrivés les premiers, suivis de ceux de Cairanne et Roaix, venus en autocar avec leurs maîtres.
Les enfants sont assis, sages. Une table est installée avec des gants blancs, des ballerines noires, une glace, du maquillage. Mais pas de mime. Où est-il ? Un monsieur s'approche de la table et, tout en regardant de tous les côtés pour ne pas être surpris, commence à regarder les objets. Puis, il enlève ses chaussures et met les ballerines, il enlève sa veste et en met une autre, il quitte son pantalon et se retrouve en collant, il s'assied à la table et se maquille. Le mime vient de naître sous les yeux des enfants attentifs et silencieux.
Après quelques numéros en solo, il choisit des écoliers dans le public et les invite à le rejoindre, les uns après les autres, pour une initiation à la technique du mime, ce qui donne lieu à des moments de franche rigolade. Ce sont les plus maladroits qui font rire, bien sûr, mais sans moquerie.
Au bout d'une heure environ, tout le monde est invité à se mettre debout et à essayer d'imiter le mime. La coordination n'est pas forcément au rendez-vous et le spectacle se termine dans un grand éclat de rire.
Les enfants ont passé un très bon moment et les adultes qui les accompagnaient aussi. Bravo à Patrick Loriot, notre mime d'un après-midi.
Les enfants sont assis, sages. Une table est installée avec des gants blancs, des ballerines noires, une glace, du maquillage. Mais pas de mime. Où est-il ? Un monsieur s'approche de la table et, tout en regardant de tous les côtés pour ne pas être surpris, commence à regarder les objets. Puis, il enlève ses chaussures et met les ballerines, il enlève sa veste et en met une autre, il quitte son pantalon et se retrouve en collant, il s'assied à la table et se maquille. Le mime vient de naître sous les yeux des enfants attentifs et silencieux.
Après quelques numéros en solo, il choisit des écoliers dans le public et les invite à le rejoindre, les uns après les autres, pour une initiation à la technique du mime, ce qui donne lieu à des moments de franche rigolade. Ce sont les plus maladroits qui font rire, bien sûr, mais sans moquerie.
Au bout d'une heure environ, tout le monde est invité à se mettre debout et à essayer d'imiter le mime. La coordination n'est pas forcément au rendez-vous et le spectacle se termine dans un grand éclat de rire.
Les enfants ont passé un très bon moment et les adultes qui les accompagnaient aussi. Bravo à Patrick Loriot, notre mime d'un après-midi.

Patrick Loriot et un mime apprenti
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
ÉPHÉMÉRIDE
Version 1
Saint-Marcellin est une commune d'Isère d'environ 8 000 habitants, entre Valence et Grenoble, connue surtout pour son fromage.
Nous partons de Villedieu avec un bel autocar du « Petit Nice » à 7 heures 50. Vers 10 heures, nous arrivons à Chatte et visitons un jardin ferroviaire. Les trains miniatures n'intéressent pas que les petits, les aînés eux aussi apprécient le travail et le goût nécessaires à la réalisation d'un tel circuit.
Puis nous partons pour la visite des « Ravioles du Dauphin » où un film nous montre la fabrication des ravioles et c'est l'occasion d'en acheter pour certains.
Il est l'heure maintenant de se diriger vers le restaurant « Le Saint-Marcell'inn » où un bon repas à base de produits du terroir nous attend.
Nous nous acheminons ensuite vers l'Abbaye de Saint-Antoine, puis nous visitons une chocolaterie artisanale. Le chocolatier nous explique la fabrication à partir du cacao et nous invite à une dégustation bien fournie. Des gourmands achètent des chocolats malgré le peu de choix, car la chocolaterie est en cours de déménagement.
La suite de notre tournée devait nous conduire à une fromagerie, bien sûr. Le chauffeur téléphone pour annoncer notre arrivée et on lui répond que la fromagerie ferme à 17 heures. Il est 16 heures 50 et malgré son insistance, nous ne pourrons pas effectuer cette visite sur laquelle plusieurs d'entre nous comptaient pour déguster et acheter du Saint-Marcellin authentique.
Nous repartons donc, désabusés, vers Villedieu et le chauffeur, voyant notre déception, nous arrête à un magasin où certains se consolent en achetant fromages et pognes.
Nous arrivons à Villedieu vers 19 heures 45 et malgré cette déception finale, nous avons passé une bonne journée.
Raymonde Tardieu
Version 2
Le 13 octobre 2011 pour la dernière sortie de l'année une trentaine de membres est partie vers le village de Chatte en Isère. Après un trajet de deux heures, nous sommes arrivés à destination. Il faisait beau, mais frais.
Nous nous sommes arrêtés au jardin ferroviaire, créé en 1987 par Christian Abric. Il est devenu aujourd'hui l'un des plus beaux jardins miniatures animés d'Europe. Au fil du temps, après des milliers d'heures de travail, de construction, de jardinage et de réglages, c'est un formidable monde miniaturisé qu'il offre au public. Nous avons vu environ 30 trains de jardin, 200 wagons à l'échelle 1,22/5e, se croisent, traversant, surplombant et contournant villes, rivières, routes, lacs et montagnes. Le jardin naturel à l'échelle des trains était composé par des arbustes et conifères vieillis et réduits selon diverses méthodes japonaises (Bonzaïs). On a vu aussi des reproductions du patrimoine du Dauphiné comme le « Palais idéal du facteur Cheval », l'abbaye de Saint-Antoine et les maisons suspendues de Pont-en-Royans.
Après une petite pause café, nous sommes repartis vers Saint-Marcellin et une initiation aux secrets de la fabrication des « Ravioles du Dauphin ».
C'est l'histoire de deux frères, Patrice et Gilles Rambert. Il y a une vingtaine d'années, parti de rien, le plus grand s'est lancé dans la fabrication artisanale de la raviole, selon la recette de sa grand-mère « ravioleuse ». Le plus jeune l'a ensuite rejoint pour « faire la tournée » sur le plateau du Vercors. Leur entreprise compte aujourd'hui une dizaine de personnes, sur deux sites. 120 tonnes de « Ravioles du Dauphin » sortent chaque année de leur atelier de production. Le tour de main s'est transmis de génération en génération. Les ingrédients sont triés sur le volet, fabriqués par des producteurs sélectionnés. Par exemple, le Comté A.O.C. du Jura a 5 mois d'affinage. 45 meules sont livrées tous les 15 jours. Autre exemple, les 350 kg hebdomadaires de fromage blanc de Saint-Marcellin sont fabriqués avec le lait des vaches du Vercors.
Nous avons regardé un film de présentation de l'entreprise et sommes partis avec les sacs pleins de ravioles et en plus avec le demi-Saint-Marcellin, bardé d'une tranche de poitrine fumée, enrobé dans un carré de pâte feuilletée. Cette visite nous a vraiment ouvert l’appétit !
Heureusement le restaurant « Le Saint Marcell'inn » n'était pas trop loin. On a commencé avec un apéro au vin blanc et à la crème de framboise, suivi par une délicieuse salade « Saint-Marcellinoise ». La noix de veau était très bien garnie avec une sauce forestière et des ravioles du Dauphiné. On a fini avec un Saint-Marcellin affiné, une tarte maison et bien sur le petit café. Tout ça bien arrosé par les vins de la région.
L'après-midi a commencé par une visite à l’abbaye de Saint-Antoine au village du même nom. Les bâtiments nombreux et bien restaurés de l'abbaye dominent le village médiéval avec ses petites ruelles et maisons anciennes du XIVe et XVe siècle. L'abbaye de Saint-Antoine a été fondée pour accueillir les reliques de « Saint Antoine l'Égyptien ». Sa façade est de style gothique flamboyant. La construction de l'église abbatiale commence en 1130 et se termine à la fin du XVe siècle, avec une interruption de 50 ans entre1289 et1337. Un incendie a détruit le clocher et les toitures en 1422. En 1777, le monastère et ses biens sont transférés à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de l’ordre de Malte. L'abbaye se situe sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui fait que l'église accueille beaucoup de pèlerins, mais elle accueille également les malades venant toucher les reliques de Saint-Antoine pour que celles-ci les guérissent. Ces reliques ont été rapportées d'Orient.
Notre visite s'achève à la « Chocolaterie Pupin » à Chatte. Monsieur Pupin, artisan chocolatier, nous a tout dit sur sa passion et nous a fait découvrir son savoir-faire avec la dégustation de quelques-uns de ses produits.
On a repris l’autocar pour rentrer au village vers 20 heures. Merci à tous pour une journée très intéressante et bien organisée.
Roman Tomczak


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
L'association Amicello a donné un concert de fin de stage mardi 1er novembre en l'église de Villedieu.
Amicello est une association de plus de vingt violoncellistes adultes, amateurs, qui s'est constituée sous la direction de Sophie Hautier. Professeure au conservatoire de Carpentras, Sophie Hauthier est également musicienne à L'Orchestre des Cévennes qui accompagne très régulièrement les concerts du Chœur européen de Vaison-la-Romaine.
Ces violoncellistes se réunissent régulièrement à Morières les Avignon (siège social de l'association) pour des séances de travail. « Son stage annuel s'est déroulé cette année dans ce bel endroit qu'est La Magnanarié où nous avons été reçus très chaleureusement par Armelle et François Dénéréaz. », explique Sophie Hauthier. Le programme d'une quarantaine de minutes a invité les compositeurs suivants : Beethoven, Piazzolla, Goltermann, Gabrielli, Purcell et d'autres encore. Un bon moment musical qui a apporté un rayon de soleil dans cette journée pluvieuse de novembre en attendant les prochaines occasions de se divertir à Villedieu.
Amicello est une association de plus de vingt violoncellistes adultes, amateurs, qui s'est constituée sous la direction de Sophie Hautier. Professeure au conservatoire de Carpentras, Sophie Hauthier est également musicienne à L'Orchestre des Cévennes qui accompagne très régulièrement les concerts du Chœur européen de Vaison-la-Romaine.
Ces violoncellistes se réunissent régulièrement à Morières les Avignon (siège social de l'association) pour des séances de travail. « Son stage annuel s'est déroulé cette année dans ce bel endroit qu'est La Magnanarié où nous avons été reçus très chaleureusement par Armelle et François Dénéréaz. », explique Sophie Hauthier. Le programme d'une quarantaine de minutes a invité les compositeurs suivants : Beethoven, Piazzolla, Goltermann, Gabrielli, Purcell et d'autres encore. Un bon moment musical qui a apporté un rayon de soleil dans cette journée pluvieuse de novembre en attendant les prochaines occasions de se divertir à Villedieu.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
L’automne est arrivé... Le festival des soupes bat son plein. Il a eu lieu le lundi 31 octobre dans notre village sous l’œil attentif des caméras de TF1.
Les louchiers ont goûté et noté 14 marmites, le choix fut difficile. C’est la soupe d’Aurélie Monteil qui a reçu le coup de cœur du jury : le savant mélange d’une courge avec des patates douces, des châtaignes et des cèpes.
Après la proclamation des résultats, chaque participant a reçu une bouteille de Côtes du Rhône « Les Hauts de la Baude » et la troisième édition du livre de recettes du festival des soupes.
Deux cent soixante-treize assiettes de « fuselini à la bolognaise », suivies d’une portion de camembert et d’un éclair au chocolat, furent servies avec dextérité et bonne humeur par des bénévoles et des membres du Comité des fêtes.
Les Tambourinaïres firent chanter l’hymne de la Vénérable Confrérie des Louchiers Voconces : « Étoile des neiges », et bien sûr la « Coupo Santo » en provençal.
Une belle soirée conviviale partagée avec les Villadéens, de nombreux fidèles à cette tradition et quelques touristes de passage qui ont su apprécier.
Les quatorze soupes proposées ont été concoctées par : Annie Blanc, Ludivine Blanc, Agnès Brunet, Gabriel Charrasse (dit Bibi), Colette Auric, Armelle Dénéréaz, Delphine et Rebecca Dénéréaz, Annette Gros-Le Tacon, Aurélie Monteil, Majo Raffin, Yvan Raffin, Raymonde Tardieu, Diane Tomczak et La Ramade représentée par Nicole Finalteri, Bertille Léonet, Valérie Ollier et Gisèle Thion assistées de leur éducatrice Marie-Danielle Andrieux.
Les louchiers ont goûté et noté 14 marmites, le choix fut difficile. C’est la soupe d’Aurélie Monteil qui a reçu le coup de cœur du jury : le savant mélange d’une courge avec des patates douces, des châtaignes et des cèpes.
Après la proclamation des résultats, chaque participant a reçu une bouteille de Côtes du Rhône « Les Hauts de la Baude » et la troisième édition du livre de recettes du festival des soupes.
Deux cent soixante-treize assiettes de « fuselini à la bolognaise », suivies d’une portion de camembert et d’un éclair au chocolat, furent servies avec dextérité et bonne humeur par des bénévoles et des membres du Comité des fêtes.
Les Tambourinaïres firent chanter l’hymne de la Vénérable Confrérie des Louchiers Voconces : « Étoile des neiges », et bien sûr la « Coupo Santo » en provençal.
Une belle soirée conviviale partagée avec les Villadéens, de nombreux fidèles à cette tradition et quelques touristes de passage qui ont su apprécier.
Les quatorze soupes proposées ont été concoctées par : Annie Blanc, Ludivine Blanc, Agnès Brunet, Gabriel Charrasse (dit Bibi), Colette Auric, Armelle Dénéréaz, Delphine et Rebecca Dénéréaz, Annette Gros-Le Tacon, Aurélie Monteil, Majo Raffin, Yvan Raffin, Raymonde Tardieu, Diane Tomczak et La Ramade représentée par Nicole Finalteri, Bertille Léonet, Valérie Ollier et Gisèle Thion assistées de leur éducatrice Marie-Danielle Andrieux.

La gagnante, Aurélie Monteil

Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Le festival des soupes en quelques chiffres.
En 2011, le festival a 21 ans.
– 177 soupes présentées par les 16 villages du Pays Ventoux, contre 163 soupes en 2010.
– 770 litres de soupes, veloutés et autres potages servis au public.
– 1 mois de dégustation et de soirées conviviales animées par quatre tambourinaires.
– 280 membres ont composé le jury.
– 3 500 visiteurs se sont déplacés.
– 20 Grands Louchiers de La Confrérie des Louchiers Voconces, parmi lesquels se trouve une Villadéenne de 7 ans : Ludivine Blanc.
Cette année, 2 chaines de télévision se sont intéressées au festival.
– TF1, pour le journal de 13 heures avec Jean-Pierre Pernaut. Là encore, une Villadéenne s'est prêtée au jeu : Armelle Dénéréaz.
– France 3 Méditerranée, pour l'émission « 13 heures avec vous ».
Il était également prévu une émission pour Le 19.45 sur M6, mais le reportage a été annulé au dernier moment en raison du mauvais temps.
La grande finale a eu lieu le samedi 19 novembre à 19 heures à l'espace culturel de Vaison-la-Romaine.
Les 16 communes du Pays Vaison-Ventoux ont présenté sur un stand leur village en photos et ont offert un apéritif aux nombreux visiteurs.
Les Grands Louchiers ont gouté les soupes finalistes de chaque commune, puis se sont retirés pour délibérer. Pendant ce temps, le public a dégusté à son tour, et a pu voter pour leur soupe « coup de cœur » à l'aide de billes glissées dans un petit sac sur lequel était inscrit le nom du village.
Cette année, le prix du jury et le prix du public ont été attribués à Claude Bertet, résident à Crestet, pour sa soupe d'automne à la châtaigne et aux cèpes.
En 2011, le festival a 21 ans.
– 177 soupes présentées par les 16 villages du Pays Ventoux, contre 163 soupes en 2010.
– 770 litres de soupes, veloutés et autres potages servis au public.
– 1 mois de dégustation et de soirées conviviales animées par quatre tambourinaires.
– 280 membres ont composé le jury.
– 3 500 visiteurs se sont déplacés.
– 20 Grands Louchiers de La Confrérie des Louchiers Voconces, parmi lesquels se trouve une Villadéenne de 7 ans : Ludivine Blanc.
Cette année, 2 chaines de télévision se sont intéressées au festival.
– TF1, pour le journal de 13 heures avec Jean-Pierre Pernaut. Là encore, une Villadéenne s'est prêtée au jeu : Armelle Dénéréaz.
– France 3 Méditerranée, pour l'émission « 13 heures avec vous ».
Il était également prévu une émission pour Le 19.45 sur M6, mais le reportage a été annulé au dernier moment en raison du mauvais temps.
La grande finale a eu lieu le samedi 19 novembre à 19 heures à l'espace culturel de Vaison-la-Romaine.
Les 16 communes du Pays Vaison-Ventoux ont présenté sur un stand leur village en photos et ont offert un apéritif aux nombreux visiteurs.
Les Grands Louchiers ont gouté les soupes finalistes de chaque commune, puis se sont retirés pour délibérer. Pendant ce temps, le public a dégusté à son tour, et a pu voter pour leur soupe « coup de cœur » à l'aide de billes glissées dans un petit sac sur lequel était inscrit le nom du village.
Cette année, le prix du jury et le prix du public ont été attribués à Claude Bertet, résident à Crestet, pour sa soupe d'automne à la châtaigne et aux cèpes.

Claude Bertet, vainqueur 2011
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Mansour Belil et Aicha Imhi'outen se sont mariés à la mairie de Villedieu le 29 octobre 2011.
Mansour est maçon à Vaison-la-Romaine et Aïcha travaille à La Boîte à nougat à Crestet.
Ils avaient d'ailleurs, comme témoins, Anne Kastens et Yves Tolleron.
Ils sont Villadéens et habitent à La Baude.
Mansour est maçon à Vaison-la-Romaine et Aïcha travaille à La Boîte à nougat à Crestet.
Ils avaient d'ailleurs, comme témoins, Anne Kastens et Yves Tolleron.
Ils sont Villadéens et habitent à La Baude.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Sans doute pressé de découvrir le monde, Clément Favier est né avec quelques jours d'avance à la maternité de Carpentras, le 20 août 2011.
Bérangère Liber, Jérémy Favier et leur petite Lucie sont très heureux de l'arrivée de ce beau bébé de 4 100 g et de 525 mm.
Bienvenue à ce nouveau villadéen !
Bérangère Liber, Jérémy Favier et leur petite Lucie sont très heureux de l'arrivée de ce beau bébé de 4 100 g et de 525 mm.
Bienvenue à ce nouveau villadéen !

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Dans le numéro 70 de La Gazette, un article nous informait du changement de propriétaire de l'épicerie et éventuellement l’arrivée d’une nouvelle enseigne alimentaire.
Et bien, à ce jour, c'est chose faite. L'épicerie, à l’époque de Natacha et Cyril, représentait la marque « Cali », elle est désormais sous l'enseigne « Vival » désignant les petits magasins « Casino ». Ce changement a donc été l'occasion de modifier l'agencement du magasin et la façade extérieure a été refaite à neuf. Une nouvelle implantation des rayons d'alimentation, des légumes, de la crèmerie nous permet de découvrir aussi de nouveaux produits tels que les plats cuisinés : gardianne de taureau, blanquette de veau, tripes et tout un choix d'autres mets.
Le propriétaire, Fabien Bégani, boulanger de métier, offre une grande variété de pâtisseries, de biscuits et de pains. Il propose également, sur commande, des gâteaux d'anniversaire, des pièces montées, des bûches de Noël.
Toutes ces nouveautés ne pouvaient donc qu'être fêtées. Ainsi, le samedi 10 décembre, c'est dans ce tout nouveau décor que France Féminier nous a invités à l'inauguration du magasin et a accueilli les convives, avec sa gentillesse reconnue, en leur offrant un buffet alléchant et tout aussi conséquent.
L'idée a été bien appréciée puisque les invités sont venus nombreux, il y en avait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Tous ces éléments réunis font que l'épicerie n'est pas prête à disparaître et c'est tant mieux pour le village.
France, Villadéenne depuis le mois de juillet, habite chez Renée et Jacky Barre. Lorsque je suis allée la voir pour écrire l'article, elle m'a confié être une locataire privilégiée gâtée par ses propriétaires. À la fermeture du magasin, France rentre chez elle où des petits plats tout prêts l’attendent. Lorsque l'on connaît les talents culinaires de Renée Barre, France ne peut que régaler ses papilles.
L'épicerie est ouverte tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi.
Et bien, à ce jour, c'est chose faite. L'épicerie, à l’époque de Natacha et Cyril, représentait la marque « Cali », elle est désormais sous l'enseigne « Vival » désignant les petits magasins « Casino ». Ce changement a donc été l'occasion de modifier l'agencement du magasin et la façade extérieure a été refaite à neuf. Une nouvelle implantation des rayons d'alimentation, des légumes, de la crèmerie nous permet de découvrir aussi de nouveaux produits tels que les plats cuisinés : gardianne de taureau, blanquette de veau, tripes et tout un choix d'autres mets.
Le propriétaire, Fabien Bégani, boulanger de métier, offre une grande variété de pâtisseries, de biscuits et de pains. Il propose également, sur commande, des gâteaux d'anniversaire, des pièces montées, des bûches de Noël.
Toutes ces nouveautés ne pouvaient donc qu'être fêtées. Ainsi, le samedi 10 décembre, c'est dans ce tout nouveau décor que France Féminier nous a invités à l'inauguration du magasin et a accueilli les convives, avec sa gentillesse reconnue, en leur offrant un buffet alléchant et tout aussi conséquent.
L'idée a été bien appréciée puisque les invités sont venus nombreux, il y en avait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Tous ces éléments réunis font que l'épicerie n'est pas prête à disparaître et c'est tant mieux pour le village.
France, Villadéenne depuis le mois de juillet, habite chez Renée et Jacky Barre. Lorsque je suis allée la voir pour écrire l'article, elle m'a confié être une locataire privilégiée gâtée par ses propriétaires. À la fermeture du magasin, France rentre chez elle où des petits plats tout prêts l’attendent. Lorsque l'on connaît les talents culinaires de Renée Barre, France ne peut que régaler ses papilles.
L'épicerie est ouverte tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi.

France Féminier et ses fils
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
C'est le dimanche 13 novembre que La Ramade a organisé le traditionnel marché de Noël.
Les exposants nous ont fait découvrir leur talent. Chacun d'eux, dans des domaines artistiques différents, a installé son stand dès huit heures le matin, en présentant des oeuvres de qualité.
On a pu s'attarder devant les tableaux de paysages provençaux et les toiles abstraites de Françoise Tercerie, la vaisselle en porcelaine finement lustrée par Nathalie Berrez avec bronze et métaux précieux tels que l’or et le platine, les bijoux façonnés par Maurice Reynaud avec des nacres, des perles d’eau douce de différentes couleurs en provenance des Philippines, des pierres semi-précieuses de Madagascar dont le gain des ventes est destiné à un orphelinat philippin qui a pour devise : « un bijou, un sourire ».
Murielle Bertrand nous a proposé son huile de noix ainsi que de belles courges afin de nous inspirer de bonnes recettes hivernales.
Le stand de Sabine Gros nous a donné des idées de décoration d'intérieur avec son linge de maison brodé. Elle présentait aussi des produits de beauté naturels.
On a pu admirer les foulards en soie peints par Marie-Paule Hannak, accessoires appréciés pour compléter nos tenues de saison.
La Ferme des Arnaud, représentée par Pierre et Martial, nous a mis l'eau à la bouche par ses produits « bio » : jus de raisin, olives, huile d'olive et tapenade.
Jocelyne Pouzet a exposé ses créations insolites en faisant revivre de vieux objets pouvant aller du rond de serviette à une lampe de chevet.
Les dames de La Ramade et de Bon Esper ont fabriqué divers objets tels que des personnages de crèche, des couronnes de Noël, des broderies, des bijoux, des boîtes à mouchoirs, des petits tableaux décoratifs et, pour régaler nos papilles, du pain d'épice, des croquants sans oublier les confitures de l’établissement et service d'aide par le travail (E.S.A.T.) Les chaux d'Abrieu.
Yveric Migliara, céramiste, nous a proposé une multitude de bols de couleurs naturelles, réalisés avec la technique de cuisson du « raku ». Il était à côté de Laurent Guionnet, qui avec ses sculptures en ferronnerie, a imaginé d'une façon originale la confection de boîtes décoratives en utilisant des formes sphériques et cylindriques.
Jean Dieu, président de la cave La Vigneronne, a présenté les vins de l'année. Jonathan Fauque nous a offert une dégustation des fameux vins de Villedieu et Buisson. Cette année encore, Élisabeth Bertrand, a œuvré pour le téléthon, qui aura lieu les 2 et 3 décembre, en nous proposant des écharpes tricotées de ses mains et ses savoureux croquants aux amandes. Les visiteurs ont flâné autour des stands de qualité, ils ont acheté et ont pu consommer durant la journée diverses boissons et douceurs. Pour le repas de midi, Majo et Yvan Raffin ont servi, au choix, quiches, salades, blanquette de veau et La Ramade a proposé des crêpes. Un marché de Noël très réussi qui aurait vraiment mérité une plus grande fréquentation de la part des Villadéens et des Buissonnais.
Les exposants nous ont fait découvrir leur talent. Chacun d'eux, dans des domaines artistiques différents, a installé son stand dès huit heures le matin, en présentant des oeuvres de qualité.
On a pu s'attarder devant les tableaux de paysages provençaux et les toiles abstraites de Françoise Tercerie, la vaisselle en porcelaine finement lustrée par Nathalie Berrez avec bronze et métaux précieux tels que l’or et le platine, les bijoux façonnés par Maurice Reynaud avec des nacres, des perles d’eau douce de différentes couleurs en provenance des Philippines, des pierres semi-précieuses de Madagascar dont le gain des ventes est destiné à un orphelinat philippin qui a pour devise : « un bijou, un sourire ».
Murielle Bertrand nous a proposé son huile de noix ainsi que de belles courges afin de nous inspirer de bonnes recettes hivernales.
Le stand de Sabine Gros nous a donné des idées de décoration d'intérieur avec son linge de maison brodé. Elle présentait aussi des produits de beauté naturels.
On a pu admirer les foulards en soie peints par Marie-Paule Hannak, accessoires appréciés pour compléter nos tenues de saison.
La Ferme des Arnaud, représentée par Pierre et Martial, nous a mis l'eau à la bouche par ses produits « bio » : jus de raisin, olives, huile d'olive et tapenade.
Jocelyne Pouzet a exposé ses créations insolites en faisant revivre de vieux objets pouvant aller du rond de serviette à une lampe de chevet.
Les dames de La Ramade et de Bon Esper ont fabriqué divers objets tels que des personnages de crèche, des couronnes de Noël, des broderies, des bijoux, des boîtes à mouchoirs, des petits tableaux décoratifs et, pour régaler nos papilles, du pain d'épice, des croquants sans oublier les confitures de l’établissement et service d'aide par le travail (E.S.A.T.) Les chaux d'Abrieu.
Yveric Migliara, céramiste, nous a proposé une multitude de bols de couleurs naturelles, réalisés avec la technique de cuisson du « raku ». Il était à côté de Laurent Guionnet, qui avec ses sculptures en ferronnerie, a imaginé d'une façon originale la confection de boîtes décoratives en utilisant des formes sphériques et cylindriques.
Jean Dieu, président de la cave La Vigneronne, a présenté les vins de l'année. Jonathan Fauque nous a offert une dégustation des fameux vins de Villedieu et Buisson. Cette année encore, Élisabeth Bertrand, a œuvré pour le téléthon, qui aura lieu les 2 et 3 décembre, en nous proposant des écharpes tricotées de ses mains et ses savoureux croquants aux amandes. Les visiteurs ont flâné autour des stands de qualité, ils ont acheté et ont pu consommer durant la journée diverses boissons et douceurs. Pour le repas de midi, Majo et Yvan Raffin ont servi, au choix, quiches, salades, blanquette de veau et La Ramade a proposé des crêpes. Un marché de Noël très réussi qui aurait vraiment mérité une plus grande fréquentation de la part des Villadéens et des Buissonnais.

Le stand de La Ramade

Jonathan Fauque, La Vigneronne
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Samedi 26 novembre, il y avait foule à la salle des fêtes de Villedieu ! Il s'y tenait le loto de l'école de Villedieu-Buisson organisé, comme chaque année, par L'Amicale laïque.
Après une dernière journée de préparation intensive, mais non moins sympathique, le loto a débuté vers 16 heures dans la bonne humeur générale. À l'extérieur, le soleil brillait agréablement et à l'intérieur l'ambiance était des plus chaleureuses.
Les habitants de Villedieu, de Buisson et des alentours étaient venus nombreux pour jouer tous ensemble. Et même les personnes qui ne pouvaient pas être là avaient également une chance de gagner : Olivier Sac tenait consciencieusement les cartons des absents par ordinateur.
Tout était très bien organisé : Marie Jouvet annonçait les chiffres gagnants, Véronique Berthet tournait le boulier du loto, Sylvie Puechlong vérifiait les quines et les cartons pleins et Sophie Bertrand s'occupait de distribuer les lots.
Les enfants jouaient avec beaucoup d’enthousiasme. La grande gagnante de la journée fut Ludivine Blanc : elle repartit chez elle avec deux beaux lots après avoir fêté son anniversaire. Quelle journée mémorable pour elle !
Les adultes, tous très concentrés, jouaient avec autant de ferveur que les enfants. L'heureuse gagnante, Cybelle Brazzi, également secrétaire de L'Amicale, remportait le voyage au ski pour 4 personnes.
Hélas, le bonheur d'être gagnant n'est pas pour tout le monde. Heureusement, l'ambiance du loto était suffisante pour la plupart des passionnés du jeu.
Les parties de loto terminées, Philippe et Laurence Cambonie arrivèrent avec une délicieuse tartiflette accompagnée de verdure et d'une salade de fruits pour le dessert. Le repas fut apprécié par les 120 personnes restées là pour le dîner.
Rien n'aurait été possible sans la générosité des nombreux commerçants de la région et l'implication d'un grand nombre de bénévoles. Nous tenons à les remercier tous très chaleureusement.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du loto de l'école de Villedieu-Buisson.
Après une dernière journée de préparation intensive, mais non moins sympathique, le loto a débuté vers 16 heures dans la bonne humeur générale. À l'extérieur, le soleil brillait agréablement et à l'intérieur l'ambiance était des plus chaleureuses.
Les habitants de Villedieu, de Buisson et des alentours étaient venus nombreux pour jouer tous ensemble. Et même les personnes qui ne pouvaient pas être là avaient également une chance de gagner : Olivier Sac tenait consciencieusement les cartons des absents par ordinateur.
Tout était très bien organisé : Marie Jouvet annonçait les chiffres gagnants, Véronique Berthet tournait le boulier du loto, Sylvie Puechlong vérifiait les quines et les cartons pleins et Sophie Bertrand s'occupait de distribuer les lots.
Les enfants jouaient avec beaucoup d’enthousiasme. La grande gagnante de la journée fut Ludivine Blanc : elle repartit chez elle avec deux beaux lots après avoir fêté son anniversaire. Quelle journée mémorable pour elle !
Les adultes, tous très concentrés, jouaient avec autant de ferveur que les enfants. L'heureuse gagnante, Cybelle Brazzi, également secrétaire de L'Amicale, remportait le voyage au ski pour 4 personnes.
Hélas, le bonheur d'être gagnant n'est pas pour tout le monde. Heureusement, l'ambiance du loto était suffisante pour la plupart des passionnés du jeu.
Les parties de loto terminées, Philippe et Laurence Cambonie arrivèrent avec une délicieuse tartiflette accompagnée de verdure et d'une salade de fruits pour le dessert. Le repas fut apprécié par les 120 personnes restées là pour le dîner.
Rien n'aurait été possible sans la générosité des nombreux commerçants de la région et l'implication d'un grand nombre de bénévoles. Nous tenons à les remercier tous très chaleureusement.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du loto de l'école de Villedieu-Buisson.

Une heureuse gagnante !

Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Dans la douceur automnale de ce mois de novembre, le samedi 12, le Comité des fêtes a organisé, comme chaque année, le « repas des bénévoles et des nouveaux arrivants ».
Cet événement a été mis en place par la municipalité afin de remercier les bénévoles qui ont œuvré toute l’année pour le bon déroulement des nombreuses festivités, ainsi que pour accueillir les nouveaux venus dans notre village, peu nombreux en 2011.
Après l'apéritif, les uns et les autres font connaissance ou se retrouvent. Une quarantaine de convives a dégusté de la daube provençale accompagnée de salade, de fromage et de tarte aux pommes.
Grâce à la clémence de la météo, cette année, le repas a eu lieu sur la place, alors qu’il était prévu à la salle Pierre Bertrand.
Merci à Majo et Yvan Raffin qui nous ont, une fois de plus, régalés et aussi à tous les participants qui ont fait la réussite de ce moment de convivialité.
Cet événement a été mis en place par la municipalité afin de remercier les bénévoles qui ont œuvré toute l’année pour le bon déroulement des nombreuses festivités, ainsi que pour accueillir les nouveaux venus dans notre village, peu nombreux en 2011.
Après l'apéritif, les uns et les autres font connaissance ou se retrouvent. Une quarantaine de convives a dégusté de la daube provençale accompagnée de salade, de fromage et de tarte aux pommes.
Grâce à la clémence de la météo, cette année, le repas a eu lieu sur la place, alors qu’il était prévu à la salle Pierre Bertrand.
Merci à Majo et Yvan Raffin qui nous ont, une fois de plus, régalés et aussi à tous les participants qui ont fait la réussite de ce moment de convivialité.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
CHRONIQUE MUNICIPALE
Vingt-huit jeunes en formation sont venus travailler pendant trois jours et demi, du 10 au 13 octobre, au cimetière de Villedieu.
Ils y ont fait l'enduit de finition du mur réalisé par les employés municipaux et ils ont construit un muret de soutènement dans la partie basse. Ces élèves du Centre de formation des apprentis « Florentin Mouret » d'Avignon sont en première année de brevet professionnel de maçonnerie. Ils étaient encadrés par trois de leurs professeurs : Antonio Gimenez, Ludovic Lopez et Shay Shakeshaft. Ils en ont profité pour sceller à nouveau la porte séparant la partie neuve et la partie la plus ancienne du cimetière que le mistral avait emporté le samedi 8 octobre.
Ce chantier a été organisé principalement par Guillaume Portugues, conseiller municipal et Valéry Barbato, conseiller municipal et directeur adjoint du C.F.A.. Il permet de poursuivre l'aménagement du cimetière à un coût raisonnable, la commune prenant en charge les matériaux, le transport et le repas des apprentis.
Ce chantier permet également à ces jeunes de se former sur un vrai chantier plutôt que dans un atelier.
Ils y ont fait l'enduit de finition du mur réalisé par les employés municipaux et ils ont construit un muret de soutènement dans la partie basse. Ces élèves du Centre de formation des apprentis « Florentin Mouret » d'Avignon sont en première année de brevet professionnel de maçonnerie. Ils étaient encadrés par trois de leurs professeurs : Antonio Gimenez, Ludovic Lopez et Shay Shakeshaft. Ils en ont profité pour sceller à nouveau la porte séparant la partie neuve et la partie la plus ancienne du cimetière que le mistral avait emporté le samedi 8 octobre.
Ce chantier a été organisé principalement par Guillaume Portugues, conseiller municipal et Valéry Barbato, conseiller municipal et directeur adjoint du C.F.A.. Il permet de poursuivre l'aménagement du cimetière à un coût raisonnable, la commune prenant en charge les matériaux, le transport et le repas des apprentis.
Ce chantier permet également à ces jeunes de se former sur un vrai chantier plutôt que dans un atelier.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Mardi 13 décembre, pour la deuxième année consécutive, les aînés étaient invités à la salle Pierre Bertrand pour le traditionnel colis de Noël de la municipalité. Ils étaient accueillis par Armelle Dénéréaz, Sandrine Blanc, Majo Raffin et Pierre Arnaud.
Comme l’année dernière, les enfants de l’école sont venus leur remettre le colis. La classe de maternelle accompagnée de son institutrice, Fabienne Bichaud, et de son assistante, Mireille Straet, a chanté pour le plus grand bonheur des aînés présents.
Enfants et anciens ont partagé un délicieux goûter préparé par les élus.
Tous sont repartis ravis de cet après-midi chaleureux qui a rapproché les générations.
Comme l’année dernière, les enfants de l’école sont venus leur remettre le colis. La classe de maternelle accompagnée de son institutrice, Fabienne Bichaud, et de son assistante, Mireille Straet, a chanté pour le plus grand bonheur des aînés présents.
Enfants et anciens ont partagé un délicieux goûter préparé par les élus.
Tous sont repartis ravis de cet après-midi chaleureux qui a rapproché les générations.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
CÔTÉ NATURE
À l'occasion des fêtes de fin d'année, les rencontres familiales ou amicales s'accompagnent de plaisirs partagés dont la dégustation de chocolats fait partie. C’est l’occasion de se poser la question : d'où vient le chocolat ?
Le chocolat est obtenu à partir de la cabosse, fruit du cacaoyer (ou cacaotier), arbre pouvant atteindre dix mètres de haut.
Exigeant, ce végétal a besoin d'un climat chaud et humide, entre 20° de latitude Nord et 20° de latitude Sud, d'une température idéale de 24° à 26° (jamais moins de 10°), des pluies abondantes, un sol riche en potasse, en azote et en oligo-éléments, tout cela entre 400 et 1 000 mètres d'altitude. Ces conditions se rencontrent en Amérique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est.
Le cacaoyer appartient à la famille des Sterculiacées. C'est un arbre aux feuilles persistantes, son tronc de 30 centimètres de diamètre à l'âge adulte est recouvert d'une écorce grise et lisse. Les fleurs blanches ou rosées apparaissent directement sur le tronc ou sur les grosses branches à partir de coussinets floraux qui se forment tout au long de l'année. Fécondées par un insecte spécifique, seule une fleur sur 500 produit un fruit : la cabosse.
De 20 centimètres de long pour sept centimètres de diamètre, la cabosse a la forme d'un ballon de rugby miniature. Pendant les six mois nécessaires pour atteindre la maturité, sa couleur évolue selon les espèces : les grosses baies passent du vert au jaune (pour les forasteros), du rouge violet à l'orangé (pour le criollo). Leur poids varie de 200 grammes à un kilo. Sous une écorce épaisse, l'intérieur du fruit contient de 20 à 40 graines regroupées en épi dans une gelée blanche aqueuse, sucrée appelée mucilage.
Les jeunes plants nécessaires à l'établissement des plantations de cacao sont obtenus soit par semis des fèves (levée rapide entre dix et quinze jours), soit à partir des coussinets floraux mis en terre. Pour grandir, les jeunes cacaoyers ont besoin de l'ombre de la canopée formée de grands arbres appelés « mères cacao » ; ces grands arbres, essentiellement des légumineuses, leur fournissent les matières azotées très utiles à la croissance des jeunes. La première récolte a lieu vers la cinquième année. Chaque arbre porte environ 150 fruits soit six kilos de cacao.
Comme tous les végétaux, les cacaoyers sont très sensibles aux insectes ravageurs et aux maladies cryptogamiques. Sa culture se pratique toujours dans de petites exploitations familiales de moins de cinq hectares.
Après « écabossage », fermentation, séchage, torréfaction et broyage, ces graines ou « fèves » donnent la poudre de cacao, base du chocolat que nous connaissons aujourd'hui.
Il existe de nombreuses espèces de cacao, mais trois d'entre elles se partagent le marché mondial. Le criollo (« créole » en espagnol) variété d'origine très ancienne cultivée au Mexique, au Guatemala, en Équateur puis, plus tard, au Sri Lanka. Ce prince des cacaos, destiné aux chocolateries haut de gamme, occupe 5 % du marché. Le forasteros (« étranger » en espagnol) produit différents cacaos. Les plants sont plus résistants, plus productifs. On le cultive en haute Amazonie et en Afrique de l'Ouest. Cette production prend 85 % du marché et constitue la base des chocolats courants. Le trinitario, hybride naturel des deux précédents, doit son nom à l'Île de Trinidad où il a été tardivement implanté. De bonne qualité, ce dernier est caractérisé par une forte teneur en beurre de cacao. Sa part de marché est de 10 %.
À noter que les fèves de cacao peuvent fixer les métaux lourds, tels que le cadmium et le plomb, à faible dose.
Comment le chocolat originaire des régions équatoriales est-il parvenu jusqu'à nous ? C'est dans les mythes et légendes de la civilisation précolombienne que le cacao est évoqué pour la première fois.
Les Mayas, les Aztèques et les Toltèques d'Amérique centrale, conscients de la richesse exceptionnelle de la boisson préparée à base de poudre de cacao, ne la consomment que dans des circonstances particulières. Pour eux, cette préparation, le xocolatl, apporte la force, la puissance et la richesse ; elle a aussi des vertus curatives et aphrodisiaques. Vers l'an 1300 de notre ère, les populations établies au Mexique vénèrent Quetzalcoatl, dieu serpent et jardinier du paradis.
Lors de son arrivée aux « Amériques », Christophe Colomb ne prête pas attention à cette culture, mais Cortes découvre très vite la boisson royale, le xocolatl, boisson que le roi offre à ses invités dans des coupes en or que l'on jette après cet usage unique. Il constate aussi que les fèves de cacao jouent le rôle de monnaie pour payer les impôts et les achats domestiques. Un esclave vaut deux cents fèves de cacao, une tomate vaut deux fèves. Cortes est très intéressé par cet argent « cultivé ». À son retour en Espagne, il rapporte cette boisson que les nobles espagnols trouvent amère, ils y ajoutent du sucre de canne et en conservent l'exclusivité pendant près d'un siècle. En France, son introduction est la conséquence de l'arrivée des juifs espagnols fuyant l'inquisition.
Très appréciée par l'ensemble de la noblesse européenne dès le XVIIe siècle, elle suscite la réprobation de l'église en raison de ses prétendues vertus aphrodisiaques !
Quoi qu’il en soit, faites le bon choix pour Noël...
Le chocolat est obtenu à partir de la cabosse, fruit du cacaoyer (ou cacaotier), arbre pouvant atteindre dix mètres de haut.
Exigeant, ce végétal a besoin d'un climat chaud et humide, entre 20° de latitude Nord et 20° de latitude Sud, d'une température idéale de 24° à 26° (jamais moins de 10°), des pluies abondantes, un sol riche en potasse, en azote et en oligo-éléments, tout cela entre 400 et 1 000 mètres d'altitude. Ces conditions se rencontrent en Amérique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est.
Le cacaoyer appartient à la famille des Sterculiacées. C'est un arbre aux feuilles persistantes, son tronc de 30 centimètres de diamètre à l'âge adulte est recouvert d'une écorce grise et lisse. Les fleurs blanches ou rosées apparaissent directement sur le tronc ou sur les grosses branches à partir de coussinets floraux qui se forment tout au long de l'année. Fécondées par un insecte spécifique, seule une fleur sur 500 produit un fruit : la cabosse.
De 20 centimètres de long pour sept centimètres de diamètre, la cabosse a la forme d'un ballon de rugby miniature. Pendant les six mois nécessaires pour atteindre la maturité, sa couleur évolue selon les espèces : les grosses baies passent du vert au jaune (pour les forasteros), du rouge violet à l'orangé (pour le criollo). Leur poids varie de 200 grammes à un kilo. Sous une écorce épaisse, l'intérieur du fruit contient de 20 à 40 graines regroupées en épi dans une gelée blanche aqueuse, sucrée appelée mucilage.
Les jeunes plants nécessaires à l'établissement des plantations de cacao sont obtenus soit par semis des fèves (levée rapide entre dix et quinze jours), soit à partir des coussinets floraux mis en terre. Pour grandir, les jeunes cacaoyers ont besoin de l'ombre de la canopée formée de grands arbres appelés « mères cacao » ; ces grands arbres, essentiellement des légumineuses, leur fournissent les matières azotées très utiles à la croissance des jeunes. La première récolte a lieu vers la cinquième année. Chaque arbre porte environ 150 fruits soit six kilos de cacao.
Comme tous les végétaux, les cacaoyers sont très sensibles aux insectes ravageurs et aux maladies cryptogamiques. Sa culture se pratique toujours dans de petites exploitations familiales de moins de cinq hectares.
Après « écabossage », fermentation, séchage, torréfaction et broyage, ces graines ou « fèves » donnent la poudre de cacao, base du chocolat que nous connaissons aujourd'hui.
Il existe de nombreuses espèces de cacao, mais trois d'entre elles se partagent le marché mondial. Le criollo (« créole » en espagnol) variété d'origine très ancienne cultivée au Mexique, au Guatemala, en Équateur puis, plus tard, au Sri Lanka. Ce prince des cacaos, destiné aux chocolateries haut de gamme, occupe 5 % du marché. Le forasteros (« étranger » en espagnol) produit différents cacaos. Les plants sont plus résistants, plus productifs. On le cultive en haute Amazonie et en Afrique de l'Ouest. Cette production prend 85 % du marché et constitue la base des chocolats courants. Le trinitario, hybride naturel des deux précédents, doit son nom à l'Île de Trinidad où il a été tardivement implanté. De bonne qualité, ce dernier est caractérisé par une forte teneur en beurre de cacao. Sa part de marché est de 10 %.
À noter que les fèves de cacao peuvent fixer les métaux lourds, tels que le cadmium et le plomb, à faible dose.
Comment le chocolat originaire des régions équatoriales est-il parvenu jusqu'à nous ? C'est dans les mythes et légendes de la civilisation précolombienne que le cacao est évoqué pour la première fois.
Les Mayas, les Aztèques et les Toltèques d'Amérique centrale, conscients de la richesse exceptionnelle de la boisson préparée à base de poudre de cacao, ne la consomment que dans des circonstances particulières. Pour eux, cette préparation, le xocolatl, apporte la force, la puissance et la richesse ; elle a aussi des vertus curatives et aphrodisiaques. Vers l'an 1300 de notre ère, les populations établies au Mexique vénèrent Quetzalcoatl, dieu serpent et jardinier du paradis.
Lors de son arrivée aux « Amériques », Christophe Colomb ne prête pas attention à cette culture, mais Cortes découvre très vite la boisson royale, le xocolatl, boisson que le roi offre à ses invités dans des coupes en or que l'on jette après cet usage unique. Il constate aussi que les fèves de cacao jouent le rôle de monnaie pour payer les impôts et les achats domestiques. Un esclave vaut deux cents fèves de cacao, une tomate vaut deux fèves. Cortes est très intéressé par cet argent « cultivé ». À son retour en Espagne, il rapporte cette boisson que les nobles espagnols trouvent amère, ils y ajoutent du sucre de canne et en conservent l'exclusivité pendant près d'un siècle. En France, son introduction est la conséquence de l'arrivée des juifs espagnols fuyant l'inquisition.
Très appréciée par l'ensemble de la noblesse européenne dès le XVIIe siècle, elle suscite la réprobation de l'église en raison de ses prétendues vertus aphrodisiaques !
Quoi qu’il en soit, faites le bon choix pour Noël...

Cabosse en coupe
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
LA VIGNE, LE VIN ET L'OLIVIER
2011 fut, pour la cave, la seconde meilleure année en terme de volume depuis vingt-cinq ans ! Fantastique !
Pour cette campagne, nous avons eu un printemps chaud et des conditions de nouaison* très bonnes qui ont favorisé l’apparition de belles grappes. L'été fut normal avec quelques petites pluies qui ont permis d'arriver aux vendanges sans difficulté particulière. Le mois de septembre a été chaud et sans pluie. Parfait pour cette récolte !
Le raisin, de très haut degré, est arrivé en cave avec une moyenne générale à 13,9°. Certains apports ont même atteint 17° et plus !
Nous avons rentré 4 652 000 kilos de raisins soit environ 36 000 hectolitres de vin. La cave a ouvert pour les viogniers et les chardonnays les 23, 24, 25 et 29 août, puis le 2 septembre pour le merlot et les autres blancs (Côtes du Rhône). Elle a fermé le 28 septembre. Pas un jour de pluie n’a gâché une journée de vendange ! Quelle année !
79 % des raisins sont vendangés à la machine, le reste à la main. Il y a eu 69 % de note A, 29 % de B et 2 % de C.
Les viogniers et chardonnays, sortis le troisième jeudi d'octobre, sont aromatiques.
Les rosés sont, comme chaque année, d'une qualité exceptionnelle, avec un nez très exotique et des couleurs magnifiques. D'ailleurs, la Cuvée des Templiers 2010, a été élue « coup de cœur » au Guide Hachette !
Les rouges sont meilleurs qu’en 2010. Ils feront de bons vins de garde, d'une très belle structure aromatique, des tanins beaux et fins, des vins d'élégance.
Nous vous invitons à déguster ce millésime le samedi 17 décembre à partir de 18 heures. Venez nombreux, on vous attend !
* La nouaison est la phase initiale de la formation du fruit. C'est le moment où l'ovaire de la fleur se transforme en fruit après la fécondation.
Pour cette campagne, nous avons eu un printemps chaud et des conditions de nouaison* très bonnes qui ont favorisé l’apparition de belles grappes. L'été fut normal avec quelques petites pluies qui ont permis d'arriver aux vendanges sans difficulté particulière. Le mois de septembre a été chaud et sans pluie. Parfait pour cette récolte !
Le raisin, de très haut degré, est arrivé en cave avec une moyenne générale à 13,9°. Certains apports ont même atteint 17° et plus !
Nous avons rentré 4 652 000 kilos de raisins soit environ 36 000 hectolitres de vin. La cave a ouvert pour les viogniers et les chardonnays les 23, 24, 25 et 29 août, puis le 2 septembre pour le merlot et les autres blancs (Côtes du Rhône). Elle a fermé le 28 septembre. Pas un jour de pluie n’a gâché une journée de vendange ! Quelle année !
79 % des raisins sont vendangés à la machine, le reste à la main. Il y a eu 69 % de note A, 29 % de B et 2 % de C.
Les viogniers et chardonnays, sortis le troisième jeudi d'octobre, sont aromatiques.
Les rosés sont, comme chaque année, d'une qualité exceptionnelle, avec un nez très exotique et des couleurs magnifiques. D'ailleurs, la Cuvée des Templiers 2010, a été élue « coup de cœur » au Guide Hachette !
Les rouges sont meilleurs qu’en 2010. Ils feront de bons vins de garde, d'une très belle structure aromatique, des tanins beaux et fins, des vins d'élégance.
Nous vous invitons à déguster ce millésime le samedi 17 décembre à partir de 18 heures. Venez nombreux, on vous attend !
* La nouaison est la phase initiale de la formation du fruit. C'est le moment où l'ovaire de la fleur se transforme en fruit après la fécondation.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Ce vendredi 21 octobre, la cave Villedieu-Buisson ne fermait pas ses portes à 18 heures, au contraire elle les ouvrait en grand pour la dégustation des chardonnays et des viogniers.
Nous sommes arrivées un peu plus tard et la foule était déjà présente.
Au son d’une musique de jazz, interprétée par un ensemble réuni pour l’occasion et pour notre plus grand plaisir, nous sommes allées nous servir un verre. Le personnel et les bénévoles se sont pliés en quatre pour satisfaire tout ce monde avec des amuse-gueules et de bonnes bouteilles.
Comme chaque année, Dominique Mombrun et son équipe nous ont proposé des huîtres, du foie gras aux huîtres et du jambon cuit à la broche accompagné de flageolets et de pommes de terre. Victimes de leur succès, ils n'ont malheureusement pas pu contenter tout le monde, vers 20 heures les marmites étaient vides. Mais cette soirée était loin d'être finie, grâce à la convivialité, à la musique et au vin, les invités ont pris plaisir à s'attarder.
Encore une soirée dégustation très réussie.
Bravo aux organisateurs et rendez-vous pour le rouge !
Nous sommes arrivées un peu plus tard et la foule était déjà présente.
Au son d’une musique de jazz, interprétée par un ensemble réuni pour l’occasion et pour notre plus grand plaisir, nous sommes allées nous servir un verre. Le personnel et les bénévoles se sont pliés en quatre pour satisfaire tout ce monde avec des amuse-gueules et de bonnes bouteilles.
Comme chaque année, Dominique Mombrun et son équipe nous ont proposé des huîtres, du foie gras aux huîtres et du jambon cuit à la broche accompagné de flageolets et de pommes de terre. Victimes de leur succès, ils n'ont malheureusement pas pu contenter tout le monde, vers 20 heures les marmites étaient vides. Mais cette soirée était loin d'être finie, grâce à la convivialité, à la musique et au vin, les invités ont pris plaisir à s'attarder.
Encore une soirée dégustation très réussie.
Bravo aux organisateurs et rendez-vous pour le rouge !

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
BUISSON
Quand les Peuples s'égarent, la honte est pour les Seigneurs ! Le peuple, c'est nous, les habitants. Les Seigneurs, ce sont Les Élus ! »
Les révolutions, les révoltes, les furies villageoises, les conflits de voisinage (qu'on peut toujours déplorer, tant pour les dégâts matériels que pour le désarroi des gens qui préfèreraient l'harmonie et la joie de vivre) ont toujours pour cause les abus de pouvoir.
On pourrait croire que « la démocratie », plus ou moins « représentative » permet une vie collective équilibrée, raisonnable. Mais non ! Le pouvoir et ses jeux, c'est grisant, quand l'argent coule à flots (Ô subventions !) et qu'il suffit d'emprunter et d'augmenter nos impôts !
Il était une fois un charmant village nommé Buisson. Toute une histoire : les Templiers, trouvant le site exceptionnel, y ont construit des remparts (XIIIe siècle ... et encore en bon état) entourés d'un bel écrin de verdure avec, en contrebas de la route départementale, à l'abri de la circulation, des maisons charmantes qui mériteraient rénovations et embellissement.
Le village périclitait, il y a quelques décennies, au point qu'il fallut fermer l'école. La classe unique fut convertie en salle des fêtes. Au dépeuplement a succédé l'arrivée des citadins, retraités, plus ou moins nordistes ou étrangers ayant atteint assez d'aisance pour acheter des maisons délaissées ou abandonnées, et les restaurer avec passion, se prenant d'amour pour la commune et la région, au point d'y rester et d'y être encore aujourd'hui. Ces nouveaux venus coexistent avec les familles vigneronnes, autour de cette colline coquette où il ne se passe pas grand-chose.
Trois cents habitants seulement. Aucun commerce : pas un ne pourrait y survivre, faute de clientèle suffisante. Vaison-la-Romaine, à neuf kilomètres, avec ses boutiques et ses supermarchés, offre une capacité d'approvisionnement irrésistible tant qu'il y aura des autos !
La municipalité (son maire en particulier) confortée par les technostructures que sont la copavo, le département, la région, la D.D.E., etc, ayant appris l'ambition urbanistique, et, comme bien d'autres, ayant compris qu'il suffit d'exprimer des « projets » pour déclencher des financements, et qu'il existe des subventions, il suffit donc d'avoir des projets, qu'on qualifie « d'intérêt général » et de « solidaires » (les grands mots qui en jettent) pour se lancer dans des achats ou des travaux qui peuvent être contestables (question de goûts) et budgétairement disproportionnés. Il est facile de justifier des décisions et de ne pas dire les véritables objectifs.
Voyons donc.
En août, les vacanciers sont tous là avec leurs voitures, et pendant quelques semaines, la place de Verdun est encombrée. C'est vrai, mais c'est la vie ! Où trouver, où proposer d'autres emplacements ? On y réfléchit.
Le boulodrome, récent, superbe mais inutilisé, ferait bien l'affaire : d'accès facile à l'entrée, déjà éclairé, ne gênant personne. Par-ci, par-là, quelques emplacements pourraient être aménagés. Mais non, c'est trop simple, pas assez ambitieux !
Le maire rêve d'urbaniser cette grande portion de colline, entourant les remparts, inutilisée, à l’état sauvage et méprisable quand on n'apprécie pas la nature.L’écologie reste un concept de « Parisiens » qui ne mérite pas la considération du monde agricole. Le maire réfléchit, parfois pense tout haut, et de-ci, de-là énonce ses idées.
« Non ! Surtout pas ! » lui répond-on chaque fois. Alors le maire nous rétorque que ce n'est qu'un projet : créer un parking pour six voitures derrière les remparts !
– Mais, comment çà ? Il n'y a qu'un chemin de promeneurs qui sent bon la noisette, comme dit la chanson.
– Qu'à cela ne tienne ! On va créer une route !
– Mais la pente est très forte !
– Qu'à cela ne tienne ! Ce sera une route en lacet, comme en montagne, avec un virage en épingle à cheveux !
– Mais cette route traverse le terrain d'une dame qui n'a pas envie de le vendre !
– Tant pis ! Et puis il faut bien faire passer quelque part les gros engins de chantier qui vont tailler la colline. La dame est loin et ne peut pas s'interposer. Et puis, des études approfondies réalisées par un cabinet d'experts bien chers, qui éditent de beaux dossiers, confortent l'idée !
En juin 2009, quelques citoyens inquiets avaient obtenu qu'une réunion d'information, à la mairie, permette de savoir où en était vraiment la municipalité dans ses investigations. Désaccord complet !
– Mais ce n'est qu'un projet, dit le maire. On vous dira quand le moment sera venu.
Malgré un courrier et des visites régulières des habitants inquiets qui ne voyaient toujours rien venir (et n'avaient pas accès au plan), aucune réunion d'information sur le nouveau projet n’a eu lieu ! Aucune communication. Plus rien.
Jusqu'au 17 octobre 2011, comme pour l'arrivée des chars russes à Budapest, on dresse des barrières, avec arrêté municipal, écrit en tout petit, stipulant : « Chantier interdit pendant toute la durée des travaux ». Les gros engins de chantier font alors irruption et la « lame » a tôt fait de tailler une route, de bas en haut, supprimant l'herbe qui retenait l'eau lors des orages, et les buissons, qu'on accuse d'être un risque d'incendie, et on coupe des arbres et arbustes qui gênent. D'ailleurs, l'employé municipal avait commencé bien avant, zélé dans l'usage de désherbant (dont on ne citera pas la marque) pour faire plus propre !
Après quoi, de gros camions ont amené d'énormes pierres, pesant des tonnes, pour consolider la colline fragilisée. Ces blocs n'ont rien à voir avec le style du coin, mais c'est la mode ! Et c'est du solide ! On élimine les vieux murs, estimés dangereux, et pour faire encore plus secure, on va rehausser le mur qui entoure l'ancien cimetière, pour empêcher les enfants de tomber !
– Mais en rehaussant ce mur de 50 centimètres environ, vous réduisez le panorama sur toute la vallée en contrebas !
– On voit bien suffisamment le paysage ! (ricanements...).
– Pourquoi pas une grille, qui permettrait le regard sans le restreindre ? (silence désapprobateur...).
Les jeux sont faits ! Fini « l'écosystème », c'est à dire cet ensemble naturel, qu'on qualifie de biodiversité, alliance du végétal libre et touffu, et de tous ces animaux, discrets mais pourtant présents (demandez aux voisins !). Chats huants, écureuils et autres se sont enfuis.
– C'est fini !.Les jeux d'enfants, qui aimaient tant ces petits coins de sauvagerie, tellement nécessaires, comme l'expliquent très bien les sociologues, philosophes et psychologues...
– C'est fini !.Le pique-nique des promeneurs dans l'herbe (et non pas sur la route bitumée ou les plateformes aseptisées).
– C'est fini !.Le rempart templier est découvert et n'est plus entouré de sa végétation protectrice et bienfaisante.
Une obsession municipale : qu'un handicapé en fauteuil roulant puisse faire son tour, à l'aise, d'où une voie élargie, tout au long des murs, non pas couverte d'asphalte (quand-même !), mais d'un matériau bizarre, la « clapissette », appellation vulgaire qui se veut sympathique et qui confèrera un genre artificiel, prétendument moderne, d'origine « naturelle », vraiment pas assorti aux valeureux remparts !
Nos réunions sollicitées avec insistance à la mairie, puis celle du 8 novembre à la salle des fêtes, nous révèlent trois cents mètres carrés « constructibles » ! Justification à peine avouée de cet ensemble routier démesuré pour « six » places de parking qui s'avèrent à usage privatif, alors que le terrain appartient à la mairie ! C'est comme çà qu'il faut comprendre les termes « solidaire » ou « d'intérêt général ».
Les citoyens venus nombreux qui ont fortement exprimé leur désapprobation par une pétition (484 signatures, 150 commentaires très motivés et documentés, sur Internet et sur papier) ont décidé de créer une association de sauvegarde du patrimoine écologique et culturel de leur village, rejetant ce chantier, en bloc, demandant d'arrêter les travaux et de réhabiliter le site.
L'association Les Barry de Buisson a vu le jour le 1er novembre 2011.
Un dossier complet, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception au Préfet, au Sous-Préfet, au président du conseil général, au député Durieu, au président de la copavo, Pierre Meffre et à Liliane Blanc, maire de Buisson.
La presse écrite, La Tribune, La Provence, Vaucluse Matin, la radio, France-Inter (émission « Carnets de campagne »), France Bleu Vaucluse et la télévision, France 3 Marseille, ont porté attention à notre « drame ».
Le délégué des Maisons paysannes de France a aussi exprimé sa désapprobation. Quant à la commission du patrimoine, elle ne peut rien pour nous ! Ce village n'est pas classé et pour obtenir les conseils avertis d'un architecte des Bâtiments de France, une demande doit venir du maire !
Quelle instance, quelle personnalité de poids voudront bien nous accorder un peu de considération pour faire entendre raison à une poignée de personnes embarquées dans un jeu infernal et très coûteux en ces moments où l'économie s'impose ?
Quelle instance, quelle personnalité de poids voudront bien comprendre notre désarroi de ne pas être écoutés et entendus ? Qui va remettre le calme dans ce petit village en colère ?
Tous Templiers ! Tous insurgés !
Pour contribuer à la pétition :
http://petition24.net/sauvegarde-ecologique-et-culturelle-de-buisson-et-son-patrimoine
Pour joindre l'association par mail :
lesbarrydebuisson@gmail.com
Les révolutions, les révoltes, les furies villageoises, les conflits de voisinage (qu'on peut toujours déplorer, tant pour les dégâts matériels que pour le désarroi des gens qui préfèreraient l'harmonie et la joie de vivre) ont toujours pour cause les abus de pouvoir.
On pourrait croire que « la démocratie », plus ou moins « représentative » permet une vie collective équilibrée, raisonnable. Mais non ! Le pouvoir et ses jeux, c'est grisant, quand l'argent coule à flots (Ô subventions !) et qu'il suffit d'emprunter et d'augmenter nos impôts !
Il était une fois un charmant village nommé Buisson. Toute une histoire : les Templiers, trouvant le site exceptionnel, y ont construit des remparts (XIIIe siècle ... et encore en bon état) entourés d'un bel écrin de verdure avec, en contrebas de la route départementale, à l'abri de la circulation, des maisons charmantes qui mériteraient rénovations et embellissement.
Le village périclitait, il y a quelques décennies, au point qu'il fallut fermer l'école. La classe unique fut convertie en salle des fêtes. Au dépeuplement a succédé l'arrivée des citadins, retraités, plus ou moins nordistes ou étrangers ayant atteint assez d'aisance pour acheter des maisons délaissées ou abandonnées, et les restaurer avec passion, se prenant d'amour pour la commune et la région, au point d'y rester et d'y être encore aujourd'hui. Ces nouveaux venus coexistent avec les familles vigneronnes, autour de cette colline coquette où il ne se passe pas grand-chose.
Trois cents habitants seulement. Aucun commerce : pas un ne pourrait y survivre, faute de clientèle suffisante. Vaison-la-Romaine, à neuf kilomètres, avec ses boutiques et ses supermarchés, offre une capacité d'approvisionnement irrésistible tant qu'il y aura des autos !
La municipalité (son maire en particulier) confortée par les technostructures que sont la copavo, le département, la région, la D.D.E., etc, ayant appris l'ambition urbanistique, et, comme bien d'autres, ayant compris qu'il suffit d'exprimer des « projets » pour déclencher des financements, et qu'il existe des subventions, il suffit donc d'avoir des projets, qu'on qualifie « d'intérêt général » et de « solidaires » (les grands mots qui en jettent) pour se lancer dans des achats ou des travaux qui peuvent être contestables (question de goûts) et budgétairement disproportionnés. Il est facile de justifier des décisions et de ne pas dire les véritables objectifs.
Voyons donc.
En août, les vacanciers sont tous là avec leurs voitures, et pendant quelques semaines, la place de Verdun est encombrée. C'est vrai, mais c'est la vie ! Où trouver, où proposer d'autres emplacements ? On y réfléchit.
Le boulodrome, récent, superbe mais inutilisé, ferait bien l'affaire : d'accès facile à l'entrée, déjà éclairé, ne gênant personne. Par-ci, par-là, quelques emplacements pourraient être aménagés. Mais non, c'est trop simple, pas assez ambitieux !
Le maire rêve d'urbaniser cette grande portion de colline, entourant les remparts, inutilisée, à l’état sauvage et méprisable quand on n'apprécie pas la nature.L’écologie reste un concept de « Parisiens » qui ne mérite pas la considération du monde agricole. Le maire réfléchit, parfois pense tout haut, et de-ci, de-là énonce ses idées.
« Non ! Surtout pas ! » lui répond-on chaque fois. Alors le maire nous rétorque que ce n'est qu'un projet : créer un parking pour six voitures derrière les remparts !
– Mais, comment çà ? Il n'y a qu'un chemin de promeneurs qui sent bon la noisette, comme dit la chanson.
– Qu'à cela ne tienne ! On va créer une route !
– Mais la pente est très forte !
– Qu'à cela ne tienne ! Ce sera une route en lacet, comme en montagne, avec un virage en épingle à cheveux !
– Mais cette route traverse le terrain d'une dame qui n'a pas envie de le vendre !
– Tant pis ! Et puis il faut bien faire passer quelque part les gros engins de chantier qui vont tailler la colline. La dame est loin et ne peut pas s'interposer. Et puis, des études approfondies réalisées par un cabinet d'experts bien chers, qui éditent de beaux dossiers, confortent l'idée !
En juin 2009, quelques citoyens inquiets avaient obtenu qu'une réunion d'information, à la mairie, permette de savoir où en était vraiment la municipalité dans ses investigations. Désaccord complet !
– Mais ce n'est qu'un projet, dit le maire. On vous dira quand le moment sera venu.
Malgré un courrier et des visites régulières des habitants inquiets qui ne voyaient toujours rien venir (et n'avaient pas accès au plan), aucune réunion d'information sur le nouveau projet n’a eu lieu ! Aucune communication. Plus rien.
Jusqu'au 17 octobre 2011, comme pour l'arrivée des chars russes à Budapest, on dresse des barrières, avec arrêté municipal, écrit en tout petit, stipulant : « Chantier interdit pendant toute la durée des travaux ». Les gros engins de chantier font alors irruption et la « lame » a tôt fait de tailler une route, de bas en haut, supprimant l'herbe qui retenait l'eau lors des orages, et les buissons, qu'on accuse d'être un risque d'incendie, et on coupe des arbres et arbustes qui gênent. D'ailleurs, l'employé municipal avait commencé bien avant, zélé dans l'usage de désherbant (dont on ne citera pas la marque) pour faire plus propre !
Après quoi, de gros camions ont amené d'énormes pierres, pesant des tonnes, pour consolider la colline fragilisée. Ces blocs n'ont rien à voir avec le style du coin, mais c'est la mode ! Et c'est du solide ! On élimine les vieux murs, estimés dangereux, et pour faire encore plus secure, on va rehausser le mur qui entoure l'ancien cimetière, pour empêcher les enfants de tomber !
– Mais en rehaussant ce mur de 50 centimètres environ, vous réduisez le panorama sur toute la vallée en contrebas !
– On voit bien suffisamment le paysage ! (ricanements...).
– Pourquoi pas une grille, qui permettrait le regard sans le restreindre ? (silence désapprobateur...).
Les jeux sont faits ! Fini « l'écosystème », c'est à dire cet ensemble naturel, qu'on qualifie de biodiversité, alliance du végétal libre et touffu, et de tous ces animaux, discrets mais pourtant présents (demandez aux voisins !). Chats huants, écureuils et autres se sont enfuis.
– C'est fini !.Les jeux d'enfants, qui aimaient tant ces petits coins de sauvagerie, tellement nécessaires, comme l'expliquent très bien les sociologues, philosophes et psychologues...
– C'est fini !.Le pique-nique des promeneurs dans l'herbe (et non pas sur la route bitumée ou les plateformes aseptisées).
– C'est fini !.Le rempart templier est découvert et n'est plus entouré de sa végétation protectrice et bienfaisante.
Une obsession municipale : qu'un handicapé en fauteuil roulant puisse faire son tour, à l'aise, d'où une voie élargie, tout au long des murs, non pas couverte d'asphalte (quand-même !), mais d'un matériau bizarre, la « clapissette », appellation vulgaire qui se veut sympathique et qui confèrera un genre artificiel, prétendument moderne, d'origine « naturelle », vraiment pas assorti aux valeureux remparts !
Nos réunions sollicitées avec insistance à la mairie, puis celle du 8 novembre à la salle des fêtes, nous révèlent trois cents mètres carrés « constructibles » ! Justification à peine avouée de cet ensemble routier démesuré pour « six » places de parking qui s'avèrent à usage privatif, alors que le terrain appartient à la mairie ! C'est comme çà qu'il faut comprendre les termes « solidaire » ou « d'intérêt général ».
Les citoyens venus nombreux qui ont fortement exprimé leur désapprobation par une pétition (484 signatures, 150 commentaires très motivés et documentés, sur Internet et sur papier) ont décidé de créer une association de sauvegarde du patrimoine écologique et culturel de leur village, rejetant ce chantier, en bloc, demandant d'arrêter les travaux et de réhabiliter le site.
L'association Les Barry de Buisson a vu le jour le 1er novembre 2011.
Un dossier complet, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception au Préfet, au Sous-Préfet, au président du conseil général, au député Durieu, au président de la copavo, Pierre Meffre et à Liliane Blanc, maire de Buisson.
La presse écrite, La Tribune, La Provence, Vaucluse Matin, la radio, France-Inter (émission « Carnets de campagne »), France Bleu Vaucluse et la télévision, France 3 Marseille, ont porté attention à notre « drame ».
Le délégué des Maisons paysannes de France a aussi exprimé sa désapprobation. Quant à la commission du patrimoine, elle ne peut rien pour nous ! Ce village n'est pas classé et pour obtenir les conseils avertis d'un architecte des Bâtiments de France, une demande doit venir du maire !
Quelle instance, quelle personnalité de poids voudront bien nous accorder un peu de considération pour faire entendre raison à une poignée de personnes embarquées dans un jeu infernal et très coûteux en ces moments où l'économie s'impose ?
Quelle instance, quelle personnalité de poids voudront bien comprendre notre désarroi de ne pas être écoutés et entendus ? Qui va remettre le calme dans ce petit village en colère ?
Tous Templiers ! Tous insurgés !
Pour contribuer à la pétition :
http://petition24.net/sauvegarde-ecologique-et-culturelle-de-buisson-et-son-patrimoine
Pour joindre l'association par mail :
lesbarrydebuisson@gmail.com

Le beau village de Buisson

Un aperçu des travaux
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
En 2005, avec le Conseil architecture urbanisme et environnement (C.A.U.E.) une première réflexion sur les espaces de vie du village a été engagée. Elle portait sur la mise en valeur des entrées nord et ouest ainsi que des terrains communaux qui font l'objet des travaux actuels.
Le jeu de boules et le point d'apport volontaire au tri sélectif ont été réaménagés. Un abribus facile d'accès pour les transports en commun a été installé par le Conseil général de Vaucluse soucieux d'aider les communes.
En 2008, avec l'intercommunalité et financée à 80 % par la Région, une étude sur la requalification des espaces de vie du village a été réalisée par le bureau d'études Kanopé dans le cadre du Programme d'aménagement solidaire (P.A.S.).
Un schéma global a été proposé avec trois axes :
– les terrains communaux au nord du village : aménagement paysager avec possibilité de stationnement.
– la place de Verdun : limitation du stationnement afin de refaire de ce lieu un espace de vie.
– l'entrée sud du village : pour envisager un possible stationnement libérant des voies publiques de circulation et des terrains privés.
Le rendu d'étude a été présenté en réunion publique le 25 juin 2009 à 18 heures à la salle des fêtes du village (28 personnes ont signé la feuille de présence). Prenant en compte les remarques faites lors de cette réunion et pour répondre aux obligations de sécurité et d'accessibilité sur les espaces de vie du village, le Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux d'aménagement paysager sur les terrains communaux des lieux dits « Le village » et « Le Barry ».
Le 17 octobre 2011, les travaux prévus ont débuté comme suit :
– zone dite de « l'ancien cimetière » : point de vue sur la vallée de l'Aygues : reprise d'une partie de la plate forme et du chemin d'accès pour harmoniser les niveaux. Création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R.), les fauteuils roulants, les poussettes d'enfants... Renforcement extérieur de la base du mur. Reprise du muret avec les matériaux existant sur place pour un rehaussement de 20 à 40 centimètres, répondant à la réglementation. Conservation des végétaux. Installation d'une table d'orientation.
– zone dite « Sous le Barry » : aménagement des plateformes et des voies de circulation existantes ; elles seront aplanies, stabilisées et sécurisées. L'entretien de cet espace et la lutte contre l'incendie seront ainsi facilités. Le stationnement (huit places maximum) sera possible sur la plateforme existante. Le mur bordant le chemin de Saint-Maurice sera renforcé. Par mesure de sécurité, la zone constructible sera déblayée et stabilisée par des enrochements. Il est prévu l'installation de bancs et la plantation de végétaux méditerranéens à faible demande en eau. Une partie restreinte de l'ensemble sera éclairée par des points lumineux très bas pour un éclairage rasant. La ligne électrique aérienne existante surplombant les terrains sera déposée et un réseau enterré sera créé par le Syndicat intercommunal d'électrification rurale. L’enfouissement de la ligne France Télécom bordant le chemin de Saint-Maurice sera pris en charge par la commune. Installation sur les deux postes de distribution de l'ensemble de l'éclairage public, existants, de variateurs basse tension pour une économie annuelle de 36 % de la consommation tout en gardant un niveau d'éclairement suffisant et uniforme.
C’est l’entreprise Eiffage qui a été retenue, avec un coût estimatif des travaux de 283 230,63 € H.T., soit 338 743,83 € T.T.C..
Des subventions ont été demandées et obtenues :
– Conseil régional : 146 717 €.
– Conseil général : 96 300 €.
– dotation parlementaire : 10 000 €.
Les élus de la commune n'ont jamais envisagé de couper tous les arbres, de bétonner et de goudronner cet espace, mais simplement de rendre ce lieu plus agréable et accessible à tous dans une démarche d'intérêt général.
Le jeu de boules et le point d'apport volontaire au tri sélectif ont été réaménagés. Un abribus facile d'accès pour les transports en commun a été installé par le Conseil général de Vaucluse soucieux d'aider les communes.
En 2008, avec l'intercommunalité et financée à 80 % par la Région, une étude sur la requalification des espaces de vie du village a été réalisée par le bureau d'études Kanopé dans le cadre du Programme d'aménagement solidaire (P.A.S.).
Un schéma global a été proposé avec trois axes :
– les terrains communaux au nord du village : aménagement paysager avec possibilité de stationnement.
– la place de Verdun : limitation du stationnement afin de refaire de ce lieu un espace de vie.
– l'entrée sud du village : pour envisager un possible stationnement libérant des voies publiques de circulation et des terrains privés.
Le rendu d'étude a été présenté en réunion publique le 25 juin 2009 à 18 heures à la salle des fêtes du village (28 personnes ont signé la feuille de présence). Prenant en compte les remarques faites lors de cette réunion et pour répondre aux obligations de sécurité et d'accessibilité sur les espaces de vie du village, le Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux d'aménagement paysager sur les terrains communaux des lieux dits « Le village » et « Le Barry ».
Le 17 octobre 2011, les travaux prévus ont débuté comme suit :
– zone dite de « l'ancien cimetière » : point de vue sur la vallée de l'Aygues : reprise d'une partie de la plate forme et du chemin d'accès pour harmoniser les niveaux. Création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R.), les fauteuils roulants, les poussettes d'enfants... Renforcement extérieur de la base du mur. Reprise du muret avec les matériaux existant sur place pour un rehaussement de 20 à 40 centimètres, répondant à la réglementation. Conservation des végétaux. Installation d'une table d'orientation.
– zone dite « Sous le Barry » : aménagement des plateformes et des voies de circulation existantes ; elles seront aplanies, stabilisées et sécurisées. L'entretien de cet espace et la lutte contre l'incendie seront ainsi facilités. Le stationnement (huit places maximum) sera possible sur la plateforme existante. Le mur bordant le chemin de Saint-Maurice sera renforcé. Par mesure de sécurité, la zone constructible sera déblayée et stabilisée par des enrochements. Il est prévu l'installation de bancs et la plantation de végétaux méditerranéens à faible demande en eau. Une partie restreinte de l'ensemble sera éclairée par des points lumineux très bas pour un éclairage rasant. La ligne électrique aérienne existante surplombant les terrains sera déposée et un réseau enterré sera créé par le Syndicat intercommunal d'électrification rurale. L’enfouissement de la ligne France Télécom bordant le chemin de Saint-Maurice sera pris en charge par la commune. Installation sur les deux postes de distribution de l'ensemble de l'éclairage public, existants, de variateurs basse tension pour une économie annuelle de 36 % de la consommation tout en gardant un niveau d'éclairement suffisant et uniforme.
C’est l’entreprise Eiffage qui a été retenue, avec un coût estimatif des travaux de 283 230,63 € H.T., soit 338 743,83 € T.T.C..
Des subventions ont été demandées et obtenues :
– Conseil régional : 146 717 €.
– Conseil général : 96 300 €.
– dotation parlementaire : 10 000 €.
Les élus de la commune n'ont jamais envisagé de couper tous les arbres, de bétonner et de goudronner cet espace, mais simplement de rendre ce lieu plus agréable et accessible à tous dans une démarche d'intérêt général.

Piquetage sous les remparts
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Comme chaque année, à pareille époque, la mairie de Buisson avait convié la population à la traditionnelle castagnade qui a connu un réel succès.
Les châtaignes cuites au feu de bois par Jean-Jacques Blanc, Richard Villet et Rémi Tortel ont été appréciées par les personnes présentes ainsi que le vin des Côtes du Rhône primeur des caves coopératives de Villedieu-Buisson et Tulette.
Liliane Blanc, maire du village, a remercié toutes les personnes présentes ... et à l'an que vèn !
Merci à tous.
Les châtaignes cuites au feu de bois par Jean-Jacques Blanc, Richard Villet et Rémi Tortel ont été appréciées par les personnes présentes ainsi que le vin des Côtes du Rhône primeur des caves coopératives de Villedieu-Buisson et Tulette.
Liliane Blanc, maire du village, a remercié toutes les personnes présentes ... et à l'an que vèn !
Merci à tous.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Par une belle matinée ensoleillée d'automne, une triste nouvelle se répandait dans le village. Luc Van Braekel, habitant belge de Buisson depuis de longues années, venait de nous quitter à la suite d’un malaise cardiaque.
Au milieu des années soixante, Luc et Louise Van Braekel, leurs enfants, accompagnés de la famille Seghers, au hasard de la recherche d'une location pour leurs vacances en France, avaient trouvé une maison à Buisson, quartier des Vialles, appartenant à Monsieur et Madame Arnavon.
De ce premier séjour, Luc, Louise et leurs familles ont commencé à tisser des liens avec la population de Buisson et cela a perduré jusqu'en 1972, année où ils devinrent propriétaires de cette maison.
Comment résumer en quelques lignes plus de quarante ans de présence dans Buisson sans parler de la délicate attention qu'ils avaient d'organiser, chaque année pour le 14 juillet, un apéritif ouvert à toute la population du village où les verres de boissons anisées coulaient à flots.
Photographe passionné, Luc était toujours présent avec son appareil pour immortaliser une animation, un mariage ou un défilé militaire. Je me souviens d'un diaporama organisé un soir d'été sur le mur de l'horloge en présence de nombreuses personnes.
Toujours avenant avec les gens qu'il rencontrait, Luc a été apprécié de tous. Je suis bien placé pour en parler, puisqu'il nous a reçus avec Ghislaine et Vincent en 2004, à Anvers en Belgique, avec autant de convivialité qu'à Buisson.
Depuis quelque temps, sa santé était fragile. Il ne venait plus dans le village en vacances et l'été, sa présence au coin de la place de Verdun, en train de lire au soleil son journal ou un livre, me manquait un peu quand je passais sur cette place. Je m'arrêtais le saluer dès que je pouvais et je saluais en même temps Louise dont la porte m'était toujours ouverte.
Que Louise, Jack, Luce, Érick et toute leur famille trouvent dans ces quelques mots le réconfort dont ils ont bien besoin dans ces moments-là.
Adieu Luc, Buisson ne vous oubliera pas !
Au milieu des années soixante, Luc et Louise Van Braekel, leurs enfants, accompagnés de la famille Seghers, au hasard de la recherche d'une location pour leurs vacances en France, avaient trouvé une maison à Buisson, quartier des Vialles, appartenant à Monsieur et Madame Arnavon.
De ce premier séjour, Luc, Louise et leurs familles ont commencé à tisser des liens avec la population de Buisson et cela a perduré jusqu'en 1972, année où ils devinrent propriétaires de cette maison.
Comment résumer en quelques lignes plus de quarante ans de présence dans Buisson sans parler de la délicate attention qu'ils avaient d'organiser, chaque année pour le 14 juillet, un apéritif ouvert à toute la population du village où les verres de boissons anisées coulaient à flots.
Photographe passionné, Luc était toujours présent avec son appareil pour immortaliser une animation, un mariage ou un défilé militaire. Je me souviens d'un diaporama organisé un soir d'été sur le mur de l'horloge en présence de nombreuses personnes.
Toujours avenant avec les gens qu'il rencontrait, Luc a été apprécié de tous. Je suis bien placé pour en parler, puisqu'il nous a reçus avec Ghislaine et Vincent en 2004, à Anvers en Belgique, avec autant de convivialité qu'à Buisson.
Depuis quelque temps, sa santé était fragile. Il ne venait plus dans le village en vacances et l'été, sa présence au coin de la place de Verdun, en train de lire au soleil son journal ou un livre, me manquait un peu quand je passais sur cette place. Je m'arrêtais le saluer dès que je pouvais et je saluais en même temps Louise dont la porte m'était toujours ouverte.
Que Louise, Jack, Luce, Érick et toute leur famille trouvent dans ces quelques mots le réconfort dont ils ont bien besoin dans ces moments-là.
Adieu Luc, Buisson ne vous oubliera pas !

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
En photos

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
CONNAISSONS-NOUS BIEN NOTRE VILLAGE ?
Avant de dire un dernier adieu à Maman, je tiens d'abord, au nom de Papa et de mes frères et sœurs, à vous remercier d'être ici, si nombreux, pour témoigner votre affection à Maman, et je remercie en particulier nos amis belges qui sont venus d'aussi loin pour manifester leur reconnaissance à celle qui, toute sa vie, a su les accueillir aussi bien. Je remercie également le Père Doumas et Michel Dieu, qui ont bien voulu prendre en charge cette cérémonie, je remercie Claude Poletti et mes amis du Chœur Européen, de leur présence et de leur précieux concours musical.
Nous sommes nombreux, dans cette assistance, à savoir à quel point Maman, toute sa vie, a su donner aux autres et les entourer de ses soins et de son amour. Que ce soit sa famille, ses amis, ses voisins, ses clients ou les habitants du village, nous l'avons tous vue consacrer chaque minute de son temps au bien-être ou à la sécurité des autres, sans relâche, jusqu'à s'user prématurément, en poursuivant son travail jusqu'à un âge où elle aurait pourtant mérité d'avoir une vieillesse tranquille et entourée.
Le meilleur hommage que l'on puisse rendre à Maman, c'est de témoigner de ce qu'a été sa vie. Née à Cairanne, en 1928, dès l'âge de neuf ans, elle perd son père, Adrien Guintrand, boulanger-pâtissier, et doit très tôt se mettre au travail pour aider notre grand-mère, Léa Guintrand, à faire face à ce veuvage qui la laisse seule avec quatre enfants. Et c'est ainsi le point de départ de la longue histoire du souci qu'elle va prendre des autres, pendant les 73 années qui vont suivre.
Ce n'est pas seulement à sa famille qu'elle va se consacrer. Toute sa vie, elle a effectué pratiquement trois journées de travail par 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, et même 366 jours les années bissextiles. Elle s'est occupé de son mari, notre père, de nous, ses six enfants, des travaux des champs, des activités de la paroisse, des bonnes œuvres locales, de ses fleurs, et bien sûr, de ses clients.
Ses clients ! Sans le savoir, Maman a été une pionnière des chambres et tables d'hôtes, et a donné naissance à un grand courant d'amitié et d'amour entre des gens qui auraient eu peu de chance de se rencontrer sans sa cuisine et son sens de l'accueil.
Au tout début des années 60, en plein été, un monsieur se présente à la maison, nous mangions sous la tonnelle. Il a un accent curieux, il est très gêné de nous déranger, mais il formule une demande. « Voilà, je suis belge, et avec ma famille, nous cherchons un logement à louer pour les prochaines vacances ». Il s'appelait Louis Watrin, et ses fils et sa fille se trouvent aujourd'hui parmi nous. Je salue sa mémoire, parce qu'il était lui aussi, sans le savoir, un pionnier des chambres et tables d'hôtes. Après deux séjours comme locataires, les familles Watrin et Berthet-Rayne étaient devenues de plus en plus proches. À la fin du deuxième séjour, Louis demandait alors à Maman : « Tu sais, Marie-Thérèse, on est si bien à ta table, est-ce que l'année prochaine tu pourrais simplement nous louer des chambres et nous faire à manger au lieu de nous louer des appartements ? »
C'était parti, l'année suivante les Watrin revenaient avec les Léonard, Pinchard, Comher, De Smedt, Renward, Gros Jean, Soumagne, et tant d'autres, alors la maison prenait des airs de fête. Maman se plaisait à dire qu'elle comptait plus de 700 habitués et amis de la maison, répartis sur quatre générations. Aujourd'hui la fête se termine, elle a quand même duré 50 ans, mais l'amitié et l'amour sont toujours au rendez-vous. Une fois encore, je vous remercie d'en témoigner par votre présence. Je remercie aussi tout particulièrement Jean-Marie Dusuzeau, pour le vibrant hommage qu'il a rendu à Maman dans un article publié par La Gazette de Villedieu, il y a quatre ans.
Qu'est-ce qu'il me reste à dire, maintenant, sinon merci, merci Maman pour tout ce que tu m'as appris sur la vie, la valeur et le goût du travail bien fait, la passion d'entreprendre, le courage, la persévérance, la reconnaissance et le respect envers ceux qui le méritent, l'amour surtout, l'amour qu'on peut donner, l'amour qu'on peut recevoir, l'amour qu'on peut partager à l'infini.
Maman tenait beaucoup à être inhumée à Villedieu. Elle y avait choisi une concession voilà plusieurs années déjà. À maintes reprises, considérant que c'était à moi de le faire à cause de mon métier, elle m'a demandé de lui faire construire un caveau. Je lui ai toujours répondu que je l'aimais trop pour pouvoir envisager une seule seconde l'idée de la mettre en terre avant que le jour ne soit venu.
Ce jour est arrivé, fatalement, et au terme de plusieurs mois de maladie et de souffrances ses dernières volontés vont s'accomplir puisque son corps va reposer à Villedieu. J'espère que l'autre désir qu'elle a manifesté, de voir la dépouille de son fils, notre frère Jean-François, également ramenée à Villedieu, sera un jour exaucé. Par cet acte qu'elle a choisi, les Berthet-Rayne, émigrés du village voisin en 1956, deviennent enfin, d'une certaine façon, des gens de Villedieu. À partir de ce jour, dirait Georges Brassens, nous devenons des gens de quelque part.
Avant d'accompagner Maman vers cette dernière demeure, je vous invite à vous joindre à moi, par la pensée et par la parole, d'abord pour nous souvenir de son sourire, de son humour, de sa sagesse et de sa bienveillance permanente, ensuite pour lui dire merci, merci Maman, merci Marie-Thérèse, et bienvenue dans la Lumière. »
Nous sommes nombreux, dans cette assistance, à savoir à quel point Maman, toute sa vie, a su donner aux autres et les entourer de ses soins et de son amour. Que ce soit sa famille, ses amis, ses voisins, ses clients ou les habitants du village, nous l'avons tous vue consacrer chaque minute de son temps au bien-être ou à la sécurité des autres, sans relâche, jusqu'à s'user prématurément, en poursuivant son travail jusqu'à un âge où elle aurait pourtant mérité d'avoir une vieillesse tranquille et entourée.
Le meilleur hommage que l'on puisse rendre à Maman, c'est de témoigner de ce qu'a été sa vie. Née à Cairanne, en 1928, dès l'âge de neuf ans, elle perd son père, Adrien Guintrand, boulanger-pâtissier, et doit très tôt se mettre au travail pour aider notre grand-mère, Léa Guintrand, à faire face à ce veuvage qui la laisse seule avec quatre enfants. Et c'est ainsi le point de départ de la longue histoire du souci qu'elle va prendre des autres, pendant les 73 années qui vont suivre.
Ce n'est pas seulement à sa famille qu'elle va se consacrer. Toute sa vie, elle a effectué pratiquement trois journées de travail par 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, et même 366 jours les années bissextiles. Elle s'est occupé de son mari, notre père, de nous, ses six enfants, des travaux des champs, des activités de la paroisse, des bonnes œuvres locales, de ses fleurs, et bien sûr, de ses clients.
Ses clients ! Sans le savoir, Maman a été une pionnière des chambres et tables d'hôtes, et a donné naissance à un grand courant d'amitié et d'amour entre des gens qui auraient eu peu de chance de se rencontrer sans sa cuisine et son sens de l'accueil.
Au tout début des années 60, en plein été, un monsieur se présente à la maison, nous mangions sous la tonnelle. Il a un accent curieux, il est très gêné de nous déranger, mais il formule une demande. « Voilà, je suis belge, et avec ma famille, nous cherchons un logement à louer pour les prochaines vacances ». Il s'appelait Louis Watrin, et ses fils et sa fille se trouvent aujourd'hui parmi nous. Je salue sa mémoire, parce qu'il était lui aussi, sans le savoir, un pionnier des chambres et tables d'hôtes. Après deux séjours comme locataires, les familles Watrin et Berthet-Rayne étaient devenues de plus en plus proches. À la fin du deuxième séjour, Louis demandait alors à Maman : « Tu sais, Marie-Thérèse, on est si bien à ta table, est-ce que l'année prochaine tu pourrais simplement nous louer des chambres et nous faire à manger au lieu de nous louer des appartements ? »
C'était parti, l'année suivante les Watrin revenaient avec les Léonard, Pinchard, Comher, De Smedt, Renward, Gros Jean, Soumagne, et tant d'autres, alors la maison prenait des airs de fête. Maman se plaisait à dire qu'elle comptait plus de 700 habitués et amis de la maison, répartis sur quatre générations. Aujourd'hui la fête se termine, elle a quand même duré 50 ans, mais l'amitié et l'amour sont toujours au rendez-vous. Une fois encore, je vous remercie d'en témoigner par votre présence. Je remercie aussi tout particulièrement Jean-Marie Dusuzeau, pour le vibrant hommage qu'il a rendu à Maman dans un article publié par La Gazette de Villedieu, il y a quatre ans.
Qu'est-ce qu'il me reste à dire, maintenant, sinon merci, merci Maman pour tout ce que tu m'as appris sur la vie, la valeur et le goût du travail bien fait, la passion d'entreprendre, le courage, la persévérance, la reconnaissance et le respect envers ceux qui le méritent, l'amour surtout, l'amour qu'on peut donner, l'amour qu'on peut recevoir, l'amour qu'on peut partager à l'infini.
Maman tenait beaucoup à être inhumée à Villedieu. Elle y avait choisi une concession voilà plusieurs années déjà. À maintes reprises, considérant que c'était à moi de le faire à cause de mon métier, elle m'a demandé de lui faire construire un caveau. Je lui ai toujours répondu que je l'aimais trop pour pouvoir envisager une seule seconde l'idée de la mettre en terre avant que le jour ne soit venu.
Ce jour est arrivé, fatalement, et au terme de plusieurs mois de maladie et de souffrances ses dernières volontés vont s'accomplir puisque son corps va reposer à Villedieu. J'espère que l'autre désir qu'elle a manifesté, de voir la dépouille de son fils, notre frère Jean-François, également ramenée à Villedieu, sera un jour exaucé. Par cet acte qu'elle a choisi, les Berthet-Rayne, émigrés du village voisin en 1956, deviennent enfin, d'une certaine façon, des gens de Villedieu. À partir de ce jour, dirait Georges Brassens, nous devenons des gens de quelque part.
Avant d'accompagner Maman vers cette dernière demeure, je vous invite à vous joindre à moi, par la pensée et par la parole, d'abord pour nous souvenir de son sourire, de son humour, de sa sagesse et de sa bienveillance permanente, ensuite pour lui dire merci, merci Maman, merci Marie-Thérèse, et bienvenue dans la Lumière. »

Marie-Thérèse Berthet-Rayne
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Yolande Pinson, née Fabre, est morte le 21 août 2011. Née en 1929 à Villedieu, elle y a passé toute sa vie comme fille puis comme femme de paysan.
Elle a vécu toute sa vie au même endroit, dans la ferme que ses grands-parents avaient achetée. Sa mère, Berthe Plantevin, s'était mariée à un Mirabellais, Gustave Fabre.
Elle a connu sa première rentrée scolaire aux anciennes écoles, dans le « château », avant d'inaugurer, avec ceux de sa génération, l'école actuelle. Elle avait souffert du décès de son père alors qu'elle n'avait que 13 ans.
En 1947, elle se marie, à 18 ans, avec Carl Pinson, rencontré grâce à un cousin. Né dans les Deux-Sèvres, à Mauzé-sur-le-Mignon, il était arrivé dans notre région par l'engagement dans la résistance après le sabordement de la flotte française à Toulon. Il appartenait au Maquis Ventoux. Yolande Pinson a attendu longtemps pour avoir un enfant, Mireille Straet, fille unique, née en 1968. Elle s'est beaucoup occupée de ses petites filles, Amélie et Manon.
Chacun pouvait la voir, en toute saison, se promener en vélo ou à pied, ce qu'elle aimait par-dessus tout, avec la nature.
Elle a vécu toute sa vie au même endroit, dans la ferme que ses grands-parents avaient achetée. Sa mère, Berthe Plantevin, s'était mariée à un Mirabellais, Gustave Fabre.
Elle a connu sa première rentrée scolaire aux anciennes écoles, dans le « château », avant d'inaugurer, avec ceux de sa génération, l'école actuelle. Elle avait souffert du décès de son père alors qu'elle n'avait que 13 ans.
En 1947, elle se marie, à 18 ans, avec Carl Pinson, rencontré grâce à un cousin. Né dans les Deux-Sèvres, à Mauzé-sur-le-Mignon, il était arrivé dans notre région par l'engagement dans la résistance après le sabordement de la flotte française à Toulon. Il appartenait au Maquis Ventoux. Yolande Pinson a attendu longtemps pour avoir un enfant, Mireille Straet, fille unique, née en 1968. Elle s'est beaucoup occupée de ses petites filles, Amélie et Manon.
Chacun pouvait la voir, en toute saison, se promener en vélo ou à pied, ce qu'elle aimait par-dessus tout, avec la nature.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
En photos

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
PATCHWORK
Le « gibassié » est ainsi appelé, car à sa sortie du four, il est recouvert de petites bosses appelées gibes en provençal. C'est la fameuse « pompe de Noël » qui trône au milieu des treize desserts traditionnels.
Pour ne pas être ce que l'on appelle un « estouffe crestian », il doit être confectionné avec la fine fleur de la farine, la meilleure huile d'olive, de la cassonade et parfumé de fleur d'oranger. Il doit être percé de cinq trous ou fentes, représentant les cinq doigts de la main, symbole du travail.
Pour huit personnes :
– 400 grammes de farine.
– 150 grammes de sucre roux en poudre.
– 150 grammes d'huile d'olive.
– 20 grammes de levure.
– 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger.
Faites une boule de pâte homogène en mélangeant et en pétrissant la farine avec le sucre, l'huile d'olive, la levure et l'eau de fleur d'oranger.
Étalez la pâte en forme de disque au rouleau à pâtisserie, posez sur une plaque. Faites cinq trous avec un emporte-pièce ou cinq fentes avec une raclette de pâtissier et laissez reposer au moins deux heures.
Cuisez dans un four à 200° (th.7) pendant une bonne demi-heure. Le dessus va se bosseler et va prendre une belle couleur miel-foncé. Retirez du four et laissez refroidir.
Pour servir, partagez en morceaux avec les mains, n’utilisez jamais de couteau, c'est la tradition !
C'est une recette tirée du livre Les trésors de la cuisine provençale de Robert Monetti.
Régalez-vous et joyeux Noël à tous !
Pour ne pas être ce que l'on appelle un « estouffe crestian », il doit être confectionné avec la fine fleur de la farine, la meilleure huile d'olive, de la cassonade et parfumé de fleur d'oranger. Il doit être percé de cinq trous ou fentes, représentant les cinq doigts de la main, symbole du travail.
Pour huit personnes :
– 400 grammes de farine.
– 150 grammes de sucre roux en poudre.
– 150 grammes d'huile d'olive.
– 20 grammes de levure.
– 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger.
Faites une boule de pâte homogène en mélangeant et en pétrissant la farine avec le sucre, l'huile d'olive, la levure et l'eau de fleur d'oranger.
Étalez la pâte en forme de disque au rouleau à pâtisserie, posez sur une plaque. Faites cinq trous avec un emporte-pièce ou cinq fentes avec une raclette de pâtissier et laissez reposer au moins deux heures.
Cuisez dans un four à 200° (th.7) pendant une bonne demi-heure. Le dessus va se bosseler et va prendre une belle couleur miel-foncé. Retirez du four et laissez refroidir.
Pour servir, partagez en morceaux avec les mains, n’utilisez jamais de couteau, c'est la tradition !
C'est une recette tirée du livre Les trésors de la cuisine provençale de Robert Monetti.
Régalez-vous et joyeux Noël à tous !

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Une soirée Cabaret à Villedieu ?
Quand ? Le vendredi 16 mars 2012 à 20 heures 30.
Où ? À la salle Pierre Bertrand.
Pourquoi ? Imaginons que ce soir-là la télévision soit en panne.
Que faire ? Et si on se réunissait, comme autrefois, entre voisins pour passer un bon moment : « Moi j'ai une histoire à vous raconter ! Et toi tu ne veux pas nous chanter quelque chose ? »
Donc, chacun est invité à venir participer ou écouter ou présenter qui, un sketch, qui une chanson, qui un numéro de domptage de girafe, lecture, poème, musique, magie, cirque, danse, etc.
Tout est bienvenu. Cette soirée se veut sous le signe de l'humour et du plaisir d'être ensemble.
Comment ? Les numéros sont à géométrie variable : seul, à deux ou à plusieurs.
Et ceci dans un temps limité (maximum 5 minutes) pour que chacun puisse s'exprimer et revenir sur scène pour un autre numéro.
Vous pouvez nous dire ce que vous prévoyez pour faciliter l'organisation, mais l'improvisation de dernière minute est aussi la bienvenue.
Pour tout renseignement, information ou inscription, vous pouvez vous adresser à Nathalie Berrez au 06 07 90 95 50.
Vous avez tout l'hiver pour vous préparer !
P.S. : Non seulement nous pourrons chanter, danser, nous amuser, mais aussi grignoter et ... « Boire un p'tit coup, c'est agréable ! »
Quand ? Le vendredi 16 mars 2012 à 20 heures 30.
Où ? À la salle Pierre Bertrand.
Pourquoi ? Imaginons que ce soir-là la télévision soit en panne.
Que faire ? Et si on se réunissait, comme autrefois, entre voisins pour passer un bon moment : « Moi j'ai une histoire à vous raconter ! Et toi tu ne veux pas nous chanter quelque chose ? »
Donc, chacun est invité à venir participer ou écouter ou présenter qui, un sketch, qui une chanson, qui un numéro de domptage de girafe, lecture, poème, musique, magie, cirque, danse, etc.
Tout est bienvenu. Cette soirée se veut sous le signe de l'humour et du plaisir d'être ensemble.
Comment ? Les numéros sont à géométrie variable : seul, à deux ou à plusieurs.
Et ceci dans un temps limité (maximum 5 minutes) pour que chacun puisse s'exprimer et revenir sur scène pour un autre numéro.
Vous pouvez nous dire ce que vous prévoyez pour faciliter l'organisation, mais l'improvisation de dernière minute est aussi la bienvenue.
Pour tout renseignement, information ou inscription, vous pouvez vous adresser à Nathalie Berrez au 06 07 90 95 50.
Vous avez tout l'hiver pour vous préparer !
P.S. : Non seulement nous pourrons chanter, danser, nous amuser, mais aussi grignoter et ... « Boire un p'tit coup, c'est agréable ! »
Le comité de rédaction de La Gazette 73, après enquête, a pu remettre de l’ordre dans la famille « Cadew » et a attribué les bons surnoms aux bons noms. En revanche, il n’a toujours pas retrouvé Blanche Neige !
 |  |  |  |
Jérémy Dieu alias Cadew 3/4 | Martial Arnaud alias Cadew Cadew | Arnaud Faucher alias Cadew Fifou | Julien Bertrand alias Cadew Plastou |
 |  |  | |
Simon Tardieu alias Cadew Grognon | Thibault Paris alias Cadew Dudule | Timmy Fauque alias Cadew Sexy |
Charles Esparnac, fils d'une famille du sud-ouest de la France, s'est établi dans la Chine lointaine afin d'y faire fortune dans le commerce de la soie, du thé et de la porcelaine.
Il s'installe à Shanghai, dans la concession française et persuade Joseph Liu de lui faire confiance. Il achète une jonque et avec son équipage il remonte le Yangzi en espérant ne pas tomber sur des pirates.
Très vite, Charles accumule les succès et se retrouve à la tête d'un petit empire. Pour asseoir sa position, il lui faut prendre femme et fonder une famille.
Il demande alors à sa mère de choisir pour lui une jeune femme française et c'est ainsi qu'Olympe de Crozes débarque à Shanghai, après des semaines de voyage, sans rien connaître de son futur époux ni de ce pays lointain et mystérieux.
Tout semble réussir à ce Français entreprenant, mais le passé caché de Charles va le rattraper.
Ce livre d'aventure et d'amour transporte le lecteur à l'autre bout du monde à la fin du XIXe siècle.
Les descriptions, les odeurs et les bruits de cette cité asiatique nous plongent dans un dépaysement total.
Ce livre est à découvrir sans tarder à la bibliothèque Mauric où il vous est proposé dans sa version large vision.
Shanghai club, Jacques Baudoin, Éd. V.D.B.
Il s'installe à Shanghai, dans la concession française et persuade Joseph Liu de lui faire confiance. Il achète une jonque et avec son équipage il remonte le Yangzi en espérant ne pas tomber sur des pirates.
Très vite, Charles accumule les succès et se retrouve à la tête d'un petit empire. Pour asseoir sa position, il lui faut prendre femme et fonder une famille.
Il demande alors à sa mère de choisir pour lui une jeune femme française et c'est ainsi qu'Olympe de Crozes débarque à Shanghai, après des semaines de voyage, sans rien connaître de son futur époux ni de ce pays lointain et mystérieux.
Tout semble réussir à ce Français entreprenant, mais le passé caché de Charles va le rattraper.
Ce livre d'aventure et d'amour transporte le lecteur à l'autre bout du monde à la fin du XIXe siècle.
Les descriptions, les odeurs et les bruits de cette cité asiatique nous plongent dans un dépaysement total.
Ce livre est à découvrir sans tarder à la bibliothèque Mauric où il vous est proposé dans sa version large vision.
Shanghai club, Jacques Baudoin, Éd. V.D.B.
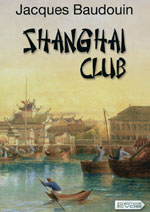
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Samedi 10 décembre, nous étions invités à écouter le concert donné par l'École intercommunale de musique à la Maison Garcia.
À dix-huit heures, la salle était pleine, il n'y avait pas assez de places assises pour tout le monde. De nombreuses personnes sont restées debout pendant la représentation.
Nous avons voyagé dans le temps, de Strauss à nos jours, en passant par les tubes des Beatles, de Michael Jackson, de Dave Brubeck, sans oublier le negro spiritual et les musiques de film.
Il y avait une grande diversité d'instruments : violons, piano, flûtes, trompettes, clarinettes, guitares. Les chœurs ainsi que les orchestres étaient composés d’élèves de tous âges qui nous ont offert une très agréable soirée.
Naturellement, les parents et grands-parents étaient très fiers des progrès de leurs enfants.
École intercommunale - Renseignements et inscriptions :
Copavo, avenue Gabriel Péri,
BP 90, 84110 Vaison-la-Romaine.
Permanence le mercredi au centre Escapade,
salle D2, de 10h à 12h et de 14h à 18h,
tél. 04 90 36 04 95.
À dix-huit heures, la salle était pleine, il n'y avait pas assez de places assises pour tout le monde. De nombreuses personnes sont restées debout pendant la représentation.
Nous avons voyagé dans le temps, de Strauss à nos jours, en passant par les tubes des Beatles, de Michael Jackson, de Dave Brubeck, sans oublier le negro spiritual et les musiques de film.
Il y avait une grande diversité d'instruments : violons, piano, flûtes, trompettes, clarinettes, guitares. Les chœurs ainsi que les orchestres étaient composés d’élèves de tous âges qui nous ont offert une très agréable soirée.
Naturellement, les parents et grands-parents étaient très fiers des progrès de leurs enfants.
École intercommunale - Renseignements et inscriptions :
Copavo, avenue Gabriel Péri,
BP 90, 84110 Vaison-la-Romaine.
Permanence le mercredi au centre Escapade,
salle D2, de 10h à 12h et de 14h à 18h,
tél. 04 90 36 04 95.
En photos...

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
Une « attraction » et le reste est facile | Les Blancs jouent. Le plus dur est le « coup silencieux » |
 | 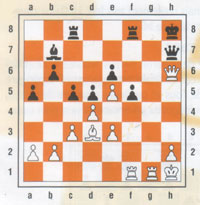 |
Se dis que, la niue de Nouvè, li bèsti parlon. Vaqui ço qu'ai trouva dins un vièi armana1.
Èro une niue de Nouvè. Lou Firmin e sa femo Jano, que restavon dins uno granjo en deforo dÓu vilage, èron ana à la messo de miejo-niue. La messo acabado, la sorre de Jano ié diguè : « D'abord que devès veni manja à l'oustau deman, perqué restarias pas coucha ? Vous espargnarié lou camin. » Firmin respoundiguè : « Se Jano vòu resta, que reste, iéu m'entournarai à la granjo : me fau deman matin apastura li bèsti. » Ansin faguèron e Firmin prenguè lou camin de soun oustau.
Au bout d'un moumen i'arrivè e, coume passavo davans l'estable, ié semblè entèndre de voues, se diguè : « Sara quàuqui barrulaire que se saran assousta2 eici. Ai rèn contro, mai voudriéu pas que meteguesson lou fiò o que me raubesson3 moun biòu o moun ase. » Anavo durbi la porto quand coumprenguè ço que se disié. N'en restè estabousi4 e s'aplantè5 pèr miéu entèndre. Èro lou biòu que disié au pichot ase :
– Pichot, s'as pas trop som6, te vau counta uno istòri.
– Parlo, respoundiguè l'asenoun.
– Vaqui. Sabes belèu qu'aquesto niue es Nouvè e que, i'a bèn de siècle, dins uno niue pariero e dins un estable coume lou nostre, à Betelèn neissiguè un enfant qu'èro lou Fiéu de Diéu ?
– Lou sabe, diguè lou pichot ase.
– Mai ço que sabes belèu pas, es ço que se passè pièi. Marìo, la jouino maire avié gi trouva de plaço en liò7 dins un oustau, e pousquè soulamen s'assousta dins l'estable pèr metre au mounde soun pichot. Assajè de l'acata8 coume poudié, mai avié pas grand causo e l'enfant tremoulavo9 de la fré. Em'elo i'avié sou nome, JÓusè, e l'ase que l'avié aducho enjusco à Betelèn. Mai de que poudien faire ?
Tout-à-n-un-cop, venguè une idèio au biòu (li biòu an mai d'idèio que lis ase), diguè à l'ase : « Se nous metian à boufa sus lou pichot, noste alen lou rescaufarié belèu. » L'ase diguè pas de noun e li vaqui tÓuti dous à boufa coume d'alabremo10 sus l'enfantoun. D'efèt, au bout d'un moumen, l'enfant trepoulè plus e sa pèu prenguè coulour. Enterin11, li bergié, averti pèr lis ange, avien fini pèr arriva. Un d'entre éli avié adu uno pèu de moutoun e n'acatè l'enfant qu'ansin aurié plus fre. Quand li bergié fuguèron parti, Marìo diguè : « Bràvi bèsti ! Voste alen a empacha moun enfant d'aganta lou mau de la mort. Vous n'en sarai toujour recouneissènto. Aussi pèr vous recoumpensa vau demanda à Diéu, lou paire de moun Fiéu, de vous permetre de parla coume lis ome, tÓuti lis an, à l'anniversàri d'aquelo niue » E ansin sieguè.
Aussi, nous àutri li biòu, sian bèn fièr d'acò e, despièi aquelo niue, nòsti paire nous l'ensignon. Vous àutri, lis ase, proufitès d'aquel avantage, meme s'es pas vous qu'avès agu l'idèio.
L'asenoun respoundiguè :
– Tout acò lou sabiéu, ma maire me lou diguè avans que me menesson à la fiero pèr me vèndre. Mai, toun biòu de Betelèn restè dins soun estable ; l'ase, éu, quand Erodo vouguè faire mouri l'enfant, acoumpagnè JÓusè en Egito, ié pourtè la maire e lou pichot e li reduguè12 à Nazaret quand Erodo fuguè mort. A Nazaret, l'ase aguè de pichot asenoun. Es un de si descendènt qu'a guè l'ounour de pourta Jèsus quand intrè dins Jerusalèn pèr li Rampau13 saluda coume un rèi. Vesès que iéu tambèn poudriéu aguè ourguei de mis àvi14.
Lou biòu trouvè plus rèn à dire e s'endourmiguèron tÓuti dous. Firmin, tambèn s'anè vite empaia, qu'èro jala, mai éu, pousquè pas dourmi. Lou vièi armana eisisto plus. E i'a plus d'ase ni de biòu dins nòsti vilage. Aussi, poudres pas verifica se li bèsti parlon encaro la niue de Nouvè.
1- armana : almanach
2- sousto, assousta : abri, abriter
3- rauba : voler
4- estabousi : stupéfait
5- s'aplanta : s'arrêter
6- som : sommeil
7- en lio : nulle part
8- acata : couvrir
9- tremoula : trembler
10- alabremo : salamandre
11- enterin : pendant que
12- redurre : ramener
13- Rampau : Rameaux
14- àvi : aïeux
Èro une niue de Nouvè. Lou Firmin e sa femo Jano, que restavon dins uno granjo en deforo dÓu vilage, èron ana à la messo de miejo-niue. La messo acabado, la sorre de Jano ié diguè : « D'abord que devès veni manja à l'oustau deman, perqué restarias pas coucha ? Vous espargnarié lou camin. » Firmin respoundiguè : « Se Jano vòu resta, que reste, iéu m'entournarai à la granjo : me fau deman matin apastura li bèsti. » Ansin faguèron e Firmin prenguè lou camin de soun oustau.
Au bout d'un moumen i'arrivè e, coume passavo davans l'estable, ié semblè entèndre de voues, se diguè : « Sara quàuqui barrulaire que se saran assousta2 eici. Ai rèn contro, mai voudriéu pas que meteguesson lou fiò o que me raubesson3 moun biòu o moun ase. » Anavo durbi la porto quand coumprenguè ço que se disié. N'en restè estabousi4 e s'aplantè5 pèr miéu entèndre. Èro lou biòu que disié au pichot ase :
– Pichot, s'as pas trop som6, te vau counta uno istòri.
– Parlo, respoundiguè l'asenoun.
– Vaqui. Sabes belèu qu'aquesto niue es Nouvè e que, i'a bèn de siècle, dins uno niue pariero e dins un estable coume lou nostre, à Betelèn neissiguè un enfant qu'èro lou Fiéu de Diéu ?
– Lou sabe, diguè lou pichot ase.
– Mai ço que sabes belèu pas, es ço que se passè pièi. Marìo, la jouino maire avié gi trouva de plaço en liò7 dins un oustau, e pousquè soulamen s'assousta dins l'estable pèr metre au mounde soun pichot. Assajè de l'acata8 coume poudié, mai avié pas grand causo e l'enfant tremoulavo9 de la fré. Em'elo i'avié sou nome, JÓusè, e l'ase que l'avié aducho enjusco à Betelèn. Mai de que poudien faire ?
Tout-à-n-un-cop, venguè une idèio au biòu (li biòu an mai d'idèio que lis ase), diguè à l'ase : « Se nous metian à boufa sus lou pichot, noste alen lou rescaufarié belèu. » L'ase diguè pas de noun e li vaqui tÓuti dous à boufa coume d'alabremo10 sus l'enfantoun. D'efèt, au bout d'un moumen, l'enfant trepoulè plus e sa pèu prenguè coulour. Enterin11, li bergié, averti pèr lis ange, avien fini pèr arriva. Un d'entre éli avié adu uno pèu de moutoun e n'acatè l'enfant qu'ansin aurié plus fre. Quand li bergié fuguèron parti, Marìo diguè : « Bràvi bèsti ! Voste alen a empacha moun enfant d'aganta lou mau de la mort. Vous n'en sarai toujour recouneissènto. Aussi pèr vous recoumpensa vau demanda à Diéu, lou paire de moun Fiéu, de vous permetre de parla coume lis ome, tÓuti lis an, à l'anniversàri d'aquelo niue » E ansin sieguè.
Aussi, nous àutri li biòu, sian bèn fièr d'acò e, despièi aquelo niue, nòsti paire nous l'ensignon. Vous àutri, lis ase, proufitès d'aquel avantage, meme s'es pas vous qu'avès agu l'idèio.
L'asenoun respoundiguè :
– Tout acò lou sabiéu, ma maire me lou diguè avans que me menesson à la fiero pèr me vèndre. Mai, toun biòu de Betelèn restè dins soun estable ; l'ase, éu, quand Erodo vouguè faire mouri l'enfant, acoumpagnè JÓusè en Egito, ié pourtè la maire e lou pichot e li reduguè12 à Nazaret quand Erodo fuguè mort. A Nazaret, l'ase aguè de pichot asenoun. Es un de si descendènt qu'a guè l'ounour de pourta Jèsus quand intrè dins Jerusalèn pèr li Rampau13 saluda coume un rèi. Vesès que iéu tambèn poudriéu aguè ourguei de mis àvi14.
Lou biòu trouvè plus rèn à dire e s'endourmiguèron tÓuti dous. Firmin, tambèn s'anè vite empaia, qu'èro jala, mai éu, pousquè pas dourmi. Lou vièi armana eisisto plus. E i'a plus d'ase ni de biòu dins nòsti vilage. Aussi, poudres pas verifica se li bèsti parlon encaro la niue de Nouvè.
1- armana : almanach
2- sousto, assousta : abri, abriter
3- rauba : voler
4- estabousi : stupéfait
5- s'aplanta : s'arrêter
6- som : sommeil
7- en lio : nulle part
8- acata : couvrir
9- tremoula : trembler
10- alabremo : salamandre
11- enterin : pendant que
12- redurre : ramener
13- Rampau : Rameaux
14- àvi : aïeux
Voici la traduction du texte de Paulette Mathieu, paru en provençal dans La Gazette nº 72.
Dans ma jeunesse (il y a bien des années), il n'y avait guère d'autos à Villedieu. Je me souviens de celle de Laurent Marin qui avait une capote de toile et je n'en suis pas sûre, mais je crois bien que les vitres étaient en « mica ». Comment elle était immatriculée ? Je ne le sais pas. Par contre, celle du père Reynier portait sur sa plaque « V 2 » (rien à voir avec la bombe volante allemande). Cela était probablement le premier marquage des voitures dès qu'elles furent assez nombreuses pour être cataloguées. Ceux qui imaginèrent le marquage ne se cassèrent pas la tête : ils prirent la liste des départements, tous ceux qui commençaient par un « A » furent marqués par cette lettre suivie d'un numéro : Ain = A 1, Allier = A 2, etc., pareil pour « B », « C »… Quand ils arrivèrent à la lettre « V », il y avait le Var = V 1, le Vaucluse = V 2…
Voilà pourquoi Reynier qui n'avait jamais changé sa décapotable (même le moteur n'avait pas de capot) garda son matricule jusqu'à la fin. Il s'en servait encore un peu après la guerre de 39 (on l'appelait le « teuf-teuf » et on l'entendait venir de deux kilomètres), alors que les autos avaient sur leurs plaques « ZA » pour Vaucluse, « CA » pour Bouches-du-Rhône, etc.. Maintenant, les plaques ont encore changé, mais cette fois, elles feront comme celles de Reynier, elles resteront les mêmes tant que la voiture tiendra le coup. Elles ne devraient pas devenir aussi vieilles que le « teuf-teuf », la mécanique de maintenant n'est pas aussi solide que celle d'il y a cent ans. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet engin quasi « préhistorique », il aurait mérité de figurer dans un musée.
Heureusement, ils ont quand même gardé dans un coin le numéro du département. Cela nous permet de dire : « C'est encore un 75 qui va comme un fou ! ». Pourtant, pour dire cela, il faudra avoir le temps de lire le chiffre : on nous dit parfois que la police a collé un P.V. à quelqu'un qui roulait à plus de 200 à l'heure.
À l'époque où les autos étaient encore marquées de « A 1 » à « Y 1 » (l'Yonne et les Yvelines n'existaient pas), il y avait bien quelques poules ou chiens écrasés, des voitures qui faisaient la cabriole dans un fossé ou une rivière, d'autres qui piquaient du nez dans un arbre, un mur ou un autre engin… Mais sûrement, le nombre de morts ne pouvait pas se comparer à celui de maintenant.
Il y avait encore, jusqu'à la Seconde Guerre, beaucoup de gens qui avaient seulement une « jardinière » (ou leurs pieds) pour se déplacer. Nous allâmes, une fois, voir jouer Faust au Théâtre antique de Vaison-la-Romaine avec la « jardinière » de Baptistin. Nous étions six, les deux jeunes étions derrière, sur des chaises que nous avancions ou reculions, quand la route montait ou descendait, pour maintenir le centre de gravité.
Les jeunes, eux, avaient des bicyclettes. Ils pouvaient circuler tranquilles sur les routes. Je me souviens d'avoir rencontré, un dimanche, seulement quatre autos entre Villedieu et Avignon. Il faut dire que c'était la guerre et qu'il n'y avait que les médecins qui pouvaient se déplacer en voiture ce jour-là. En ce temps-là, ils se déplaçaient même le dimanche, maintenant…
Si vous avez plus de 70 ans, vous devez vous rappeler d'Arnaud « le bucheron » qui avait un gazogène : pendant la guerre, il n'y avait guère d'essence, les « gazo », eux, marchaient au bois (ou peut-être au charbon de bois, je ne sais pas trop), mais il leur fallait du temps pour pouvoir démarrer. Arnaud garait son engin devant les remparts et commençait à l'allumer à cinq heures du matin. Cela faisait un bruit d'enfer : il ne fallait plus compter dormir. Quand il le croyait prêt, il partait à la descente ; cela marchait tant que la route était en pente, mais, dès qu'il arrivait sur le plat, ça s'arrêtait et Arnaud, de colère, se rongeait tellement les poings qu'il en avait de la corne sur les doigts.
Actuellement, nous nous plaignons de ce que l'essence est chère, pourtant il n'y a jamais eu autant de voitures partout, même devant les panneaux de stationnement interdit. Si cela dure et croît, nous faudra-t-il revenir aux véhicules d'autrefois ? Malheureusement, en dehors des bicyclettes, qu'on peut trouver facilement, les « jardinières », les chevaux et les mulets ont disparu de la circulation… C'est le cas de le dire.
Dans ma jeunesse (il y a bien des années), il n'y avait guère d'autos à Villedieu. Je me souviens de celle de Laurent Marin qui avait une capote de toile et je n'en suis pas sûre, mais je crois bien que les vitres étaient en « mica ». Comment elle était immatriculée ? Je ne le sais pas. Par contre, celle du père Reynier portait sur sa plaque « V 2 » (rien à voir avec la bombe volante allemande). Cela était probablement le premier marquage des voitures dès qu'elles furent assez nombreuses pour être cataloguées. Ceux qui imaginèrent le marquage ne se cassèrent pas la tête : ils prirent la liste des départements, tous ceux qui commençaient par un « A » furent marqués par cette lettre suivie d'un numéro : Ain = A 1, Allier = A 2, etc., pareil pour « B », « C »… Quand ils arrivèrent à la lettre « V », il y avait le Var = V 1, le Vaucluse = V 2…
Voilà pourquoi Reynier qui n'avait jamais changé sa décapotable (même le moteur n'avait pas de capot) garda son matricule jusqu'à la fin. Il s'en servait encore un peu après la guerre de 39 (on l'appelait le « teuf-teuf » et on l'entendait venir de deux kilomètres), alors que les autos avaient sur leurs plaques « ZA » pour Vaucluse, « CA » pour Bouches-du-Rhône, etc.. Maintenant, les plaques ont encore changé, mais cette fois, elles feront comme celles de Reynier, elles resteront les mêmes tant que la voiture tiendra le coup. Elles ne devraient pas devenir aussi vieilles que le « teuf-teuf », la mécanique de maintenant n'est pas aussi solide que celle d'il y a cent ans. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet engin quasi « préhistorique », il aurait mérité de figurer dans un musée.
Heureusement, ils ont quand même gardé dans un coin le numéro du département. Cela nous permet de dire : « C'est encore un 75 qui va comme un fou ! ». Pourtant, pour dire cela, il faudra avoir le temps de lire le chiffre : on nous dit parfois que la police a collé un P.V. à quelqu'un qui roulait à plus de 200 à l'heure.
À l'époque où les autos étaient encore marquées de « A 1 » à « Y 1 » (l'Yonne et les Yvelines n'existaient pas), il y avait bien quelques poules ou chiens écrasés, des voitures qui faisaient la cabriole dans un fossé ou une rivière, d'autres qui piquaient du nez dans un arbre, un mur ou un autre engin… Mais sûrement, le nombre de morts ne pouvait pas se comparer à celui de maintenant.
Il y avait encore, jusqu'à la Seconde Guerre, beaucoup de gens qui avaient seulement une « jardinière » (ou leurs pieds) pour se déplacer. Nous allâmes, une fois, voir jouer Faust au Théâtre antique de Vaison-la-Romaine avec la « jardinière » de Baptistin. Nous étions six, les deux jeunes étions derrière, sur des chaises que nous avancions ou reculions, quand la route montait ou descendait, pour maintenir le centre de gravité.
Les jeunes, eux, avaient des bicyclettes. Ils pouvaient circuler tranquilles sur les routes. Je me souviens d'avoir rencontré, un dimanche, seulement quatre autos entre Villedieu et Avignon. Il faut dire que c'était la guerre et qu'il n'y avait que les médecins qui pouvaient se déplacer en voiture ce jour-là. En ce temps-là, ils se déplaçaient même le dimanche, maintenant…
Si vous avez plus de 70 ans, vous devez vous rappeler d'Arnaud « le bucheron » qui avait un gazogène : pendant la guerre, il n'y avait guère d'essence, les « gazo », eux, marchaient au bois (ou peut-être au charbon de bois, je ne sais pas trop), mais il leur fallait du temps pour pouvoir démarrer. Arnaud garait son engin devant les remparts et commençait à l'allumer à cinq heures du matin. Cela faisait un bruit d'enfer : il ne fallait plus compter dormir. Quand il le croyait prêt, il partait à la descente ; cela marchait tant que la route était en pente, mais, dès qu'il arrivait sur le plat, ça s'arrêtait et Arnaud, de colère, se rongeait tellement les poings qu'il en avait de la corne sur les doigts.
Actuellement, nous nous plaignons de ce que l'essence est chère, pourtant il n'y a jamais eu autant de voitures partout, même devant les panneaux de stationnement interdit. Si cela dure et croît, nous faudra-t-il revenir aux véhicules d'autrefois ? Malheureusement, en dehors des bicyclettes, qu'on peut trouver facilement, les « jardinières », les chevaux et les mulets ont disparu de la circulation… C'est le cas de le dire.

Une jardinière

Un gazogène
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
À SCOTCHER SUR LE FRIGO
Conseil municipal
Mercredi 21 décembre 2011 à 20 h 30
Mairie
Les vœux du maire
Vendredi 6 janvier 2012 à 18 h 00
Maison Garcia
Les vœux de la Copavo
Lundi 9 janvier 2012 à 18 h 00
à la Copavo
Loto de la Société de Lecture Dimanche 15 janvier 2012 à 16 h 30
Maison Garcia
Assemblée générale du Club des aînés
Jeudi 19 janvier 2012 l’après-midi
Salle Pierre Bertrand
Conseil municipal
Jeudi 19 janvier 2012 à 20 h 30
Mairie
Loto de La Gazette
Samedi 28 janvier 2012 à 16 h 30
Maison Garcia
Le loto sera suivi d’un repas
Assemblée générale du Comité des fêtes
Mercredi 1er février 2012 à 20 h 30
Salle Pierre Bertrand
Assemblée générale des Ringards
Samedi 4 février 2012 l’après-midi
Salle Pierre Bertrand
Conférence sur l’Inde par Françoise Tercerie
Samedi 11 février 2012 à 17 h 00
Salle Pierre Bertrand
Assemblée générale de La Gazette
Mercredi 22 février 2012 à 20 h 30
Salle Pierre Bertrand
Soirée Cabaret « Les Remparts s’amusent »
Vendredi 16 mars 2012 à 20 h 30
Salle Pierre Bertrand
Les cours ont lieu au nouveau lycée à 18 h 00
5, 10 ou 20 €, selon vos possibilités pour l’année
Musique
Jeudi 26 janvier 2012
« La méthode Tomatis ou l’éducation de l’écoute » par Madame Varanfrain
Mardi 3 avril 2012
« La voix humaine » par Katharina Rikus
Philosophie
Lundi 9 janvier 2012
Michel Onfray
Antoine Abou
Lundi 6 février 2012
Michel Serres
Économie
Mardi 17 janvier 2012
« Une économie sociale et solidaire : une réponse à la crise » par Jean Gatel, ancien ministre
À compter de janvier 2012, la bibliothèque sera ouverte uniquement le dimanche de 10 h à 12 h.
Nouveautés à la bibliothèque Mauric
Les romans :
– Le mas des tilleuls de Françoise Bourdon
– Marie Blanche de Jim Fergus
– L'équation africaine de Yasmina Khadra
– Marina de Carlos Ruiz Zafon
– La femme au miroir d'E.-E. Schmitt
– Du domaine des murmures de C. Martinez
– La fille de papier de Guillaume Musso
Prix Goncourt 2011 :
– L'art français de la guerre d'Alexis Jenni
Les policiers :
– L'été de toutes les peurs de M.-J. Clark
– Le passager de Jean-Christophe Grangé
– L'armée furieuse de Fred Vargas
Mercredi 21 décembre 2011 à 20 h 30
Mairie
Les vœux du maire
Vendredi 6 janvier 2012 à 18 h 00
Maison Garcia
Les vœux de la Copavo
Lundi 9 janvier 2012 à 18 h 00
à la Copavo
Loto de la Société de Lecture Dimanche 15 janvier 2012 à 16 h 30
Maison Garcia
Assemblée générale du Club des aînés
Jeudi 19 janvier 2012 l’après-midi
Salle Pierre Bertrand
Conseil municipal
Jeudi 19 janvier 2012 à 20 h 30
Mairie
Loto de La Gazette
Samedi 28 janvier 2012 à 16 h 30
Maison Garcia
Le loto sera suivi d’un repas
Assemblée générale du Comité des fêtes
Mercredi 1er février 2012 à 20 h 30
Salle Pierre Bertrand
Assemblée générale des Ringards
Samedi 4 février 2012 l’après-midi
Salle Pierre Bertrand
Conférence sur l’Inde par Françoise Tercerie
Samedi 11 février 2012 à 17 h 00
Salle Pierre Bertrand
Assemblée générale de La Gazette
Mercredi 22 février 2012 à 20 h 30
Salle Pierre Bertrand
Soirée Cabaret « Les Remparts s’amusent »
Vendredi 16 mars 2012 à 20 h 30
Salle Pierre Bertrand
Université pour tous
Vaison-la-Romaine
Les cours ont lieu au nouveau lycée à 18 h 00
5, 10 ou 20 €, selon vos possibilités pour l’année
Musique
Jeudi 26 janvier 2012
« La méthode Tomatis ou l’éducation de l’écoute » par Madame Varanfrain
Mardi 3 avril 2012
« La voix humaine » par Katharina Rikus
Philosophie
Lundi 9 janvier 2012
Michel Onfray
Antoine Abou
Lundi 6 février 2012
Michel Serres
Économie
Mardi 17 janvier 2012
« Une économie sociale et solidaire : une réponse à la crise » par Jean Gatel, ancien ministre
Bibliothèque Mauric
À compter de janvier 2012, la bibliothèque sera ouverte uniquement le dimanche de 10 h à 12 h.
Nouveautés à la bibliothèque Mauric
Les romans :
– Le mas des tilleuls de Françoise Bourdon
– Marie Blanche de Jim Fergus
– L'équation africaine de Yasmina Khadra
– Marina de Carlos Ruiz Zafon
– La femme au miroir d'E.-E. Schmitt
– Du domaine des murmures de C. Martinez
– La fille de papier de Guillaume Musso
Prix Goncourt 2011 :
– L'art français de la guerre d'Alexis Jenni
Les policiers :
– L'été de toutes les peurs de M.-J. Clark
– Le passager de Jean-Christophe Grangé
– L'armée furieuse de Fred Vargas
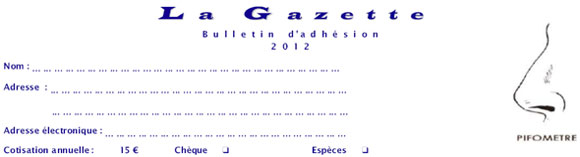
>>> Pour adhérer cliquez là <<<
Le bulletin d'adhésion peut-être déposé au bar, posté à La Gazette, BP 5, 84110 Villedieu ou donné à un membre de l’association.
Le bulletin d'adhésion peut-être déposé au bar, posté à La Gazette, BP 5, 84110 Villedieu ou donné à un membre de l’association.
La Gazette - périodique d'informations villadéennes (surtout), cantonales, nationales et mondiales
N°73 - 16 décembre 2011 - parution et pagination irrégulières - BP5 - 84110 Villedieu
Site internet : www.lagazettedevilledieu.com - adresse électronique : contact@lagazettedevilledieu.com
Comité éditorial : Mireille Dieu, Eliane Joyez, Michèle Mison, Brigitte Rochas, Olivier Sac.