Pour ou contre la mousse ?
Plusieurs grands débats ont animé la vie nationale depuis plusieurs mois : pour ou contre la guerre en Irak, la réforme des retraites, la décentralisation,... Ce dimanche 6 juillet, les Corses se prononcent par référendum sur le statut de leur île.
Ne reculant devant aucune question brûlante et importante, et en attendant que les nouvelles lois de décentralisation permettent un référendum local sur la question, La Gazette lance un sondage auprès des Villadéens : Pour ou contre la mousse sur la fontaine ?
Il s’agit là d’un sujet sensible, qui touche au patrimoine, au paysage, au sentiment de la beauté, au souci de l’hygiène et on ne saurait négliger une question aussi importante !
Une pré-enquête m’a montré pour l’instant quatre réactions. Il y a les "pour" : souci esthétique et valorisation du naturel, références aux fontaines moussues de Salon et Aix... Il y a les "contre" : souci esthétique, images de la saleté et du manque d’hygiène... Il y a les indifférents et les sans opinion (très peu)... et il y a les "pour et contre" qui plaident pour un peu de mousse mais pas trop.
Le problème est que dans un référendum on ne peut pas choisir autre chose que oui ou non ! Pour le quinquennat, c’était 5 en cas de oui, 7 en cas de non et 4 ou 6 n’avaient pas de valeur...
Cette question a déjà d’ailleurs suscité la polémique. Maxime Roux avait pris l’initiative de nettoyer la fontaine il y a longtemps. Il avait enlevé la mousse et le calcaire et avait nettoyé (à la javel ? au potassium ?) la pierre jaunie qui apparaissait dessous. Il n’a été que moyennement satisfait de l’opération : la fontaine était trop propre, "trop blanche". Il s’est fait copieusement engueuler par Mme Dufour-Messimy qui l’a invectivé en lui disant : "M. Maxime, vous avez commis un crime"...
La Gazette vous invite donc à donner votre opinion sur la question en déposant dans une enveloppe le bulletin réponse qui est dans le supplément à scotcher : vous postez la lettre au bar, à la poste (BP5) ou à la mairie. Le mardi 22 juillet, nous ferons un tirage au sort. Le bulletin gagnant se verra offrir (s’il y a un nom à qui la donner) une invitation à chaque soirée de La Gazette des 23, 24 et 25 juillet.
La fontaine de Villedieu, ce n’est pas seulement de la mousse. Ce sont aussi plein de petits signes des temps présents et passés ainsi qu’une richesse de notre village. Nous y consacrons deux pages entières dans notre rubrique "Connaissons nous notre village ?".
Ne reculant devant aucune question brûlante et importante, et en attendant que les nouvelles lois de décentralisation permettent un référendum local sur la question, La Gazette lance un sondage auprès des Villadéens : Pour ou contre la mousse sur la fontaine ?
Il s’agit là d’un sujet sensible, qui touche au patrimoine, au paysage, au sentiment de la beauté, au souci de l’hygiène et on ne saurait négliger une question aussi importante !
Une pré-enquête m’a montré pour l’instant quatre réactions. Il y a les "pour" : souci esthétique et valorisation du naturel, références aux fontaines moussues de Salon et Aix... Il y a les "contre" : souci esthétique, images de la saleté et du manque d’hygiène... Il y a les indifférents et les sans opinion (très peu)... et il y a les "pour et contre" qui plaident pour un peu de mousse mais pas trop.
Le problème est que dans un référendum on ne peut pas choisir autre chose que oui ou non ! Pour le quinquennat, c’était 5 en cas de oui, 7 en cas de non et 4 ou 6 n’avaient pas de valeur...
Cette question a déjà d’ailleurs suscité la polémique. Maxime Roux avait pris l’initiative de nettoyer la fontaine il y a longtemps. Il avait enlevé la mousse et le calcaire et avait nettoyé (à la javel ? au potassium ?) la pierre jaunie qui apparaissait dessous. Il n’a été que moyennement satisfait de l’opération : la fontaine était trop propre, "trop blanche". Il s’est fait copieusement engueuler par Mme Dufour-Messimy qui l’a invectivé en lui disant : "M. Maxime, vous avez commis un crime"...
La Gazette vous invite donc à donner votre opinion sur la question en déposant dans une enveloppe le bulletin réponse qui est dans le supplément à scotcher : vous postez la lettre au bar, à la poste (BP5) ou à la mairie. Le mardi 22 juillet, nous ferons un tirage au sort. Le bulletin gagnant se verra offrir (s’il y a un nom à qui la donner) une invitation à chaque soirée de La Gazette des 23, 24 et 25 juillet.
La fontaine de Villedieu, ce n’est pas seulement de la mousse. Ce sont aussi plein de petits signes des temps présents et passés ainsi qu’une richesse de notre village. Nous y consacrons deux pages entières dans notre rubrique "Connaissons nous notre village ?".
Yves Tardieu

Cliquez sur l'illustration
pour l'agrandir
Cliquez sur les étoiles rouges présentes sur la fontaine pour faire apparaître les commentaires.
 |
 |
 |
||||||
 |
 |
 |
 |
|||||
|
|
|
 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
 |
 |
 |
||||||
|
|
|
|||||||
 |
|
 |
||||||
|
|
 |
|||||||
 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|||
 |
 |
 |
||
 |
||||
 |
|
 |
 |
|
|
|
||||
|
|
|||
 |
 |
||
 |
|
 |
 |
|
|
|||
|
|
||||
 |
|
 |
||
 |
|
 |
||
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
||
 |
|
 |
||
Fontaine moussue ?
Mousse ou pas mousse ? Cette question a animé les conversations de l’été, provoqué quelques troubles dans les consciences et permis à chacun de s’amuser. Il n’est pas inutile de préciser ici que le référendum organisé par La Gazette sur le sujet était un amusement. C’est plutôt bien que cet amusement ait été pris au sérieux mais personne au conseil municipal n’avait évoqué cette question et je suis le seul responsable de la galéjade.
Nous avions demandé une réponse à travers un bulletin. Beaucoup de gens ont répondu, mais oralement. Il ne m’est pas possible de compter toutes ces réponses. Finalement, si quelques dizaines ou centaines de personnes ont livré leur opinion sur le sujet, nous n’avons recueilli que 24 bulletins réponses qui représentent pourtant un peu plus de vote.
Ainsi, chez les Kermann, un référendum familial donne deux voix pour enlever la mousse et une voix pour la garder. Un bulletin entièrement manuscrit déposé à la mairie et adressé à « monsieur le maire » demande « d’enlever la mousse de la fontaine » et le post-scriptum se fait un peu impératif, en précisant « d’ici deux mois merci ». Il comporte trois signatures. Cette missive prenant position nettement, malgré son écriture enfantine, est l’œuvre de Paul Tardieu. Au total, nous avons ainsi 21 non et 9 oui.
La mousse a la cote et beaucoup veulent la garder. Il est intéressant de noter que le même argument, l’esthétique ou la beauté, se retrouve dans les deux camps ! Pour le reste, le respect de la nature incline à garder la mousse chez les uns et le souci de l’hygiène ou de l’entretien de la fontaine porte à la supprimer chez les autres. Beaucoup font référence également aux fontaines moussues d’Aix et Salon de Provence.
On peut noter également quelques précisions apportées par certains. Paulette Mathieu ne se « souvient pas avoir vu tant de mousse dans son enfance » et suppose que « la pollution de l’eau par les produits employés par l’agriculture » en est peut-être l’explication. Il est possible en effet que l’engrais soit bénéfique à la mousse.
Pour Nicole et Tito Topin qui préfèrent la fontaine sans mousse, celle ci avait son intérêt lorsque « l’homme de la civilisation s’égarait en forêt, il cherchait le nord qu’il avait perdu, dans la mousse au pied des arbres. Elle lui donnait le nord aussi sûrement que le pôle magnétique. Aujourd’hui, l’homme de la civilisation ne se perd plus en forêt, il a le GPS. Il ne cherche plus le nord, il recherche le sud et on voit par là que la mousse est condamnée ». De toute façon sur la place de Villedieu il y a de la mousse des quatre côtés et le voyageur ne peut que tourner en rond !
A l’inverse, Roger de Froidcourt défend la mousse par une injonction poétique : « Oh ! vous tous qui passez par le chemin de Villedieu apprenez à aimer, apprenez à aimer le bonheur d’avoir de la mousse qui vous donne de la poésie, mais voilà, voilà, la raison à Villedieu, à l’image de son pays, est souvent déraisonnable, poètes circulez »...
A côté des avis tranchés, il y a aussi les hésitations et les nuances, qui ont été souvent données oralement. La mousse oui, mais la moitié de la mousse seulement, est un avis fréquent. Paulette Mathieu remarque également que la mousse change de couleur, devient « roussâtre » lorsque l’eau ne coule pas et que « la couleur qu’elle prend alors n’est pas engageante ». Elle souhaite conserver la mousse malgré tout mais il « faudrait pouvoir l’humecter pour qu’elle reste verte ».
Cette question sur la mousse et la double page sur la fontaine, ses particularités et ses cicatrices, ont conduit beaucoup d’entre nous à regarder la fontaine de plus près que d’habitude. Souvenirs et anecdotes ont ressurgi. Le Villadéen barbu, un peu gros et qui se déplace en camion bleu n’est pas le dernier à raconter les différentes blagues ou même à se souvenir de détails matériels.
Ainsi, s’il se souvient du bouchon en buis que Maxime avait taillé et qui a longtemps servi à boucher la fontaine, c’est sûrement qu’il a eu l’occasion de le voir de près !
Hans se souvient avoir vu dans les années 50 un pneu couronner la fontaine et il a même peut-être une photo de la chose. Renseignement pris, il semble qu’il s’agisse d’une coutume des conscrits qui avaient l’habitude d’amener sur la place toutes sortes de choses.
Il y a aussi ceux qui se souviennent avec émotion et presque la larme à l’oeil de l’époque bénie où c’était du vin et non de l’eau qui coulait de la fontaine. Dans les années 1970, le jour de l’aïoli, l’eau se transformait en vin, pour le grand plaisir des convives. Saint Michel, à qui l’église de Villedieu est consacrée, n’était certainement pas étranger à ce petit (mais fort sympathique) miracle.
Jean Marie Dusuzeau nous propose dans un article un souvenir personnel authentifié depuis par des témoins fiables et Maya Quétier nous a envoyé un poème inspiré par la fontaine.
Comme souvent, notre environnement quotidien paraît aller de soi et nous nous souvenons mal de faits pourtant récents. Nous regardons la fontaine comme s’il y avait toujours eu de la mousse et pourtant, une carte postale qui n’est pas très ancienne nous la montre sans mousse. Nous publions cette carte postale et lançons pour l’occasion deux concours :
• le jeu des sept erreurs... Quelles sont les différences entre la place à ce moment-là et la place aujourd’hui ? Le jeu ne concerne que la partie de la place montrée par cette photo.
• le jeu de l’approximation chronologique... En raisonnant à partir de ce que l’on voit, quelle est l’époque (le plus précisément possible) à laquelle a pu être prise cette photo ?
Yves Tardieu


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Fontaine, appel à témoins
La description détaillée de la fontaine dans le dernier numéro de La Gazette me fait me remémorer un souvenir vieux de trente-cinq ans.
En ce temps-là des habitants de Mirabel avaient acquis en commun un fournil du bourg et l'exploitaient en coopérative. Le jeune boulanger qu'ils avaient recruté était salarié. Toutefois, les croissants et pâtisseries qu'il confectionnait étaient vendus pour son propre compte.
Ce jeune homme n'était pas bâti en colosse, mais il manifestait une grande endurance aux apéritifs anisés qu'il consommait volontiers au "Café du Centre" tenu à l'époque par Huguette et Michel. Une particularité plus surprenante pour son gabarit était la force qu'il manifestait, à jeun ou bien "sec", au jeu du bras de fer.
Un soir d'automne 1968 ayant terrassé tous ses rivaux présomptueux et fêté chacune de ses victoires au pastis, il sortit du bar sous la pluie pour s'attaquer à la fontaine faute d'adversaire digne de ses biceps. Les deux fers qui permettent de reposer les récipients sous le bec de Saint-Claude étaient certes un peu descellés de leur appui extérieur au bassin. Le premier résista un instant aux efforts du boulanger puis se cintra, mais le second céda d'un coup et pris la forme de l'angle droit.
Le "Centre" fermait, il était l'heure de préparer la fournée du matin. Le boulanger regagna Mirabel.
Je crois me souvenir qu'il pétrissait encore à la main. Les fers de la fontaine restèrent quelque temps dans cet état. Personne ne put les redresser sans outil.
Un lecteur se souvient-il de cet incident, ou ma mémoire amplifie-t-elle cet exploit prescrit ?
Jean-Marie Dusuzeau
C’est une claire fontaine, qui chante nuit et jour les cigales et le soleil, réconfortante, apaisante.
Eau de vie dans la torpeur de l’été.
Eau de roche, rafraîchie dans l’ombre de la terre, elle court, généreuse et discrète,
à travers bois et futaies, désaltérant à son passage secret les pieds des vignes et des oliviers.
Eau douce, blanche et pure, elle se rassemble en fontaines, de place en place, à l’ombre des platanes.
C’est là, au milieu des villages, qu’elle se mélange au pastis, qu’elle se mêle aux conversations publiques et aux rires ensoleillés.
C’est là, près des cercles de tables qu’elle entend les potins, amusée.
Une fontaine est bruyante de ces histoires qu’elle colporte au fil de l’eau, à fleur de transparence.
C’est là, autour de ces jets, que s’éclabousse en cascade la mémoire des générations, toujours recommencées.
Gazouillis…
Maya Quettier
Trouver les différences...


Dans le numéro 19 nous avons lancé le jeu des 7 erreurs concernant cette photo de la place.
1 - la maison bleue n’était pas bleue
2 - la maison bleue n’avait pas encore mis ses pots de fleurs
3 - Nunez n’avait pas encore repeint ses volets
4 - les panneaux de signalisation routière n’étaient pas en place (Vaison, Roaix)
5 - pas de panneau La Vigneronne
6 - pas de panneau de parking
7 - pas de panneau d’interdiction de stationner
8 - pas de panneau signalant les WC publics
9 - pas de panneau publicitaire pour les artisans (Nunez, Galizzi)
10 - pas de panneau de signalisation des maisons d’hôtes
11 - les tables et les chaises du bistrot sont différentes
12 - et.... PAS DE MOUSSE SUR LA FONTAINE
La 1ère photo a été prise au printemps, après 1989 puisque la place est dallée. On y aperçoit Marcelle.
La seconde a été prise en automne 2003.
Fontaine moussue
Un lecteur bas-alpin de La Gazette nous a signalé que la plus belle fontaine moussue (de la région ? de France ? du monde ?) se trouvait à Barjols dans le Haut-Var.
Une discussion informelle à la terrasse du Centre à la fin de cet été et l’idée était lancée.
Il fallait envoyer une mission villadéenne vérifier cette assertion.
Claudine et René Kermann ont été désignés volontaires pour l’accomplir.
Ils sont donc allés passer un dimanche de fin novembre à Barjols et ont ramené une photo de la fontaine en question.
Elle est aussi moussue que Kermann est barbu !
Yves Tardieu

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
...et de l’eau
Huguette Louis a demandé au laboratoire de Vaison une analyse de l'eau de la fontaine, analyse qui se révèle très bonne. Elle concerne le bec face au café où coule l'eau de source venant de Saint Claude.
Pour comprendre un peu mieux les données chimiques et bactériologiques, j'ai rencontré M. Schlouch afin qu'il nous explique les résultats figurant sur le relevé du laboratoire et le bien fondé de ces analyses.
Tout d'abord c'est la potabilité de l'eau qui doit être prouvée selon les normes édictées par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces normes portent sur l’acidité (PH) de l'eau, sa dureté, la teneur en chlorure, en nitrites, nitrates et ammonium.
L'analyse faite le 13 février donne sur ces points des chiffres se situant dans les limites autorisées. L'analyse bactériologique recherche la présence éventuelle de coliformes (germes non pathogènes), de colibacilles, streptocoques, staphylocoques, anaérobies, salmonella et pseudomonas. Ces germes n'apparaissent pas dans l'eau de la fontaine, à l'exception de coliformes toutefois peu nombreux et sans danger.
Une analyse de cette eau, que beaucoup utilisent pour leur consommation, doit être faite une fois par an, ou davantage en cas de doute car l'eau est vivante et soumise à des facteurs extérieurs. Parmi les éléments indésirables les plus courants, on trouve :
- Une eau colorée implique la présence de corps étrangers.
- Le PH. Une eau trop acide ou trop basique aura le pouvoir de se charger plus facilement en éléments indésirables.
- L'ammonium et les nitrites. Leur présence indique souvent une pollution localisée dans le site du prélèvement, par des animaux morts ou des végétaux en décomposition. Cette pollution est souvent accompagnée de la présence de germes.
- Les nitrates malheureusement présents dans la plupart des eaux, proviennent de la pollution diffuse de l'azote naturel des sols ou des engrais azotés.
- Les coliformes et les streptocoques fécaux. Ce sont des germes à priori inoffensifs, présents dans l'intestin de l'homme et de l'animal, mais leur présence dans l'eau indique une pollution fécale qui est souvent associée à la présence de germes pathogènes moins faciles à mettre en évidence.
- La dureté ou taux de calcaire. Cet élément est surtout gênant pour le risque d'entartrage des installations, mais une eau trop douce est souvent agressive et peut se charger en métaux
- Les chlorures (le sel). Ces éléments ne sont pas toxiques, mais gênants pour les personnes devant suivre un régime hyposodé. Les eaux en contenant sont trop corrosives et peuvent se charger en métaux.
- Les autres éléments, le fer, les phosphates, le manganèse, les sulfates etc. peuvent causer des désagréments divers lorsqu'ils sont présents au-dessus des valeurs normales.
L'eau distribuée par les réseaux urbains est bien contrôlée par les sociétés des eaux et dans la plupart des cas conforme aux normes de potabilité. Ce n'est pas le cas des eaux naturelles (puits, sources, rivières...) dont la potabilité doit être vérifiée par l'utilisateur. Une précaution indispensable.
Pour comprendre un peu mieux les données chimiques et bactériologiques, j'ai rencontré M. Schlouch afin qu'il nous explique les résultats figurant sur le relevé du laboratoire et le bien fondé de ces analyses.
Tout d'abord c'est la potabilité de l'eau qui doit être prouvée selon les normes édictées par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces normes portent sur l’acidité (PH) de l'eau, sa dureté, la teneur en chlorure, en nitrites, nitrates et ammonium.
L'analyse faite le 13 février donne sur ces points des chiffres se situant dans les limites autorisées. L'analyse bactériologique recherche la présence éventuelle de coliformes (germes non pathogènes), de colibacilles, streptocoques, staphylocoques, anaérobies, salmonella et pseudomonas. Ces germes n'apparaissent pas dans l'eau de la fontaine, à l'exception de coliformes toutefois peu nombreux et sans danger.
Une analyse de cette eau, que beaucoup utilisent pour leur consommation, doit être faite une fois par an, ou davantage en cas de doute car l'eau est vivante et soumise à des facteurs extérieurs. Parmi les éléments indésirables les plus courants, on trouve :
- Une eau colorée implique la présence de corps étrangers.
- Le PH. Une eau trop acide ou trop basique aura le pouvoir de se charger plus facilement en éléments indésirables.
- L'ammonium et les nitrites. Leur présence indique souvent une pollution localisée dans le site du prélèvement, par des animaux morts ou des végétaux en décomposition. Cette pollution est souvent accompagnée de la présence de germes.
- Les nitrates malheureusement présents dans la plupart des eaux, proviennent de la pollution diffuse de l'azote naturel des sols ou des engrais azotés.
- Les coliformes et les streptocoques fécaux. Ce sont des germes à priori inoffensifs, présents dans l'intestin de l'homme et de l'animal, mais leur présence dans l'eau indique une pollution fécale qui est souvent associée à la présence de germes pathogènes moins faciles à mettre en évidence.
- La dureté ou taux de calcaire. Cet élément est surtout gênant pour le risque d'entartrage des installations, mais une eau trop douce est souvent agressive et peut se charger en métaux
- Les chlorures (le sel). Ces éléments ne sont pas toxiques, mais gênants pour les personnes devant suivre un régime hyposodé. Les eaux en contenant sont trop corrosives et peuvent se charger en métaux.
- Les autres éléments, le fer, les phosphates, le manganèse, les sulfates etc. peuvent causer des désagréments divers lorsqu'ils sont présents au-dessus des valeurs normales.
L'eau distribuée par les réseaux urbains est bien contrôlée par les sociétés des eaux et dans la plupart des cas conforme aux normes de potabilité. Ce n'est pas le cas des eaux naturelles (puits, sources, rivières...) dont la potabilité doit être vérifiée par l'utilisateur. Une précaution indispensable.
Claude Bériot
Les résultats figurant sur le relevé du laboratoire, concernant le bec de la fontaine face au café où coule l'eau de source venant de Saint Claude...
| CHIMIE | ||
|
PH Dureté totale Dureté carbonatée Chlorure Nitrites Nitrates Ammonium |
7,5 21°d 2 10 mg/l 0,00 mg/l 10 mg/l 0,00 mg/l |
(6,5 - 9,0) (15 - 30) (0 - 200) (0 - 0,10) (0 - 50) (0 - 0,50) |
| BACTERIOLOGIE | ||
|
Coliformes Colibacilles Streptocoques Staphylocoques Anaérobies Salmonella Pseudomonas |
présence absence absence absence absence absence absence |
|
|
CONCLUSION Présence de coliformes peu nombreux, à surveiller. |
||
Fontaine ! Boirai-je encore de ton eau ?
Chaque année, certains l'ont sans doute remarqué, le débit des fontaines du village se fait de plus en plus aléatoire. Consultée sur la question, notre dévouée Manon locale, nous a dévoilé une partie du mystère qui entoure les sources de Villedieu.
Au hasard d'une sortie de réunion, Maxime Roux, car c'est lui le rôdeur de nos collines qui a veillé jalousement pendant des années au bon approvisionnement en eau des Villadéens (et Villadéennes), nous a ainsi entraîné, Huguette Louis et moi, à la découverte d'un des patrimoines les plus précieux du village, caché au creux du Rieu, les sources de Saint Laurent.
Ces sources sont en fait composées d'une série de trois "puits drainants horizontaux" qui s'enchaînent sous le lit du Rieu. Creusés au début du siècle dernier, ces tunnels collectent les eaux d'infiltration pour les amener dans une conduite forcée qui remonte jusqu'au village.
Maxime, qui est pour Villedieu une véritable mémoire vivante, connaît les lieux et leur histoire dans les moindres détails, jusqu'à la première inauguration ratée, où monsieur le Préfet n'avait pas même entendu le moindre "Pfuitt…" sortir du tuyau flambant neuf de la fontaine, alors vierge de toute mousse, parce qu'à la première ouverture des vannes le tuyau d'amené avait tout simplement "pété" sous la pression trop forte.
Aujourd'hui, il faut peu de chose pour rétablir la situation : réparer 2 mètres de tunnel effondré, enlever un bouchon de calcaire d'une conduite obstruée, colmater une importante fuite liée à la rupture d'un tuyau…
L'idée est née, que faute de crédits et de subventions pour ce genre de sauvetage, nous pourrions nous organiser pour le faire entre Villadéens en profitant de la sécheresse pour pouvoir accéder au lit du Rieu.
Première étape, il faut débroussailler les abords du Rieu pour pouvoir accéder aux ouvrages et évaluer les travaux nécessaires. L'occasion de découvrir ce site par a débouché sur une autre idée : organiser un rendez-vous champêtre où se mêlent travail et réjouissance collectifs.
Tous ceux qui le désirent, chacun suivant ses forces, sont bienvenus pour participer à la première séance de débroussaillage. Le rendez-vous est donné le 17 juillet sur la place à 6h00 du matin. Pour y aller directement, prendre le chemin de Saint Laurent jusqu’au dernier chemin à droite avant le terrain de ball-trap. Nous y mettrons un repère.
A partir de 6h00 du matin pour les plus courageux, et jusqu'à midi et demi, munis de cisailles, débroussailleuses, fourches, coupes buissons et autres instruments ad hoc, sans oublier de co-festoyer pour le petit déjeuner et le pique nique de midi…
Au hasard d'une sortie de réunion, Maxime Roux, car c'est lui le rôdeur de nos collines qui a veillé jalousement pendant des années au bon approvisionnement en eau des Villadéens (et Villadéennes), nous a ainsi entraîné, Huguette Louis et moi, à la découverte d'un des patrimoines les plus précieux du village, caché au creux du Rieu, les sources de Saint Laurent.
Ces sources sont en fait composées d'une série de trois "puits drainants horizontaux" qui s'enchaînent sous le lit du Rieu. Creusés au début du siècle dernier, ces tunnels collectent les eaux d'infiltration pour les amener dans une conduite forcée qui remonte jusqu'au village.
Maxime, qui est pour Villedieu une véritable mémoire vivante, connaît les lieux et leur histoire dans les moindres détails, jusqu'à la première inauguration ratée, où monsieur le Préfet n'avait pas même entendu le moindre "Pfuitt…" sortir du tuyau flambant neuf de la fontaine, alors vierge de toute mousse, parce qu'à la première ouverture des vannes le tuyau d'amené avait tout simplement "pété" sous la pression trop forte.
Aujourd'hui, il faut peu de chose pour rétablir la situation : réparer 2 mètres de tunnel effondré, enlever un bouchon de calcaire d'une conduite obstruée, colmater une importante fuite liée à la rupture d'un tuyau…
L'idée est née, que faute de crédits et de subventions pour ce genre de sauvetage, nous pourrions nous organiser pour le faire entre Villadéens en profitant de la sécheresse pour pouvoir accéder au lit du Rieu.
Première étape, il faut débroussailler les abords du Rieu pour pouvoir accéder aux ouvrages et évaluer les travaux nécessaires. L'occasion de découvrir ce site par a débouché sur une autre idée : organiser un rendez-vous champêtre où se mêlent travail et réjouissance collectifs.
Tous ceux qui le désirent, chacun suivant ses forces, sont bienvenus pour participer à la première séance de débroussaillage. Le rendez-vous est donné le 17 juillet sur la place à 6h00 du matin. Pour y aller directement, prendre le chemin de Saint Laurent jusqu’au dernier chemin à droite avant le terrain de ball-trap. Nous y mettrons un repère.
A partir de 6h00 du matin pour les plus courageux, et jusqu'à midi et demi, munis de cisailles, débroussailleuses, fourches, coupes buissons et autres instruments ad hoc, sans oublier de co-festoyer pour le petit déjeuner et le pique nique de midi…
Rémy Berthet-Rayne
Cisailles, coupe-buissons et débroussailleuses
Dans la dernière Gazette, Rémy Berthet-Rayne lançait un appel à la participation à la remise en état du dispositif de captage des sources qui alimentent la fontaine de la place. Comme tout le monde a pu le constater trois des quatres becs de la fontaine ne coulent plus depuis le printemps, les trois qui sont alimentés par les sources de Saint Laurent.
Le quatrième, face au bar, la source de Saint Claude, était faible au plus fort de la sécheresse mais a toujours permis à chacun de venir chercher son eau, aux cyclistes nombreux à faire halte sur la place, à se désaltérer et remplir leur bidon et à la fontaine d’être pleine.
S’agissant des sources de Saint Laurent, la sécheresse n’est pas vraiment en cause, mais il s’agit d’un défaut d’entretien du captage et du réseau.
Apparemment, une des dernières interventions y a été faite par Daniel Tricart lorsqu’il était garde, aidé de Julien Moinault.
Il faut dire que l’eau vient de loin, au moins trois kilomètres, et uniquement par gravité avec la contrainte pour le conduit de suivre les courbes de niveau sans que l’on ait pu éviter de nombreux points bas et hauts sur le parcours. Il faut aussi que l’eau remonte jusqu’au village de son point le plus bas.
Le rendez-vous donné par le conseil municipal et par Rémy a été entendu. Le samedi 17 juillet au petit matin, ce sont presque trente personnes qui se sont déplacées pour découvrir et surtout débroussailler le site. Il faut dégager le lieu du captage et son enchaînement de “cavernes” et de puits. Il faut aussi dégager des centaines de mètres le long des canalisations de manière à accéder au différentes purges.
Un groupe s’est constitué au départ de la source, uniquement armé de coupe-buissons, cisailles et débroussailleuses. Un autre groupe parti de la maison Cornud avait l’appui logistique décisif de la petite pelle mécanique de Frédéric Serret. Jacky Barre avec sa tronçonneuse et Julien Moinault avec son débroussailleur assuraient aussi un gros travail de ce côté là.
Sur plusieurs centaines de mètres, un taillis d’arbres, de buissons, de lianes empêchait tout passage, même d’un homme seul à pied. La pause du petit-déjeuner était la bienvenue. Après une matinée de travail, un chemin était libéré dans tout le cours du Rieu et l’accès aux différents puits, regards et cavernes était assuré. La matinée avait été fatigante mais bien remplie.
Tout le monde a pu découvrir le système de captage et certaines de ses faiblesses : un puits rempli de limon, un tuyau cassé, des fuites d’eau à identifier et la recherche des vannes sur les points bas du réseau. Lionel Parra a pu entrer dans la première “caverne” à partir d’un regard et remonter jusqu’à la source, l’eau suintant de la roche.
Ce travail fait, il restait à organiser les réparations. Le conseil municipal décide alors de recommencer le samedi 31 juillet. A nouveau, il y a de nombreux participants, même si le travail prévu n’a pu vraiment être fait faute de moyens techniques : vider le puits, réparer la conduite...
Finalement, il y a eu un peu de nettoyage supplémentaire et surtout, la recherche grâce à deux pelles mécaniques conduites par Frédéric Serret et Claude L’Homme de l’une des vannes de purge.
Pendant deux heures, avec le concours de sourciers expérimentés ou débutants (presque tout le monde a pris en main les baguettes), on a cherché la deuxième vanne.
Maxime avait indiqué l’endroit approximatif où on pouvait la trouver. Il l’avait déjà cherchée une fois avec M. Estivalet de la SDEI il y a quelques années.
Malgré les sourciers et les mètres cubes bourroulés à la pelle, la vanne est restée introuvable. Malgré tout, la connaissance du système et de ses faiblesses s’est affinée ce jour-là. On a vu Michel Muller visiter les différentes cavernes. Jacky Barre et Christian L’Homme ont utilisé leur connaissance des lieux et leurs souvenirs (merci la chasse !) pour chercher un autre accès de manière à pouvoir faire venir une pompe à vidange au dessus du site. Bref, si cette deuxième matinée a été moins fructueuse matériellement que la première, elle a permis à de nombreuses personnes de découvrir et comprendre le site et sa valeur patrimoniale ainsi que d’apprécier le travail des anciens. Finalement, bien peu de personnes parmi les présents à ces deux journées avaient la connaissance des “cavernes”.
Une connaissance et aussi un plaisir partagés qui sont en eux-mêmes une richesse. On a trouvé présents sur le site jeunes et vieux, néo et archéo-villadéens, femmes et hommes, réunis pour un travail et des objectifs communs.
A côté de ceux qui ont pu être présents sur place, la cause des sources a mobilisé les conversations et suscité l’intérêt de beaucoup. Nombreux sont ceux qui ont été curieux de la chose et du travail entrepris.
Le travail de ces deux journées s’est d’ailleurs prolongé. Le 31 août, après que tout le monde ou presque soit parti, André Macabet est venu aider Rémy à faire une réparation provisoire sur le tuyau cassé. Le lendemain, Jacky et Rémy y retournaient pour mettre dégrippant et graisse sur les vannes et les purges de manière à pouvoir s’en servir, Maxime, de retour de vacances, s’y est bien sûr rendu.
L’eau n’est pas encore arrivée à la fontaine. Il y a des travaux de réparation et de nettoyage à faire. Il faut aussi reprendre toutes les vannes et les purges pour nettoyer la conduite. Cette première mobilisation va permettre de faire de l’entretien du site, du captage et de la conduite une nécessité pour tous. Maxime qui était un peu seul à porter cette volonté toutes ces dernières années a réussi son coup : les sources ont bien l’air de devenir une cause nationale villadéenne.
Le quatrième, face au bar, la source de Saint Claude, était faible au plus fort de la sécheresse mais a toujours permis à chacun de venir chercher son eau, aux cyclistes nombreux à faire halte sur la place, à se désaltérer et remplir leur bidon et à la fontaine d’être pleine.
S’agissant des sources de Saint Laurent, la sécheresse n’est pas vraiment en cause, mais il s’agit d’un défaut d’entretien du captage et du réseau.
Apparemment, une des dernières interventions y a été faite par Daniel Tricart lorsqu’il était garde, aidé de Julien Moinault.
Il faut dire que l’eau vient de loin, au moins trois kilomètres, et uniquement par gravité avec la contrainte pour le conduit de suivre les courbes de niveau sans que l’on ait pu éviter de nombreux points bas et hauts sur le parcours. Il faut aussi que l’eau remonte jusqu’au village de son point le plus bas.
Le rendez-vous donné par le conseil municipal et par Rémy a été entendu. Le samedi 17 juillet au petit matin, ce sont presque trente personnes qui se sont déplacées pour découvrir et surtout débroussailler le site. Il faut dégager le lieu du captage et son enchaînement de “cavernes” et de puits. Il faut aussi dégager des centaines de mètres le long des canalisations de manière à accéder au différentes purges.
Un groupe s’est constitué au départ de la source, uniquement armé de coupe-buissons, cisailles et débroussailleuses. Un autre groupe parti de la maison Cornud avait l’appui logistique décisif de la petite pelle mécanique de Frédéric Serret. Jacky Barre avec sa tronçonneuse et Julien Moinault avec son débroussailleur assuraient aussi un gros travail de ce côté là.
Sur plusieurs centaines de mètres, un taillis d’arbres, de buissons, de lianes empêchait tout passage, même d’un homme seul à pied. La pause du petit-déjeuner était la bienvenue. Après une matinée de travail, un chemin était libéré dans tout le cours du Rieu et l’accès aux différents puits, regards et cavernes était assuré. La matinée avait été fatigante mais bien remplie.
Tout le monde a pu découvrir le système de captage et certaines de ses faiblesses : un puits rempli de limon, un tuyau cassé, des fuites d’eau à identifier et la recherche des vannes sur les points bas du réseau. Lionel Parra a pu entrer dans la première “caverne” à partir d’un regard et remonter jusqu’à la source, l’eau suintant de la roche.
Ce travail fait, il restait à organiser les réparations. Le conseil municipal décide alors de recommencer le samedi 31 juillet. A nouveau, il y a de nombreux participants, même si le travail prévu n’a pu vraiment être fait faute de moyens techniques : vider le puits, réparer la conduite...
Finalement, il y a eu un peu de nettoyage supplémentaire et surtout, la recherche grâce à deux pelles mécaniques conduites par Frédéric Serret et Claude L’Homme de l’une des vannes de purge.
Pendant deux heures, avec le concours de sourciers expérimentés ou débutants (presque tout le monde a pris en main les baguettes), on a cherché la deuxième vanne.
Maxime avait indiqué l’endroit approximatif où on pouvait la trouver. Il l’avait déjà cherchée une fois avec M. Estivalet de la SDEI il y a quelques années.
Malgré les sourciers et les mètres cubes bourroulés à la pelle, la vanne est restée introuvable. Malgré tout, la connaissance du système et de ses faiblesses s’est affinée ce jour-là. On a vu Michel Muller visiter les différentes cavernes. Jacky Barre et Christian L’Homme ont utilisé leur connaissance des lieux et leurs souvenirs (merci la chasse !) pour chercher un autre accès de manière à pouvoir faire venir une pompe à vidange au dessus du site. Bref, si cette deuxième matinée a été moins fructueuse matériellement que la première, elle a permis à de nombreuses personnes de découvrir et comprendre le site et sa valeur patrimoniale ainsi que d’apprécier le travail des anciens. Finalement, bien peu de personnes parmi les présents à ces deux journées avaient la connaissance des “cavernes”.
Une connaissance et aussi un plaisir partagés qui sont en eux-mêmes une richesse. On a trouvé présents sur le site jeunes et vieux, néo et archéo-villadéens, femmes et hommes, réunis pour un travail et des objectifs communs.
A côté de ceux qui ont pu être présents sur place, la cause des sources a mobilisé les conversations et suscité l’intérêt de beaucoup. Nombreux sont ceux qui ont été curieux de la chose et du travail entrepris.
Le travail de ces deux journées s’est d’ailleurs prolongé. Le 31 août, après que tout le monde ou presque soit parti, André Macabet est venu aider Rémy à faire une réparation provisoire sur le tuyau cassé. Le lendemain, Jacky et Rémy y retournaient pour mettre dégrippant et graisse sur les vannes et les purges de manière à pouvoir s’en servir, Maxime, de retour de vacances, s’y est bien sûr rendu.
L’eau n’est pas encore arrivée à la fontaine. Il y a des travaux de réparation et de nettoyage à faire. Il faut aussi reprendre toutes les vannes et les purges pour nettoyer la conduite. Cette première mobilisation va permettre de faire de l’entretien du site, du captage et de la conduite une nécessité pour tous. Maxime qui était un peu seul à porter cette volonté toutes ces dernières années a réussi son coup : les sources ont bien l’air de devenir une cause nationale villadéenne.
Yves Tardieu

Jacky Barre à la tronçonneuse

Julien Moinault et
André Bonnefoi à la débroussailleuse,
Georges Louis au
coupe-buisson

Combat de pelles devant
un public nombreux.
A la pioche,
Jean-Louis Vollot

Alain Bertrand à la pioche
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Ils ont participé le 17 juillet : Jean Claude Adage, Graziella Barre, Jacky Barre, Rémy Berthet-Rayne, Suzanne et Per Boeje, André Bonnefoi, Michel Coulombel, Philippe de Moustiers, Henri Favier, Huguette et Georges Louis, Alain Martin, Julien Moinault, Michel Muller, Lionel Parra, Marie-Henriette et Eric Quettier, Maxime Roux, Frédéric Serret, Yves Tardieu, Jean-Louis Vollot, Graham Yeats.
Ils étaient là le 31 juillet : Jean Claude Adage, Jacky Barre, Rémy Berthet-Rayne, Daniel Bertrand, Alain Bertrand, Suzanne et Per Boeje, Yannick Chaix, Solange Choplin, Christian L’Homme, Claude L’Homme, André Macabet, Alain Martin, Michel Muller, Jean-Pierre Rogel, Frédéric Serret, Frédéric Gnilka, Yves Tardieu, Hubert Vasseur, Jean Louis Vollot, Graham Yeats.
Ils étaient là le 31 juillet : Jean Claude Adage, Jacky Barre, Rémy Berthet-Rayne, Daniel Bertrand, Alain Bertrand, Suzanne et Per Boeje, Yannick Chaix, Solange Choplin, Christian L’Homme, Claude L’Homme, André Macabet, Alain Martin, Michel Muller, Jean-Pierre Rogel, Frédéric Serret, Frédéric Gnilka, Yves Tardieu, Hubert Vasseur, Jean Louis Vollot, Graham Yeats.
Y. T.
PS : si j’ai oublié quelqu’un, c’est possible car j’ai fait ça de tête chaque fois, il suffit de me le dire sans m’engueuler...
Les sources de Villedieu c’est “Saint Claude” et les “cavernes chez Cornud”. Laissons de côté Saint Claude qui n’alimente que la fontaine du village et qui coule (on peut faire confiance à La Gazette pour en reparler un jour !) et intéressons-nous à ces fameuses cavernes.
J’ai toujours entendu cette expression mais je n’avais jamais vu ce que c’était. Caverne, ça a à la fois un côté naturel et préhistorique et je ne sais pas trop ce que ce mot évoquait pour ceux qui n’avaient jamais vu la chose : l’aven d’Orgnac, les grottes de Lascaux, la Fontaine de Vaucluse ou tout simplement un petit trou dans la roche ?
Rien de tout ça. Les cavernes en question n’ont rien de naturel ni de préhistorique, elles sont éminement le fruit du travail de l’homme, il y a guère moins d’un siècle.
Dans le cours d’un ruisseau, une des branches du Rieu, trois puits drainants horizontaux se succèdent. Ils sont bâtis au centre du ruisseau, assez larges et assez hauts pour qu’un homme puisse y entrer. Sur la première image, ci-contre, on voit Michel Muller les pieds dans l’eau pénétrer dans le puits le plus en aval. Le premier, en amont, est adossé à la roche d’où suinte l’eau. Ce premier puits est accessible par deux regards qui ont été dégagés lors des travaux, le cours du Rieu ayant été à cet endroit entièrement nettoyé.
Ces structures horizontales sont longues de plusieurs dizaines de mètres chacunes. Elles sont reliées les unes aux autres par un puits vertical assez profond. Le premier de ces puits est totalement rempli de limon et il faudra le vider même si ce n’est probablement pas le plus important à faire.
Au bout de l’ensemble, un tuyau en fonte constitue la prise d’eau. Une vanne permet de couper l’eau dans la conduite. Voilà élucidé ce que sont les “cavernes”. L’eau part de là et arrive à Villedieu.
Dans l’expression “cavernes chez Cornud”, le “chez Cornud” nous donne une idée du point de départ de l’eau. La ferme de Lucile et Paul Cornud est la plus proche du point de captage et on peut y accéder en remontant le cours du Rieu sur quelques centaines de mètres. Nous sommes à plusieurs kilomètres du village et l’eau y arrive par gravité. La conduite, très longue, suit le relief dans ses grandes lignes. En gros, elle descend jusqu’à la croix des chemins de Saint Laurent et de la Montagne et remonte après, et dans ces petites lignes, il y a des pentes intermédiaires.
Après avoir rejoint le chemin de Saint Laurent à peu près à la hauteur de la maison de Mayaric (ou de Sarah), la conduite le suit tantôt à gauche tantôt à droite jusqu’à la D 7, dans le “contour du Cau” où elle emprunte le tracé de l’ancien chemin et traverse la vigne de Roger Tortel, puis elle suit la route jusqu’à Villedieu.
A chaque point haut du trajet se trouvent des “ventouses” qui servent à éliminer l’air qui pourrait empêcher l’eau de progresser. Il y en a deux que l’on voit sur le cours du Rieu au dessus de chez Cornud, une au sommet de la petite bosse après le passage du Rieu à la hauteur des cerisiers de Jacky Maffait, une à la croix des chemins de Saint Laurent et de la Montagne, une à la Ramade. Auparavant, il y en avait une dans le bassin de la fontaine. Elle a été supprimée lorsque la place a été refaite.
A chaque point bas, il y a une purge qui sert à évacuer les limons qui bouchent le tuyau. On en trouve deux dans le cours du Rieu au dessus de chez Cornud et ce sont celles-là que les pelles mécaniques ont cherchées le 31 juillet. Une autre, inutilisée depuis longtemps, car difficile d’accès, se trouve dans le cassis du franchissement du Rieu en face de chez Thierry Tardieu. La dernière se situe au franchissement de l’autre branche du Rieu.
Il y a aussi un point sensible qui est la réduction de la conduite, de 80 à 60 mm, à la hauteur de chez Cornud. Remettre en fonctionnement l’eau à la fontaine suppose aussi de traiter tous ces points de manière à purger correctement l’ensemble du circuit.
Aujourd’hui cette eau n’alimente plus que le bassin de la rue des Sources, celui du monument aux morts et la fontaine. Dans le passé, avant “l’eau du Rhône”, cette eau alimentait tout le village. Le réseau se prolongeait jusqu’à un réservoir qui se trouve en haut des Gardettes, en face de la maison Berthet, de l’autre côté du chemin du Devès.
Ainsi, l’eau ne s’arrêtait pas à la fontaine, elle traversait la place, remontait jusqu’au réservoir qui alimentait à son tour le village par gravité. Une vanne dans le chemin du Devès permettait de couper l’eau du village. Aujourd’hui, l’eau ne monte plus jusqu’au réservoir : la conduite a été coupée à la hauteur de cette vanne et raccordée à la descente. L’eau qui arrive sur la place est ainsi allée faire un tour par la Grand-rue et le Dévès avant d’y revenir.
Tout ce travail a été fait il y a fort longtemps et a permis aux Villadéens, à une époque où le village était bien plus peuplé que maintenant, d’avoir l’eau courante. Il a été fait à une époque où les moyens techniques étaient bien plus rudimentaires.
L’eau parcourt pas loin de quatre kilomètres entre les points d’altitude 314 m (la source), 219 m (le point le plus bas) et 290 m (le réservoir). On comprend que l’entretien de ce réseau, lorsqu’il était vital, était une des tâches primordiales à laquelle devait s’attacher le garde, comme en témoigne Maxime.
Il y a pour moi une certaine beauté, même si rien ou presque ne se voit, dans cette réalisation. La mémoire, l’usage et l’entretien de ce travail nous appartiennent collectivement.
J’ai toujours entendu cette expression mais je n’avais jamais vu ce que c’était. Caverne, ça a à la fois un côté naturel et préhistorique et je ne sais pas trop ce que ce mot évoquait pour ceux qui n’avaient jamais vu la chose : l’aven d’Orgnac, les grottes de Lascaux, la Fontaine de Vaucluse ou tout simplement un petit trou dans la roche ?
Rien de tout ça. Les cavernes en question n’ont rien de naturel ni de préhistorique, elles sont éminement le fruit du travail de l’homme, il y a guère moins d’un siècle.
Dans le cours d’un ruisseau, une des branches du Rieu, trois puits drainants horizontaux se succèdent. Ils sont bâtis au centre du ruisseau, assez larges et assez hauts pour qu’un homme puisse y entrer. Sur la première image, ci-contre, on voit Michel Muller les pieds dans l’eau pénétrer dans le puits le plus en aval. Le premier, en amont, est adossé à la roche d’où suinte l’eau. Ce premier puits est accessible par deux regards qui ont été dégagés lors des travaux, le cours du Rieu ayant été à cet endroit entièrement nettoyé.
Ces structures horizontales sont longues de plusieurs dizaines de mètres chacunes. Elles sont reliées les unes aux autres par un puits vertical assez profond. Le premier de ces puits est totalement rempli de limon et il faudra le vider même si ce n’est probablement pas le plus important à faire.
Au bout de l’ensemble, un tuyau en fonte constitue la prise d’eau. Une vanne permet de couper l’eau dans la conduite. Voilà élucidé ce que sont les “cavernes”. L’eau part de là et arrive à Villedieu.
Dans l’expression “cavernes chez Cornud”, le “chez Cornud” nous donne une idée du point de départ de l’eau. La ferme de Lucile et Paul Cornud est la plus proche du point de captage et on peut y accéder en remontant le cours du Rieu sur quelques centaines de mètres. Nous sommes à plusieurs kilomètres du village et l’eau y arrive par gravité. La conduite, très longue, suit le relief dans ses grandes lignes. En gros, elle descend jusqu’à la croix des chemins de Saint Laurent et de la Montagne et remonte après, et dans ces petites lignes, il y a des pentes intermédiaires.
Après avoir rejoint le chemin de Saint Laurent à peu près à la hauteur de la maison de Mayaric (ou de Sarah), la conduite le suit tantôt à gauche tantôt à droite jusqu’à la D 7, dans le “contour du Cau” où elle emprunte le tracé de l’ancien chemin et traverse la vigne de Roger Tortel, puis elle suit la route jusqu’à Villedieu.
A chaque point haut du trajet se trouvent des “ventouses” qui servent à éliminer l’air qui pourrait empêcher l’eau de progresser. Il y en a deux que l’on voit sur le cours du Rieu au dessus de chez Cornud, une au sommet de la petite bosse après le passage du Rieu à la hauteur des cerisiers de Jacky Maffait, une à la croix des chemins de Saint Laurent et de la Montagne, une à la Ramade. Auparavant, il y en avait une dans le bassin de la fontaine. Elle a été supprimée lorsque la place a été refaite.
A chaque point bas, il y a une purge qui sert à évacuer les limons qui bouchent le tuyau. On en trouve deux dans le cours du Rieu au dessus de chez Cornud et ce sont celles-là que les pelles mécaniques ont cherchées le 31 juillet. Une autre, inutilisée depuis longtemps, car difficile d’accès, se trouve dans le cassis du franchissement du Rieu en face de chez Thierry Tardieu. La dernière se situe au franchissement de l’autre branche du Rieu.
Il y a aussi un point sensible qui est la réduction de la conduite, de 80 à 60 mm, à la hauteur de chez Cornud. Remettre en fonctionnement l’eau à la fontaine suppose aussi de traiter tous ces points de manière à purger correctement l’ensemble du circuit.
Aujourd’hui cette eau n’alimente plus que le bassin de la rue des Sources, celui du monument aux morts et la fontaine. Dans le passé, avant “l’eau du Rhône”, cette eau alimentait tout le village. Le réseau se prolongeait jusqu’à un réservoir qui se trouve en haut des Gardettes, en face de la maison Berthet, de l’autre côté du chemin du Devès.
Ainsi, l’eau ne s’arrêtait pas à la fontaine, elle traversait la place, remontait jusqu’au réservoir qui alimentait à son tour le village par gravité. Une vanne dans le chemin du Devès permettait de couper l’eau du village. Aujourd’hui, l’eau ne monte plus jusqu’au réservoir : la conduite a été coupée à la hauteur de cette vanne et raccordée à la descente. L’eau qui arrive sur la place est ainsi allée faire un tour par la Grand-rue et le Dévès avant d’y revenir.
Tout ce travail a été fait il y a fort longtemps et a permis aux Villadéens, à une époque où le village était bien plus peuplé que maintenant, d’avoir l’eau courante. Il a été fait à une époque où les moyens techniques étaient bien plus rudimentaires.
L’eau parcourt pas loin de quatre kilomètres entre les points d’altitude 314 m (la source), 219 m (le point le plus bas) et 290 m (le réservoir). On comprend que l’entretien de ce réseau, lorsqu’il était vital, était une des tâches primordiales à laquelle devait s’attacher le garde, comme en témoigne Maxime.
Il y a pour moi une certaine beauté, même si rien ou presque ne se voit, dans cette réalisation. La mémoire, l’usage et l’entretien de ce travail nous appartiennent collectivement.
Yves Tardieu

Michel Muller
les pieds dans l’eau

Schémas du système de captage. Croquis de Rémy Berthet-Rayne

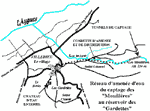
Des sources à Villedieu,
en passant par le château d’eau, tracé en pointillé (croquis R. B-R.)
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Cheminées
En 1948, Maxime Arrighi est intervenu avec son frère Jean et son oncle Arthur Brun, tous les deux maçons, sur les cavernes. Ils ont nettoyé le cours du ruisseau et construit les “cheminées”, c’est à dire les repos et sommets des puits. On voit sur la photo ci-contre le sommet du premier puits, celui qui est bouché par le limon et, au premier plan, la deuxième caverne, celle qui est abimée. Il y a, à l’intérieur, un tuyau apparemment mis pour canaliser l’eau qui peut-être serait perdue sans ça.
Surverse
Dans les souvenirs de Maxime Roux, la famille Jacomet avait donné un terrain pour la construction du réservoir. En échange, elle avait droit au surplus d’eau qui y arrivait, surplus qui alimentait son bassin.
Bourgade
Le bassin de la Bourgade, contrairement aux autres, n’est pas alimenté par les sources de Saint Laurent. C’est une source particulière qui l’alimente. Il y a de moins en moins d’eau. Personne ne semble connaitre l’origine de cette source et il est difficile donc de savoir si c’est la source qui baisse ou si des conduites, non connues, sont abimées.
Vocabulaire
Surverse, cheminées, ventouses, cavernes, purges, lime, etc... En plus de tout le reste, il y a de beaux mots évocateurs dans cette histoire de sources.
En 1948, Maxime Arrighi est intervenu avec son frère Jean et son oncle Arthur Brun, tous les deux maçons, sur les cavernes. Ils ont nettoyé le cours du ruisseau et construit les “cheminées”, c’est à dire les repos et sommets des puits. On voit sur la photo ci-contre le sommet du premier puits, celui qui est bouché par le limon et, au premier plan, la deuxième caverne, celle qui est abimée. Il y a, à l’intérieur, un tuyau apparemment mis pour canaliser l’eau qui peut-être serait perdue sans ça.
Surverse
Dans les souvenirs de Maxime Roux, la famille Jacomet avait donné un terrain pour la construction du réservoir. En échange, elle avait droit au surplus d’eau qui y arrivait, surplus qui alimentait son bassin.
Bourgade
Le bassin de la Bourgade, contrairement aux autres, n’est pas alimenté par les sources de Saint Laurent. C’est une source particulière qui l’alimente. Il y a de moins en moins d’eau. Personne ne semble connaitre l’origine de cette source et il est difficile donc de savoir si c’est la source qui baisse ou si des conduites, non connues, sont abimées.
Vocabulaire
Surverse, cheminées, ventouses, cavernes, purges, lime, etc... En plus de tout le reste, il y a de beaux mots évocateurs dans cette histoire de sources.
Y. T.

Le sommet du premier puits et la deuxième caverne
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Maxime est intarissable sur le sujet. Petite interview...
Yves Tardieu : Tu nous as souvent raconté des anecdotes sur l’alimentation en eau du village avant “l’eau du Rhône”. Quel était ton travail ?
Maxime Roux : L’été, toutes les semaines j’allais aux sources, une fois ou même deux, s’il y avait des problèmes. Paul Cornud me faisait boire le pastis (NDLR : Doit-on comprendre qu’il y avait aussi une source de pastis ?). Je nettoyais, j’enlevais la lime des repos. Je javellisais les cavernes. Je me fabriquais un balai sur place et je les badigeonnais, surtout au printemps. Je débroussaillais toujours un peu. Je débroussaillais chaque fois que je montais, je coupais une branche, un buisson...
A la fin, il n’y avait plus le troupeau de brebis de Cornud pour nettoyer et la dernière année la mairie m’avait acheté une débroussailleuse. Après chaque orage, je vidais les bassins du village et je purgeais la conduite, les cavernes étant fendues et l’eau du fossé se mélangeant à l’eau de source.
Y. T. : Qu’est ce que ça veut dire “je purgeais” ?
M. R. : J’évacuais la lime des tuyaux en ouvrant les purges.
Y. T. : Qu’est ce que que tu appelles les ventouses ?
M. R. : Les ventouses, c’est pour éliminer l’air dans les tuyaux. Elles sont sur les points hauts.
Y. T. : Lorsque tu coupais l’eau aux sources pour faire des réparations, combien de temps fallait-il pour qu’elle arrive au village quand tu la remettais ?
M. R. : Je sais pas, peut-être deux heures.
Y. T. : Tu m’as dit que tu coupais l’eau au village en cas de sécheresse.
M. R. : Oui, quand l’eau manquait, je laissais l’eau le matin, de 6 h à 8 h à peu près, de midi à 2 h et puis le soir de 7 h à 9 h. C’est sûr, les gens étaient pas trop contents surtout ceux qui étaient en bout de réseau et sur des points plus hauts dans le village. Ils avaient l’eau moins souvent que les autres et quelquefois pas beaucoup. Ca râlait, mais je pouvais pas faire autrement. Quelquefois ils s’attrapaient avec ton grand-père (1).
Y. T. : ...et l’histoire des boulangers ?
M. R. : A l’époque il y en avait deux... Ils avaient besoin de l’eau la nuit, surtout d’eau chaude. Alors, ils étaient obligés d’aller chercher l’eau de Saint Claude à la fontaine, de la faire chauffer, mais c’était dur et compliqué alors ils se sont plaints. Ton grand-père m’a dit de me débrouiller alors je mettais l’eau un peu dans la nuit, puis je la remettais le matin. C’était pas toujours facile.
Y. T. : L’eau des sources suffisait-elle quand même ?
M. R. : Il y avait aussi le puits des écoles qui donne bien. Il servait pour les douches municipales et l’école. Plus tard, j’ai fait mettre une pompe plus forte, c’est Vial (2) qui a installé ce moteur pour envoyer l’eau dans le réservoir. Un tuyau traverse la cour, le parking et le chemin de Suzanne et Georges Labit jusqu’à la vanne de section. C’est le père Joubert (3), garde canal, qui a fait la tranchée. Le moteur dépannait pas mal et il a été payé par “l’eau du Rhône”.
Y. T. : C’est à dire ?
M. R. : Ben, Villedieu cotisait pour l’eau du Rhône à partir de 1960 mais on ne l’avait pas. Il n’y avait pas encore les tuyaux. Alors c’est eux qui ont payé le moteur et peut-être les travaux, je ne me souviens plus.
Y. T. : Quand est-ce que l’eau du Rhône est arrivée alors ?
M. R. : Ça, je ne me souviens plus. Pendant un temps, elle arrivait à Buisson et quand il y en avait trop à Buisson le surplus venait à Villedieu. Ca a duré quelques années.
(1) Gustave Tardieu, maire de Villedieu à l’époque.
(2) Alfred Vial, beau-père de Joseph Rega, était artisan plombier à Vaison, place Montfort.
(3) Paul Joubert, père de Raymond et Pierre Joubert ainsi que de Pierrette Charrasse, était cafetier et garde-canal.
Yves Tardieu : Tu nous as souvent raconté des anecdotes sur l’alimentation en eau du village avant “l’eau du Rhône”. Quel était ton travail ?
Maxime Roux : L’été, toutes les semaines j’allais aux sources, une fois ou même deux, s’il y avait des problèmes. Paul Cornud me faisait boire le pastis (NDLR : Doit-on comprendre qu’il y avait aussi une source de pastis ?). Je nettoyais, j’enlevais la lime des repos. Je javellisais les cavernes. Je me fabriquais un balai sur place et je les badigeonnais, surtout au printemps. Je débroussaillais toujours un peu. Je débroussaillais chaque fois que je montais, je coupais une branche, un buisson...
A la fin, il n’y avait plus le troupeau de brebis de Cornud pour nettoyer et la dernière année la mairie m’avait acheté une débroussailleuse. Après chaque orage, je vidais les bassins du village et je purgeais la conduite, les cavernes étant fendues et l’eau du fossé se mélangeant à l’eau de source.
Y. T. : Qu’est ce que ça veut dire “je purgeais” ?
M. R. : J’évacuais la lime des tuyaux en ouvrant les purges.
Y. T. : Qu’est ce que que tu appelles les ventouses ?
M. R. : Les ventouses, c’est pour éliminer l’air dans les tuyaux. Elles sont sur les points hauts.
Y. T. : Lorsque tu coupais l’eau aux sources pour faire des réparations, combien de temps fallait-il pour qu’elle arrive au village quand tu la remettais ?
M. R. : Je sais pas, peut-être deux heures.
Y. T. : Tu m’as dit que tu coupais l’eau au village en cas de sécheresse.
M. R. : Oui, quand l’eau manquait, je laissais l’eau le matin, de 6 h à 8 h à peu près, de midi à 2 h et puis le soir de 7 h à 9 h. C’est sûr, les gens étaient pas trop contents surtout ceux qui étaient en bout de réseau et sur des points plus hauts dans le village. Ils avaient l’eau moins souvent que les autres et quelquefois pas beaucoup. Ca râlait, mais je pouvais pas faire autrement. Quelquefois ils s’attrapaient avec ton grand-père (1).
Y. T. : ...et l’histoire des boulangers ?
M. R. : A l’époque il y en avait deux... Ils avaient besoin de l’eau la nuit, surtout d’eau chaude. Alors, ils étaient obligés d’aller chercher l’eau de Saint Claude à la fontaine, de la faire chauffer, mais c’était dur et compliqué alors ils se sont plaints. Ton grand-père m’a dit de me débrouiller alors je mettais l’eau un peu dans la nuit, puis je la remettais le matin. C’était pas toujours facile.
Y. T. : L’eau des sources suffisait-elle quand même ?
M. R. : Il y avait aussi le puits des écoles qui donne bien. Il servait pour les douches municipales et l’école. Plus tard, j’ai fait mettre une pompe plus forte, c’est Vial (2) qui a installé ce moteur pour envoyer l’eau dans le réservoir. Un tuyau traverse la cour, le parking et le chemin de Suzanne et Georges Labit jusqu’à la vanne de section. C’est le père Joubert (3), garde canal, qui a fait la tranchée. Le moteur dépannait pas mal et il a été payé par “l’eau du Rhône”.
Y. T. : C’est à dire ?
M. R. : Ben, Villedieu cotisait pour l’eau du Rhône à partir de 1960 mais on ne l’avait pas. Il n’y avait pas encore les tuyaux. Alors c’est eux qui ont payé le moteur et peut-être les travaux, je ne me souviens plus.
Y. T. : Quand est-ce que l’eau du Rhône est arrivée alors ?
M. R. : Ça, je ne me souviens plus. Pendant un temps, elle arrivait à Buisson et quand il y en avait trop à Buisson le surplus venait à Villedieu. Ca a duré quelques années.
(1) Gustave Tardieu, maire de Villedieu à l’époque.
(2) Alfred Vial, beau-père de Joseph Rega, était artisan plombier à Vaison, place Montfort.
(3) Paul Joubert, père de Raymond et Pierre Joubert ainsi que de Pierrette Charrasse, était cafetier et garde-canal.
La mousse, le retour
La mousse sèche, certains Villadéens ont suggéré au maire de s’en débarrasser.
La question a été évoquée au conseil municipal.
Il n’est pas impossible que l’on voit bientôt l’un de ces Villadéens, pas très grand, moustachu et circulant en Express gris, « karchériser » la fontaine ainsi que le monument aux morts qui demande lui aussi à être un peu nettoyé.
La question a été évoquée au conseil municipal.
Il n’est pas impossible que l’on voit bientôt l’un de ces Villadéens, pas très grand, moustachu et circulant en Express gris, « karchériser » la fontaine ainsi que le monument aux morts qui demande lui aussi à être un peu nettoyé.
Yves Tardieu
Histoire d’eau : Font Laurent et Saint Joyeux (1er épisode)
Cette année-là, Fontjoyeuse paniquait.
La source qui, depuis toujours, depuis que mémoire d’homme existe, coule en chantant à travers les ronciers et les futaies pour rejoindre le village, la source-vie avait baissé de régime.
Le printemps avait pourtant été précoce. Les chatons, les bourgeons, les qu’en-dira-t-on avaient éclaté en même temps que les pluies tièdes, lançant haut et fort leurs coloris dans une nature malgré tout encore un peu somnolente et grise d’hiver. Mais le réveil était là, on l’entendait dans les pépiements, on le sentait dans cette sève montante qui rend tout plus vert et plus entreprenant. M’man Line n’avait pas échappé à la règle, elle faisait ces jours-là un remue-ménage indiscret et indispensable, aussi bien dehors que dedans. Ses hivers en dépendaient ! L’air était doux, sentait la tendresse des petits matins câlins, avait cette langueur qui met du temps à s’éveiller.
Tout s’était alors ranimé avec ardeur sous la fonte des neiges d’en haut et le dégel avait fait grossir les cours d’eau et les nappes mystérieuses. On entendait le travail de la terre fécondée. Comme chaque année.
Alors pourquoi ?
Pourquoi le ruisseau ne faisait-il plus autant ricocher les cailloux ?
Pourquoi les cascades s’épuisaient-elles à entretenir leurs débordements ?
Pourquoi les buissons ne faisaient-ils plus trempette ?
Et la fontaine qui rassemblait depuis des siècles tous les ragots du village s’était tue...
Etait-elle bloquée quelque part en amont comme la vie peut l’être par la petite enfance ?
Que faire sans son bavardage indiscret qui colportait tout ce qu’un village peut avoir de secrets ?
Une fontaine tarie, ce sont les potins qui se taisent du même coup.
C’est l’eau de vie qui s’en va.
Ce n’était pourtant pas œuvre d’homme. Ni Jean de Florette ni Manon des Sources n’avaient détourné son cours. Personne n’était responsable de ce caprice, si caprice il y avait.
Etait-ce un signe que quelque chose n’allait pas ?
L’eau c’est la vie, l’eau c’est le chant de la vie, depuis toujours.
Au commencement était l’eau, celle de tous les débuts, limpide, abondante, généreuse, fertile.
Dans ce monde où tout devrait couler de source, sans faire d’histoires, la fontaine prenait-elle sa revanche en se laissant désirer, en se faisant prier ? C’est le manque et l’absence qui font la valeur des choses ! On l’oublie trop souvent.
Bastien, qui connaissait tous les recoins des alentours, avait bien repéré plus haut quelques affaissements. Mais l’endroit était peu accessible et le fouillis de lianes et de ronces rendait les lieux peu accueillants. La nature avait repris ses droits là où le confort avait entretenu l’incurie des hommes.
Il fallait pourtant agir. Un village sans fontaine, même à l’heure où tout coule de tuyaux et de robinets, n’est plus un vrai village. Il fallait retrouver le chuintement de l’eau vive et permettre aux pluies et aux orages de se frayer leur chemin avant l’hiver.
On ne parlait plus que de cela alors que la sieste aurait dû endormir les langues et les idées.
Chacun y allait de ses conseils et de ses questions, chacun trouvait des explications.
- M’man Line, d’où vient l’eau de la Fontjoyeuse ?
- Comment arrive-t-elle jusqu’ici ?
- Pourquoi Fontjoyeuse ne veut-elle plus nous voir ?
M’man Line avec ses bien-tout-ça d’années ne connaissait pas les réponses. Le savoir des anciens avait déjà rejoint l’oubli avant son arrivée au village. On n’avait pas entretenu leur science, devenue inutile à l’heure de la météo prévue par satellite et des images fournies par câble. Cela faisait tant d’années que la source coulait, été comme hiver, plus personne ne se souciait encore du chemin secret qu’elle prenait pour arriver jusqu’à eux.
M’man Line avait bien sa version et la légende enchantait les grands et les petits.
- On dit que dans le monde souterrain (Théo, Maxime, Antonin, Gladys et les autres se rapprochaient, formant un cercle silencieux) ce monde à part aussi vivant que celui du dessus, on dit donc qu’il est un lieu où les eaux sont rassemblées, un lieu secret d’une étendue inconnue, mais sans doute sans limites, que seules les nymphes connaissent et fréquentent. C’est la Source Initiale, claire comme l’eau de roche. Tout coule de là. Tout part de là. Elle est faite de toutes les larmes du monde depuis la nuit des temps.
Troublante, l’eau reflète les émotions. Toutes les émotions la troublent. Elle se colore, s’irise, devient source lumineuse ou voilée, se contraste de transparence et de ténèbres. Elle bouillonne, tremble, se dissimule, elle cascade de plaisir, s’agite ou somnole, inonde et se noie de chagrin.
Cœurs gros ou débordés de bonheur s’y déversent et fondent en torrents de larmes : larmes de joie, de passion et de liesse, pleurs de détresse, vague à l’âme et autres états d’âme.
Tout perle, tout ruisselle, goutte à goutte, le long des parois enfouies dans le cœur de la terre.
Les larmes de l’enfance, pures et cristallines, ou celles figées par le froid piquant sur les joues rougies, résonnent parfois en cristal de roche transparent comme l’émotion qui les a fait naître. Il suffit de le toucher pour entendre en sourdine le chant des sentiments, ceux qui affleurent et effleurent, ceux qui chatouillent l’âme, ceux qui bouleversent et chamboulent au son grave et profond du souvenir et de la mémoire.
Tristesse et joie partagées, fusion du monde et de la nature : la neige des glaciers fond de tristesse à l’arrivée des printemps, l’automne pleure en voyant ses feuilles colorées piétinées par les gens, les brouillards ne sont que les pleurs de l’aurore, évidemment.
Après s’être toutes rassemblées, abondantes, contenues, les larmes jaillissent en fontaines, s’écoulent en ruisseaux, rebondissent en torrents. Les chaudes larmes s’élancent en geysers, et les larmes de crocodiles, ma foi, stagnent dans quelques eaux dormantes, les marais et les marécages trompeurs.
Vains regrets et chimères des cœurs de pierre s’en vont tapisser les parois de nacre dure. Avec un peu de concentration, en fermant fort les yeux, on entend un air triste et beau. Ce sont les gouttes qui perlent en notes de musique au fond de la terre. Elles se laissent d’abord aller dans les graves, parce qu’il y a plus de tristesse que d’euphorie sur terre. Puis, après leur passage dans le Grand Silence souterrain, elles chantent dans les fontaines pour rendre la joie aux hommes.
Et devenir Fontjoyeuse.
Les enfants écoutaient, des étoiles dans les yeux, les ados souriaient, ne sachant trop ce qu’ils devaient en croire. Parfois les légendes cachent un fond de vérité.
Et la vie a tant besoin de croire et de rêver.
Et puis, c’était M’man Line qui racontait, et la magie opérait dans un silence religieux.
L’enjeu prit de l’ampleur et devint le souci premier du village. On s’occupa moins de faire bouillonner les confitures que de faire frémir une source qui se cachait quelque part dans les profondeurs.
Cette eau, il fallait la retrouver, où qu’elle se cachât. Sans elle, que deviendrait la place, lieu de rencontres, que deviendraient les siestes éveillées et feintes autour de la fontaine ?
Euphémie la bien nommée fit la gazette et sonna le rassemblement, mobilisa les troupes.
L’aventure commença au petit matin, à l’heure où l’aube sort à peine de ses paresses nocturnes : un demi-jour qui se répand sur un monde en demi-teinte.
La lumière commençait seulement à chuchoter et à flirter avec la nature.
Les plans anciens qu’Euphémie avait dénichés dans les archives jaunies ne laissaient que peu de doute sur l’emplacement probable des problèmes. Il fallait remonter le ru jusqu’à la source.
Ils avaient donc traversé le pont du bout du village qui enjambait la Fontjoyeuse, toute calmée, avaient dépassé le gué aux bièvres, bifurqué vers les collines, longeant un moment le lit asséché du ruisseau, empruntant ensuite les chemins et sentiers qui bordent encore quelques propriétés de terres cultivées. Plus loin, les cultures laissent le champ libre à la nature exubérante et sauvage, celle qu’ils devaient affronter pour avoir accès aux sources qui alimentaient la fontaine.
On dérangea les bruits de la nuit, les frôlements, les murmures, on déplaça les ombres qui rôdaient encore, on écarta le silence en même temps que les branches.
Bastien, fier et triomphant par le rôle qu’on lui avait attribué, ouvrait la marche.
Munis de la serpe des druides, de la tronçonneuse du brico, d’une bonne trentaine de bras et d’une vaillante humeur qui résonnait partout, en file indienne, ils se frayèrent un passage à travers les taillis, jusque bien au-delà du pont.
Plus haut encore, c’est le monde des origines que l’on découvre, inextricable, l’enchevêtrement à l’état brut, la nature laissée à elle-même.
Foisonnement.
On taille ce passage initiatique, la montée aux sources, et chacun se sent plongé au cœur d’un monde impénétrable surgi du fin fond des mémoires.
Et on débroussaille,
on taille,
on coupe,
on lacère,
on tranche dans le vif de cette nature qui a ses droits et qui les revendique pleinement dans ces coins reculés.
On se taille un chemin dans l’histoire ancienne,
on traverse le Temps,
on chemine dans les souvenirs,
on abolit les âges et la distance des générations.
L’intrusion est manifeste.
Cannelle la chienne, la truffe humide à l’air, la queue frétillante, fourrage partout. Une chasse improvisée. L’aubaine !
Des images submergent les pensées : c’est ainsi que les découvreurs de terres nouvelles devaient se faufiler, que les moines devaient défricher, déraciner, creuser, aménager.
Nature originelle, très lentement canalisée.
Derrière eux ils laissent des brèches.
On s’enfonce, toujours,
on s’engouffre,
on écoute.
Tous les sens en éveil.
Au-delà de la cognée, le silence fait entendre le rythme de la terre. Elle chante.
Mais les apprécie-t-on encore ces palpitements, ces pépiements qui sourdent de la terre remuée, ces senteurs de bois coupé qui se mélangent à l’humus foulé ?
La moiteur, le fenouil sauvage, la transpiration, la sève, le fruit du cornouiller. En cadence. Fugaces.
Tout trouble ici. La beauté du lieu, le silence, la touffeur, l’esprit d’un passé qui plane, la vie en sourdine.
Mémoire. Conscience. Ici on se l’approprie.
Racines, troncs, écorces, feuillages, branchages.
Feuilles piétinées, fruits écrasés.
Echardes de bois, épines enfoncées.
Le clair, l’obscur.
Tout rappelle le Tout.
C’est fascinant.
Caprices et constances. Enigme et mystère.
L’avenir ici est dans le passé : le temps se vit à rebours. Sévit à rebrousse-poil.
Se trouver en plein XXIe siècle à la recherche d’une source, le tableau est rare, grandiose, mais le constat, à l’échelle mondiale, impitoyable : l’homme est dupe de son propre génie, de son manque de lucidité et de prévoyance.
Qu’avons-nous fait des connaissances ancestrales, des efforts fournis au cours de tous ces siècles, des célébrations devant la folie-nature ?
Ont-ils parié sur leur descendance ?
Allons-nous miser sur la nôtre ?
L’homme moderne et sa jouissance immédiate sont-il encore fait pour la nature ?
Jouer sur le long terme est si peu dans l’air du temps.
(à suivre)...
La source qui, depuis toujours, depuis que mémoire d’homme existe, coule en chantant à travers les ronciers et les futaies pour rejoindre le village, la source-vie avait baissé de régime.
Le printemps avait pourtant été précoce. Les chatons, les bourgeons, les qu’en-dira-t-on avaient éclaté en même temps que les pluies tièdes, lançant haut et fort leurs coloris dans une nature malgré tout encore un peu somnolente et grise d’hiver. Mais le réveil était là, on l’entendait dans les pépiements, on le sentait dans cette sève montante qui rend tout plus vert et plus entreprenant. M’man Line n’avait pas échappé à la règle, elle faisait ces jours-là un remue-ménage indiscret et indispensable, aussi bien dehors que dedans. Ses hivers en dépendaient ! L’air était doux, sentait la tendresse des petits matins câlins, avait cette langueur qui met du temps à s’éveiller.
Tout s’était alors ranimé avec ardeur sous la fonte des neiges d’en haut et le dégel avait fait grossir les cours d’eau et les nappes mystérieuses. On entendait le travail de la terre fécondée. Comme chaque année.
Alors pourquoi ?
Pourquoi le ruisseau ne faisait-il plus autant ricocher les cailloux ?
Pourquoi les cascades s’épuisaient-elles à entretenir leurs débordements ?
Pourquoi les buissons ne faisaient-ils plus trempette ?
Et la fontaine qui rassemblait depuis des siècles tous les ragots du village s’était tue...
Etait-elle bloquée quelque part en amont comme la vie peut l’être par la petite enfance ?
Que faire sans son bavardage indiscret qui colportait tout ce qu’un village peut avoir de secrets ?
Une fontaine tarie, ce sont les potins qui se taisent du même coup.
C’est l’eau de vie qui s’en va.
Ce n’était pourtant pas œuvre d’homme. Ni Jean de Florette ni Manon des Sources n’avaient détourné son cours. Personne n’était responsable de ce caprice, si caprice il y avait.
Etait-ce un signe que quelque chose n’allait pas ?
L’eau c’est la vie, l’eau c’est le chant de la vie, depuis toujours.
Au commencement était l’eau, celle de tous les débuts, limpide, abondante, généreuse, fertile.
Dans ce monde où tout devrait couler de source, sans faire d’histoires, la fontaine prenait-elle sa revanche en se laissant désirer, en se faisant prier ? C’est le manque et l’absence qui font la valeur des choses ! On l’oublie trop souvent.
Bastien, qui connaissait tous les recoins des alentours, avait bien repéré plus haut quelques affaissements. Mais l’endroit était peu accessible et le fouillis de lianes et de ronces rendait les lieux peu accueillants. La nature avait repris ses droits là où le confort avait entretenu l’incurie des hommes.
Il fallait pourtant agir. Un village sans fontaine, même à l’heure où tout coule de tuyaux et de robinets, n’est plus un vrai village. Il fallait retrouver le chuintement de l’eau vive et permettre aux pluies et aux orages de se frayer leur chemin avant l’hiver.
On ne parlait plus que de cela alors que la sieste aurait dû endormir les langues et les idées.
Chacun y allait de ses conseils et de ses questions, chacun trouvait des explications.
- M’man Line, d’où vient l’eau de la Fontjoyeuse ?
- Comment arrive-t-elle jusqu’ici ?
- Pourquoi Fontjoyeuse ne veut-elle plus nous voir ?
M’man Line avec ses bien-tout-ça d’années ne connaissait pas les réponses. Le savoir des anciens avait déjà rejoint l’oubli avant son arrivée au village. On n’avait pas entretenu leur science, devenue inutile à l’heure de la météo prévue par satellite et des images fournies par câble. Cela faisait tant d’années que la source coulait, été comme hiver, plus personne ne se souciait encore du chemin secret qu’elle prenait pour arriver jusqu’à eux.
M’man Line avait bien sa version et la légende enchantait les grands et les petits.
- On dit que dans le monde souterrain (Théo, Maxime, Antonin, Gladys et les autres se rapprochaient, formant un cercle silencieux) ce monde à part aussi vivant que celui du dessus, on dit donc qu’il est un lieu où les eaux sont rassemblées, un lieu secret d’une étendue inconnue, mais sans doute sans limites, que seules les nymphes connaissent et fréquentent. C’est la Source Initiale, claire comme l’eau de roche. Tout coule de là. Tout part de là. Elle est faite de toutes les larmes du monde depuis la nuit des temps.
Troublante, l’eau reflète les émotions. Toutes les émotions la troublent. Elle se colore, s’irise, devient source lumineuse ou voilée, se contraste de transparence et de ténèbres. Elle bouillonne, tremble, se dissimule, elle cascade de plaisir, s’agite ou somnole, inonde et se noie de chagrin.
Cœurs gros ou débordés de bonheur s’y déversent et fondent en torrents de larmes : larmes de joie, de passion et de liesse, pleurs de détresse, vague à l’âme et autres états d’âme.
Tout perle, tout ruisselle, goutte à goutte, le long des parois enfouies dans le cœur de la terre.
Les larmes de l’enfance, pures et cristallines, ou celles figées par le froid piquant sur les joues rougies, résonnent parfois en cristal de roche transparent comme l’émotion qui les a fait naître. Il suffit de le toucher pour entendre en sourdine le chant des sentiments, ceux qui affleurent et effleurent, ceux qui chatouillent l’âme, ceux qui bouleversent et chamboulent au son grave et profond du souvenir et de la mémoire.
Tristesse et joie partagées, fusion du monde et de la nature : la neige des glaciers fond de tristesse à l’arrivée des printemps, l’automne pleure en voyant ses feuilles colorées piétinées par les gens, les brouillards ne sont que les pleurs de l’aurore, évidemment.
Après s’être toutes rassemblées, abondantes, contenues, les larmes jaillissent en fontaines, s’écoulent en ruisseaux, rebondissent en torrents. Les chaudes larmes s’élancent en geysers, et les larmes de crocodiles, ma foi, stagnent dans quelques eaux dormantes, les marais et les marécages trompeurs.
Vains regrets et chimères des cœurs de pierre s’en vont tapisser les parois de nacre dure. Avec un peu de concentration, en fermant fort les yeux, on entend un air triste et beau. Ce sont les gouttes qui perlent en notes de musique au fond de la terre. Elles se laissent d’abord aller dans les graves, parce qu’il y a plus de tristesse que d’euphorie sur terre. Puis, après leur passage dans le Grand Silence souterrain, elles chantent dans les fontaines pour rendre la joie aux hommes.
Et devenir Fontjoyeuse.
Les enfants écoutaient, des étoiles dans les yeux, les ados souriaient, ne sachant trop ce qu’ils devaient en croire. Parfois les légendes cachent un fond de vérité.
Et la vie a tant besoin de croire et de rêver.
Et puis, c’était M’man Line qui racontait, et la magie opérait dans un silence religieux.
L’enjeu prit de l’ampleur et devint le souci premier du village. On s’occupa moins de faire bouillonner les confitures que de faire frémir une source qui se cachait quelque part dans les profondeurs.
Cette eau, il fallait la retrouver, où qu’elle se cachât. Sans elle, que deviendrait la place, lieu de rencontres, que deviendraient les siestes éveillées et feintes autour de la fontaine ?
Euphémie la bien nommée fit la gazette et sonna le rassemblement, mobilisa les troupes.
L’aventure commença au petit matin, à l’heure où l’aube sort à peine de ses paresses nocturnes : un demi-jour qui se répand sur un monde en demi-teinte.
La lumière commençait seulement à chuchoter et à flirter avec la nature.
Les plans anciens qu’Euphémie avait dénichés dans les archives jaunies ne laissaient que peu de doute sur l’emplacement probable des problèmes. Il fallait remonter le ru jusqu’à la source.
Ils avaient donc traversé le pont du bout du village qui enjambait la Fontjoyeuse, toute calmée, avaient dépassé le gué aux bièvres, bifurqué vers les collines, longeant un moment le lit asséché du ruisseau, empruntant ensuite les chemins et sentiers qui bordent encore quelques propriétés de terres cultivées. Plus loin, les cultures laissent le champ libre à la nature exubérante et sauvage, celle qu’ils devaient affronter pour avoir accès aux sources qui alimentaient la fontaine.
On dérangea les bruits de la nuit, les frôlements, les murmures, on déplaça les ombres qui rôdaient encore, on écarta le silence en même temps que les branches.
Bastien, fier et triomphant par le rôle qu’on lui avait attribué, ouvrait la marche.
Munis de la serpe des druides, de la tronçonneuse du brico, d’une bonne trentaine de bras et d’une vaillante humeur qui résonnait partout, en file indienne, ils se frayèrent un passage à travers les taillis, jusque bien au-delà du pont.
Plus haut encore, c’est le monde des origines que l’on découvre, inextricable, l’enchevêtrement à l’état brut, la nature laissée à elle-même.
Foisonnement.
On taille ce passage initiatique, la montée aux sources, et chacun se sent plongé au cœur d’un monde impénétrable surgi du fin fond des mémoires.
Et on débroussaille,
on taille,
on coupe,
on lacère,
on tranche dans le vif de cette nature qui a ses droits et qui les revendique pleinement dans ces coins reculés.
On se taille un chemin dans l’histoire ancienne,
on traverse le Temps,
on chemine dans les souvenirs,
on abolit les âges et la distance des générations.
L’intrusion est manifeste.
Cannelle la chienne, la truffe humide à l’air, la queue frétillante, fourrage partout. Une chasse improvisée. L’aubaine !
Des images submergent les pensées : c’est ainsi que les découvreurs de terres nouvelles devaient se faufiler, que les moines devaient défricher, déraciner, creuser, aménager.
Nature originelle, très lentement canalisée.
Derrière eux ils laissent des brèches.
On s’enfonce, toujours,
on s’engouffre,
on écoute.
Tous les sens en éveil.
Au-delà de la cognée, le silence fait entendre le rythme de la terre. Elle chante.
Mais les apprécie-t-on encore ces palpitements, ces pépiements qui sourdent de la terre remuée, ces senteurs de bois coupé qui se mélangent à l’humus foulé ?
La moiteur, le fenouil sauvage, la transpiration, la sève, le fruit du cornouiller. En cadence. Fugaces.
Tout trouble ici. La beauté du lieu, le silence, la touffeur, l’esprit d’un passé qui plane, la vie en sourdine.
Mémoire. Conscience. Ici on se l’approprie.
Racines, troncs, écorces, feuillages, branchages.
Feuilles piétinées, fruits écrasés.
Echardes de bois, épines enfoncées.
Le clair, l’obscur.
Tout rappelle le Tout.
C’est fascinant.
Caprices et constances. Enigme et mystère.
L’avenir ici est dans le passé : le temps se vit à rebours. Sévit à rebrousse-poil.
Se trouver en plein XXIe siècle à la recherche d’une source, le tableau est rare, grandiose, mais le constat, à l’échelle mondiale, impitoyable : l’homme est dupe de son propre génie, de son manque de lucidité et de prévoyance.
Qu’avons-nous fait des connaissances ancestrales, des efforts fournis au cours de tous ces siècles, des célébrations devant la folie-nature ?
Ont-ils parié sur leur descendance ?
Allons-nous miser sur la nôtre ?
L’homme moderne et sa jouissance immédiate sont-il encore fait pour la nature ?
Jouer sur le long terme est si peu dans l’air du temps.
(à suivre)...
Marie-Henriette Quettier



Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Histoire d’eau : Font Laurent et Saint Joyeux (2ème épisode)
Nous avons publié dans notre précédent numéro le début d’un conte de Marie-Henriette Quettier : une histoire de fontaine, de sources, de chaleur, d’eau et de mousse... En voici la suite. La fin dans notre prochain numéro.
Chaque pas est une réflexion, chaque enjambée une connivence avec le Temps, majuscule, chaque avancée un face à face vertigineux avec la vie oubliée.
Et un engagement, lourd de sens, pour l’ici-bas.
Pour chacun d’entre nous.
Le sol s’arc-boute, la pente s’amorce.
Vers où ? Les chemins sont depuis longtemps effacés. On a oublié la configuration du lieu malgré les cartes et les relevés de précision. Qui sait encore qu’un petit étang étale ici ses eaux dormantes ? Qui voit encore que la sécheresse n’est qu’apparente et qu’au-delà de ces apparences la sève est riche, la terre gonfle laissant échapper ombelles et épis, le bois se charpente, d’année en année plus fougueux et plus entreprenant avec les lisières.
L’étang oublié, retourné à l’état sauvage, les chemins rendus inaccessibles en disent bien long sur les lieux. Combien de couples pourtant ont dû se retrouver dans ce coin de paradis, cachant des amours secrètes, jouissant, intimidés, de quelques moments de liberté et d’un premier baiser. Combien rêvent-ils encore de ces heures tranquilles, loin de tout, pour vivre le silence de leurs émotions ?
L’étang auréolé brille encore des serments échangés. Il esquisse encore, au plus profond, leur image reflétée, enlacés et complices. Inattendu, insolite, un nénuphar surprend, s’étale, ses couleurs explosent dans le décor sombre. La lumière joue dans l’étang, ricoche sur les ronds de l’eau, se mire dans l’immense feuille, s’arrête au creux de la berge. Malgré l’eau croupie, elle miroite, folle, éclate en clartés aveuglantes, feux de la rampe pour le ballet d’insectes qui se joue à la surface.
Images volées...
Privilège.
Souffle coupé, on prend davantage conscience du message : il est Temps de renouer des liens, denses, avec la nature si peu respectée.
Grand temps.
L’évolution aurait-elle fait tourner la tête à l’homme qui ne se soucie plus de l’essentiel ?
(à suivre)...
Chaque pas est une réflexion, chaque enjambée une connivence avec le Temps, majuscule, chaque avancée un face à face vertigineux avec la vie oubliée.
Et un engagement, lourd de sens, pour l’ici-bas.
Pour chacun d’entre nous.
Le sol s’arc-boute, la pente s’amorce.
Vers où ? Les chemins sont depuis longtemps effacés. On a oublié la configuration du lieu malgré les cartes et les relevés de précision. Qui sait encore qu’un petit étang étale ici ses eaux dormantes ? Qui voit encore que la sécheresse n’est qu’apparente et qu’au-delà de ces apparences la sève est riche, la terre gonfle laissant échapper ombelles et épis, le bois se charpente, d’année en année plus fougueux et plus entreprenant avec les lisières.
L’étang oublié, retourné à l’état sauvage, les chemins rendus inaccessibles en disent bien long sur les lieux. Combien de couples pourtant ont dû se retrouver dans ce coin de paradis, cachant des amours secrètes, jouissant, intimidés, de quelques moments de liberté et d’un premier baiser. Combien rêvent-ils encore de ces heures tranquilles, loin de tout, pour vivre le silence de leurs émotions ?
L’étang auréolé brille encore des serments échangés. Il esquisse encore, au plus profond, leur image reflétée, enlacés et complices. Inattendu, insolite, un nénuphar surprend, s’étale, ses couleurs explosent dans le décor sombre. La lumière joue dans l’étang, ricoche sur les ronds de l’eau, se mire dans l’immense feuille, s’arrête au creux de la berge. Malgré l’eau croupie, elle miroite, folle, éclate en clartés aveuglantes, feux de la rampe pour le ballet d’insectes qui se joue à la surface.
Images volées...
Privilège.
Souffle coupé, on prend davantage conscience du message : il est Temps de renouer des liens, denses, avec la nature si peu respectée.
Grand temps.
L’évolution aurait-elle fait tourner la tête à l’homme qui ne se soucie plus de l’essentiel ?
(à suivre)...
Histoire d’eau : Font Laurent et Saint Joyeux (3ème épisode) [ par Marie-Henriette Quettier]
Le soleil accable à présent, implacable, cuisant, malgré le tamis du sous-bois. La lumière qui s’accroche aux branches en dégringolant des cimes, lumière ardente de midi, embrase tout et fait se gondoler les choses. Les contours se liquéfient dans la sueur, la poussière y laisse des traces noirâtres. Les torses dénudés suintent la chaleur méridienne, les fronts dégoulinent. La transpiration, moite et salée, aveugle et donne soif, les corps exténués se courbent et s’ankylosent sous l’effort dans un jeu d’ombre et de lumière.
Mètre après mètre, une éclaircie s’ouvre dans le demi-jour du sous-bois. La lumière, tamisée, dégagée, s’infiltre dans la clairière débroussaillée. Il y a ce désir violent d’avancer dans cette jungle, de terminer le travail, de découvrir la faille qui empêche l’eau de couler. Les bras continuent leurs mouvements mécaniques. Les pieds trouvent leur équilibre entre les ronces et les cailloux. Des ahans musclés, saccadés, viennent à bout de cette végétation qui s’est lignifiée.
Ils sont intrépides, décidés à affronter les obstacles malgré la fatigue, la touffeur, les épines.
Là.
Une grotte se laisse découvrir dans la pénombre, s’offre à la vue de chacun, se laisse péné-trer, fraîche et vivante, pure, humide, recueillant les mystères de la terre : les gouttes sont là, égrenant leur murmure, laissant filer une pudeur secrète.
L’eau coule.
Rassemblée, elle grossit, féconde.
Canalisée par les anciens qui l’ont domptée, elle concentre ce que la nature prodigue de forces.
Elle est là, essentielle, originelle.
Les efforts doivent à présent se porter en aval.
Mais la peur est apaisée.
Midi opaque. Midi oppresse. Midi opprime.
Seul le frémissement des insectes dérangés, battant l’air de leurs ailes transparentes, anime toute cette immobilité, figée dans la somnolente chaleur qui a envahi jusqu’à la plus petite parcelle de vie.
Ils sont pourtant résolus à en découdre et à vaincre aussi la terre qui recouvre les puisards et qu’il faut maintenant dégager à tout prix.
Autre obstacle. Autre ennemi.
D’abord les localiser : il doit y en avoir un tous les trente mètres, c’était la norme. En ligne droite.
Là un coin de pierre apparaît, n’intrigue même pas : la chance les accompagne. C’est la première pièce du jeu de piste. On subodore, on mesure, - un pas, un mètre -, on évalue.
Pendant que les uns s’activent encore à la débroussailleuse, d’autres empoignent la bêche et la pioche, dégagent, tracent, détourent la dalle.
Travail de fourmi, plaisir d’archéologue. Autre vestige d’un monde oublié. Autre écho du passé.
Un puits est là qui livre enfin le secret : des racines vives ont tracé leur voie, enchevêtrée, et la terre a colmaté les interstices ne laissant plus, au fil des ans, qu’une mince infiltration qui a fini par se tarir dans l’éboulement.
Il faudra encore revenir quelques fois, mais on a déjà pu localiser un autre problème : entre deux puisards, la canalisation ancestrale est effondrée sur elle-même.
Non, la source n’est pas tarie, mais déviée.
L’eau suinte toujours des entrailles de la terre, mais, contrariée, elle a cherché ailleurs son chemin, ouvrant d’autres brèches, creusant avec patience. Forçant l’homme à se réveiller.
Le Temps n’a cure des raccourcis…
Il est largement deux heures quand on songe au pique-nique apporté dans les paniers d’osier et les frigobox. L’ambiance transpire à présent de bonne humeur et d’efforts, de rires, de sérieux aussi quand il s’agit d’estimer le coût des travaux et la façon d’aborder le plus facilement ce coin retiré des routes et des chemins. Une mini-pelle, un petit tracteur, une benne devraient pouvoir arriver jusque-là. Un passage leur est taillé dans cette nature sauvageonne.
Les travaux terminés, la source pourra à nouveau être recueillie dans le bassin d’en-bas.
L’aventure les a noués les uns aux autres. Ils ne regarderont plus la fontaine de la même façon. Et l’eau, celle qui désaltère, n’aura plus le même goût lorsqu’ils la recevront à la source du village. Elle ne sera plus incolore, inodore et insipide.
Elle aura la saveur chaude d’un souvenir, elle chantera l’effort, la fascination et la persévérance,elle sera communication et musique. Le bassin moussu sera à nouveau au centre de la vie du village et les becs en gueules de lions déborderont en cascades vers les quatre points cardinaux, remplissant d’eau limpide les verres de pastis servis au café du centre.On fera à nouveau la causette.
Ils retrouveront les siestes tranquilles sur la place, à l’ombre des platanes pelés, ils écouteront à nouveau les cancans, les nouvelles et querelles qui trament l’histoire des petits villages.
(Fin).
Mètre après mètre, une éclaircie s’ouvre dans le demi-jour du sous-bois. La lumière, tamisée, dégagée, s’infiltre dans la clairière débroussaillée. Il y a ce désir violent d’avancer dans cette jungle, de terminer le travail, de découvrir la faille qui empêche l’eau de couler. Les bras continuent leurs mouvements mécaniques. Les pieds trouvent leur équilibre entre les ronces et les cailloux. Des ahans musclés, saccadés, viennent à bout de cette végétation qui s’est lignifiée.
Ils sont intrépides, décidés à affronter les obstacles malgré la fatigue, la touffeur, les épines.
Là.
Une grotte se laisse découvrir dans la pénombre, s’offre à la vue de chacun, se laisse péné-trer, fraîche et vivante, pure, humide, recueillant les mystères de la terre : les gouttes sont là, égrenant leur murmure, laissant filer une pudeur secrète.
L’eau coule.
Rassemblée, elle grossit, féconde.
Canalisée par les anciens qui l’ont domptée, elle concentre ce que la nature prodigue de forces.
Elle est là, essentielle, originelle.
Les efforts doivent à présent se porter en aval.
Mais la peur est apaisée.
Midi opaque. Midi oppresse. Midi opprime.
Seul le frémissement des insectes dérangés, battant l’air de leurs ailes transparentes, anime toute cette immobilité, figée dans la somnolente chaleur qui a envahi jusqu’à la plus petite parcelle de vie.
Ils sont pourtant résolus à en découdre et à vaincre aussi la terre qui recouvre les puisards et qu’il faut maintenant dégager à tout prix.
Autre obstacle. Autre ennemi.
D’abord les localiser : il doit y en avoir un tous les trente mètres, c’était la norme. En ligne droite.
Là un coin de pierre apparaît, n’intrigue même pas : la chance les accompagne. C’est la première pièce du jeu de piste. On subodore, on mesure, - un pas, un mètre -, on évalue.
Pendant que les uns s’activent encore à la débroussailleuse, d’autres empoignent la bêche et la pioche, dégagent, tracent, détourent la dalle.
Travail de fourmi, plaisir d’archéologue. Autre vestige d’un monde oublié. Autre écho du passé.
Un puits est là qui livre enfin le secret : des racines vives ont tracé leur voie, enchevêtrée, et la terre a colmaté les interstices ne laissant plus, au fil des ans, qu’une mince infiltration qui a fini par se tarir dans l’éboulement.
Il faudra encore revenir quelques fois, mais on a déjà pu localiser un autre problème : entre deux puisards, la canalisation ancestrale est effondrée sur elle-même.
Non, la source n’est pas tarie, mais déviée.
L’eau suinte toujours des entrailles de la terre, mais, contrariée, elle a cherché ailleurs son chemin, ouvrant d’autres brèches, creusant avec patience. Forçant l’homme à se réveiller.
Le Temps n’a cure des raccourcis…
Il est largement deux heures quand on songe au pique-nique apporté dans les paniers d’osier et les frigobox. L’ambiance transpire à présent de bonne humeur et d’efforts, de rires, de sérieux aussi quand il s’agit d’estimer le coût des travaux et la façon d’aborder le plus facilement ce coin retiré des routes et des chemins. Une mini-pelle, un petit tracteur, une benne devraient pouvoir arriver jusque-là. Un passage leur est taillé dans cette nature sauvageonne.
Les travaux terminés, la source pourra à nouveau être recueillie dans le bassin d’en-bas.
L’aventure les a noués les uns aux autres. Ils ne regarderont plus la fontaine de la même façon. Et l’eau, celle qui désaltère, n’aura plus le même goût lorsqu’ils la recevront à la source du village. Elle ne sera plus incolore, inodore et insipide.
Elle aura la saveur chaude d’un souvenir, elle chantera l’effort, la fascination et la persévérance,elle sera communication et musique. Le bassin moussu sera à nouveau au centre de la vie du village et les becs en gueules de lions déborderont en cascades vers les quatre points cardinaux, remplissant d’eau limpide les verres de pastis servis au café du centre.On fera à nouveau la causette.
Ils retrouveront les siestes tranquilles sur la place, à l’ombre des platanes pelés, ils écouteront à nouveau les cancans, les nouvelles et querelles qui trament l’histoire des petits villages.
(Fin).
Le mercredi 29 juin, un rendez-vous avait été fixé à la Vigneronne à 6h du matin, aux adhérents du Canal du Moulin, afin d’enlever les végétaux qui empêchent le bon écoulement de l’eau. En différents endroits, sur une longueur d’environ un kilomètre, la présence d’une plante, l’élodée du Canada, constitue à elle seule un problème majeur. Vivant directement dans l’eau, elle finit par s’accumuler sur une épaisseur de trente centimètres en formant un barrage avec une quasi-stagnation de l’eau.
A son crédit, elle s’enlève très facilement avec un simple râteau de jardinier, de plus elle filtre et oxygène le milieu aquatique. Néanmoins, le canal n’étant pas un étang, certains attendent de pouvoir irriguer leurs terres, surtout dans les sections en aval. Nous étions donc 14 volontaires, prêts à en découdre avec l’élodée, le cresson, l’épilobe, le faux-cresson, et les canéu, universellement désignés sous le nom de Phrognites et voués à un grand avenir dans les stations d’épuration du XXI° siècle. Nous étions armés d’outils, râteau, cisaille, fourche et le râteau à dents triangulaires qui mériterait un article à lui seul. On déplorera l’absence de la faux à lames courtes qui permet de couper les herbes de gros diamètres. La pelle ne fut pas nécessaire du moins en cette saison (on en reparlera cet hiver).
C’est ainsi qu’à l’heure du casse-croûte, vers 10h du matin, au gros chêne, des cyclistes brillamment vêtus et casqués, peut-être même sentant la savonnette, ont pu croiser un étrange concert de personnes boueuses, terreuses et plus ou moins en habits de circonstance, bottées et détrempées jusqu’au couillon. Malgré cette tenue de camouflage on pouvait reconnaître : Alain Bertrand, André Bertrand, Daniel Bertrand, Lucien Bertrand, Yvon Bertrand, Claude Cellier, Gilbert Daniel, Pierre Dieu, François Dénéréaz, André Macabet, Alain Monteil, Daniel Monteil, Jacky Nancy, et Alain Ripert.
Cette matinée de nettoyage a pu mettre en évidence le problème de l’engorgement de la caverne, 40 cm de lime, dû en bonne partie aux fossés situés à la sortie qui s’en vont en ligne droite le long du C.D.7, pour ensuite bifurquer deux fois en direction des L’Homme. Ces fossés profonds d’environ trois mètres présentent un défaut d’écoulement, l’eau pouvant monter jusqu’à un mètre, refoulant ainsi le précieux liquide à l’intérieur de l’ouvrage qui court souterrainement sur 150 mètres de longueur.
Bref, après un nettoyage et arrachage des végétaux, une bonne partie du gonfle s’est dégonflé et l’eau est repartie dans la bonne direction. Pour quelque temps, les choses iront normalement. En attendant d’effectuer un travail plus conséquent qui nécessitera des moyens plus importants et un redressage du lit du canal à cet endroit. Une demande d’aide va être faite prochainement au Conseil général et au Conseil régional afin de réaliser ceci.
En fin de matinée, après vérification des travaux et fermeture des martelières, nous nous quittâmes. Il fut décider de revoir le travail dans trois semaines, sauf circonstances exceptionnelles, nécessitant une intervention immédiate. Il a été envisagé de procéder de la même façon cet hiver, en février, au nettoyage du canal. Trois jours de travail seront nécessaires avec une équipe de 15 personnes et plus, afin d’économiser la recette des cotisations, conforter nos finances et envisager des travaux avec des outils mécaniques (pelle, tracto, etc...). Que toutes les bonnes volontés se manifestent dès maintenant afin de nous permettre de nous organiser.
A son crédit, elle s’enlève très facilement avec un simple râteau de jardinier, de plus elle filtre et oxygène le milieu aquatique. Néanmoins, le canal n’étant pas un étang, certains attendent de pouvoir irriguer leurs terres, surtout dans les sections en aval. Nous étions donc 14 volontaires, prêts à en découdre avec l’élodée, le cresson, l’épilobe, le faux-cresson, et les canéu, universellement désignés sous le nom de Phrognites et voués à un grand avenir dans les stations d’épuration du XXI° siècle. Nous étions armés d’outils, râteau, cisaille, fourche et le râteau à dents triangulaires qui mériterait un article à lui seul. On déplorera l’absence de la faux à lames courtes qui permet de couper les herbes de gros diamètres. La pelle ne fut pas nécessaire du moins en cette saison (on en reparlera cet hiver).
C’est ainsi qu’à l’heure du casse-croûte, vers 10h du matin, au gros chêne, des cyclistes brillamment vêtus et casqués, peut-être même sentant la savonnette, ont pu croiser un étrange concert de personnes boueuses, terreuses et plus ou moins en habits de circonstance, bottées et détrempées jusqu’au couillon. Malgré cette tenue de camouflage on pouvait reconnaître : Alain Bertrand, André Bertrand, Daniel Bertrand, Lucien Bertrand, Yvon Bertrand, Claude Cellier, Gilbert Daniel, Pierre Dieu, François Dénéréaz, André Macabet, Alain Monteil, Daniel Monteil, Jacky Nancy, et Alain Ripert.
Cette matinée de nettoyage a pu mettre en évidence le problème de l’engorgement de la caverne, 40 cm de lime, dû en bonne partie aux fossés situés à la sortie qui s’en vont en ligne droite le long du C.D.7, pour ensuite bifurquer deux fois en direction des L’Homme. Ces fossés profonds d’environ trois mètres présentent un défaut d’écoulement, l’eau pouvant monter jusqu’à un mètre, refoulant ainsi le précieux liquide à l’intérieur de l’ouvrage qui court souterrainement sur 150 mètres de longueur.
Bref, après un nettoyage et arrachage des végétaux, une bonne partie du gonfle s’est dégonflé et l’eau est repartie dans la bonne direction. Pour quelque temps, les choses iront normalement. En attendant d’effectuer un travail plus conséquent qui nécessitera des moyens plus importants et un redressage du lit du canal à cet endroit. Une demande d’aide va être faite prochainement au Conseil général et au Conseil régional afin de réaliser ceci.
En fin de matinée, après vérification des travaux et fermeture des martelières, nous nous quittâmes. Il fut décider de revoir le travail dans trois semaines, sauf circonstances exceptionnelles, nécessitant une intervention immédiate. Il a été envisagé de procéder de la même façon cet hiver, en février, au nettoyage du canal. Trois jours de travail seront nécessaires avec une équipe de 15 personnes et plus, afin d’économiser la recette des cotisations, conforter nos finances et envisager des travaux avec des outils mécaniques (pelle, tracto, etc...). Que toutes les bonnes volontés se manifestent dès maintenant afin de nous permettre de nous organiser.

Élodée du Canada...
Ali Baba
A Villedieu, il existe une caverne mais elle n’est pas naturelle et encore moins une simple cavité creusée dans le sol afin de fournir un abri. La plupart des gens aujourd’hui ignorent son existence ou tout au plus en ont-ils entendu parler. En fait, il s’agit d’un ouvrage d’art dissimulé, bien sûr, à la vue des passants et dont l’existence mériterait une certaine reconnaissance et peut-être même son inscription au registre de ce qui est à voir et à protéger.
En bref, il suffit de dire que sa longueur est de 150 mètres enterrés, cela va de soi, sous une épaisseur de quelques mètres de terrain qui sans doute ont justifié sa construction en pierres de taille.
D’une hauteur et d’une largeur juste suffisantes au passage d’un être humain, cette caverne est parfaitement rectiligne. Nous pouvons apercevoir depuis son entrée une faible lueur dans l’obscurité qui révèle quelque part sa sortie.
En fait, une fois la plaque en fer ôtée de l’entrée, nous découvrons un aqueduc souterrain qui se trouve à la limite de Mirabel et de Villedieu, dissimulé dans le ravin de la combe et courant sous un coteau planté de vignes. Une maison est même construite un peu avant la sortie à la verticale de cet ouvrage.
Nul ne sait à ce jour quand et par qui cet aqueduc a été construit. Toujours en activité celui-ci sert à l’arrosage des terres de Villedieu qui bordent l’Aygues.
Pourquoi une telle construction dont le coût aujourd’hui serait exorbitant ?
A cet endroit, le canal, en amont à l’air libre, aurait pu simplement contourner le coteau et rester à découvert. Peut-être la proximité de l’Aygues y est-elle pour quelque chose ? D’autre part il eut été difficile de récupérer la perte de la pente et son passage à l’air libre dans le coteau aurait eu pour résultat le creusement d’un fossé trop profond.
L’aqueduc mesure environ 1,50 m de hauteur sans compter la lime qui s’est accumulée dans son fond. Son ouverture est d’un peu plus de 90 cm. Sa clé de voûte mesure 24 cm. La hauteur de l’arche est de 50 cm. On peut remarquer le découpage esthétique de la plaque qui ferme son entrée.
A l’heure actuelle il est prévu de nettoyer cet aqueduc afin de le maintenir en activité.
Si des personnes connaissent l’historique de cet ouvrage, qu’elles se manifestent.
En bref, il suffit de dire que sa longueur est de 150 mètres enterrés, cela va de soi, sous une épaisseur de quelques mètres de terrain qui sans doute ont justifié sa construction en pierres de taille.
D’une hauteur et d’une largeur juste suffisantes au passage d’un être humain, cette caverne est parfaitement rectiligne. Nous pouvons apercevoir depuis son entrée une faible lueur dans l’obscurité qui révèle quelque part sa sortie.
En fait, une fois la plaque en fer ôtée de l’entrée, nous découvrons un aqueduc souterrain qui se trouve à la limite de Mirabel et de Villedieu, dissimulé dans le ravin de la combe et courant sous un coteau planté de vignes. Une maison est même construite un peu avant la sortie à la verticale de cet ouvrage.
Nul ne sait à ce jour quand et par qui cet aqueduc a été construit. Toujours en activité celui-ci sert à l’arrosage des terres de Villedieu qui bordent l’Aygues.
Pourquoi une telle construction dont le coût aujourd’hui serait exorbitant ?
A cet endroit, le canal, en amont à l’air libre, aurait pu simplement contourner le coteau et rester à découvert. Peut-être la proximité de l’Aygues y est-elle pour quelque chose ? D’autre part il eut été difficile de récupérer la perte de la pente et son passage à l’air libre dans le coteau aurait eu pour résultat le creusement d’un fossé trop profond.
L’aqueduc mesure environ 1,50 m de hauteur sans compter la lime qui s’est accumulée dans son fond. Son ouverture est d’un peu plus de 90 cm. Sa clé de voûte mesure 24 cm. La hauteur de l’arche est de 50 cm. On peut remarquer le découpage esthétique de la plaque qui ferme son entrée.
A l’heure actuelle il est prévu de nettoyer cet aqueduc afin de le maintenir en activité.
Si des personnes connaissent l’historique de cet ouvrage, qu’elles se manifestent.
François Dénéréaz


Cliquez sur les photos
pour les agrandir
Saint-Claude est revenue [ par Marie Salido et Jean Marie Dusuzeau ]
Saint-Claude semblait tarie depuis plusieurs mois. En tout cas, la fontaine de la place de la Libération était muette, car cela fait bien longtemps que Saint-Laurent, aussi, ne coule plus du tout ou à peine. Certain Villadéen, dépourvu d’eau potable chez lui, allait se fournir jusqu’à Buisson. La pérennité des mousses était compromise.
On a émis diverses hypothèses pour expliquer cet assèchement soudain. Bien sûr, comme souvent lorsqu’un phénomène est inexpliqué, on soupçonne la malveillance ou l’intérêt personnel. Mais quel gain y aurait-il à détourner une source à l’entrée de l’hiver, sinon à capter la matière première nécessaire à la fabrication de pains de glace « à rafraîchir » peu marchands en cette saison ?
On a imaginé aussi que le piétinement des brodequins verbalisateurs sur la place aurait pu provoquer des vibrations aquaphobes (1). Ceux qui ont récolté les prunes dominicales n’ont pas souscrit à cette assertion en rappelant que la maréchaussée a abandonné depuis longtemps les godillots cloutés pour s’équiper de chaussures à semelles caoutchoutées.
La thèse du réchauffement climatique peut-elle concerner notre source alors qu’elle remporte des succès brillants (désertification, fonte des glaces polaires) dans les régions aux climats extrêmes ? Le long hiver dont nous ne sortons qu’à peine, semble le démentir.
La sécheresse ? mais ce phénomène avéré ne peut pas, tout à coup, tarir une source pérenne.
On a demandé, enfin, à Christian Noué d’aller y regarder. Il est venu, il a vu, il a nettoyé les sédiments qui, mêlés au courant, se déposent par endroits jusqu’à provoquer des bouchons, en particulier, dans le bas du conduit de Saint-Claude, sous la fontaine.
Pour finir de dénouer la situation, il a installé une vanne qui permettra désormais de curer aisément la canalisation si elle se bouche à nouveau à cet endroit. Saint-Claude coule désormais.
Quand Saint-Laurent, à son tour, parviendra-t-elle, comme avant, jusqu’à la fontaine du village ?
(1) « Qui n’aiment pas l’eau » en grec de médecine.
On a émis diverses hypothèses pour expliquer cet assèchement soudain. Bien sûr, comme souvent lorsqu’un phénomène est inexpliqué, on soupçonne la malveillance ou l’intérêt personnel. Mais quel gain y aurait-il à détourner une source à l’entrée de l’hiver, sinon à capter la matière première nécessaire à la fabrication de pains de glace « à rafraîchir » peu marchands en cette saison ?
On a imaginé aussi que le piétinement des brodequins verbalisateurs sur la place aurait pu provoquer des vibrations aquaphobes (1). Ceux qui ont récolté les prunes dominicales n’ont pas souscrit à cette assertion en rappelant que la maréchaussée a abandonné depuis longtemps les godillots cloutés pour s’équiper de chaussures à semelles caoutchoutées.
La thèse du réchauffement climatique peut-elle concerner notre source alors qu’elle remporte des succès brillants (désertification, fonte des glaces polaires) dans les régions aux climats extrêmes ? Le long hiver dont nous ne sortons qu’à peine, semble le démentir.
La sécheresse ? mais ce phénomène avéré ne peut pas, tout à coup, tarir une source pérenne.
On a demandé, enfin, à Christian Noué d’aller y regarder. Il est venu, il a vu, il a nettoyé les sédiments qui, mêlés au courant, se déposent par endroits jusqu’à provoquer des bouchons, en particulier, dans le bas du conduit de Saint-Claude, sous la fontaine.
Pour finir de dénouer la situation, il a installé une vanne qui permettra désormais de curer aisément la canalisation si elle se bouche à nouveau à cet endroit. Saint-Claude coule désormais.
Quand Saint-Laurent, à son tour, parviendra-t-elle, comme avant, jusqu’à la fontaine du village ?
(1) « Qui n’aiment pas l’eau » en grec de médecine.

Saint-Claude avec...

L’embouchure moussue
de Saint-Laurent,
mais sans...
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Canal du Moulin [ par Yves Tardieu ]
Cette petite galerie permet de montrer à chacun que, s’il n’y a pas encore d’eau au canal, des travaux importants ont été entrepris grâce aux subventions obtenues, après que de très nombreux agriculteurs se soient retrouvés pour nettoyer bénévolement le canal sur le territoire de Villedieu.
Les travaux entrepris en amont ont pour but de restaurer la prise d’eau à Aygues et de nettoyer le cours du canal sur le territoire de Mirabel.
Les pelles mécaniques sont nécessaires pour débroussailler et curer les parties à ciel ouvert. Elles servent aussi à découvrir des parties bâties et couvertes de grosses dalles pour les déboucher.
Il reste aussi à purger les deux longues cavernes, très anciennes et dont La Gazette a déjà parlées.
Les travaux de nettoyage se poursuivent. Ceux concernant la prise d’eau sur la rivière font l’objet d’une enquête de la DDAF de la Drôme car les ramières sont désormais des espaces naturels protégés.
Il s’agit pour l’instant de vérifier les droits du canal de Villedieu.
Les travaux entrepris en amont ont pour but de restaurer la prise d’eau à Aygues et de nettoyer le cours du canal sur le territoire de Mirabel.
Les pelles mécaniques sont nécessaires pour débroussailler et curer les parties à ciel ouvert. Elles servent aussi à découvrir des parties bâties et couvertes de grosses dalles pour les déboucher.
Il reste aussi à purger les deux longues cavernes, très anciennes et dont La Gazette a déjà parlées.
Les travaux de nettoyage se poursuivent. Ceux concernant la prise d’eau sur la rivière font l’objet d’une enquête de la DDAF de la Drôme car les ramières sont désormais des espaces naturels protégés.
Il s’agit pour l’instant de vérifier les droits du canal de Villedieu.

S’il n’y a pas encore
d’eau au canal, des
travaux importants
ont été entrepris...
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus...
Avec ou sans mousse ?... Sans ! [ par Yves Tardieu ]
Le conseil municipal s’est prononcé sur un sujet qui a alimenté La Gazette pendant l’été 2004 et animé de nombreuses conversations depuis : la mousse sur la fontaine. Sur ce sujet décisif, un vote en bonne et due forme a donné un résultat sans appel : nous avons décidé d’enlever la mousse sur la fontaine à l’unanimité moins une abstention.
Il y a là une évolution très nette de l’opinion sur le sujet.
Nous n’avions jamais voté mais jusqu’à présent, au conseil comme dans le village, la mousse avait la cote. Pas de référendum cette fois et l’IFOP a refusé de faire un sondage pour La Gazette auprès des Villadéens. Nous sommes bien obligés de nous fier aux discussions informelles dans le village pour une évaluation, « au doigt mouillé », de l’opinion publique sur cette question d’importance.
Il semble bien qu’une majorité approuve l’éradication de la mousse, beaucoup de personnes reconnaissant avoir changé d’avis.
Comment expliquer ce revirement ? Les défauts pointés sur la mousse par quelques hurluberlus, il y a deux ans, sont devenus plus visibles. Le manque d’eau à la fontaine et sa grande irrégularité, ont fait passer la mousse par toutes les nuances possibles du vert, toutes les nuances du caca d’oie (tout un programme !) et toutes celles du « jaunasse » au « marronnasse ». Si une bonne mousse verte plaît, beaucoup des autres couleurs ne font pas l’unanimité.
Les parasites divers ont également fait pencher la balance : il y en a qui ont vu à l’occasion des asticots, d’autres des insectes peu ragoûtants et d’autres encore un drôle de truc gluant et dégoûtant. Bref, la mousse est devenue moins appétissante au fil du temps.
Bien sûr, une frange encore significative de l’opinion défend la mousse mais de toute façon c’est trop tard ! La décision prise en avril a été appliquée le 17 mai.
Sur notre reportage photo on peut voir dès 9h Gilles attaquer la face ouest à la massette, avec un petit burin plat. Celui-ci n’a pas résisté aux grosses concrétions calcaires que cachait en réalité une fine pellicule de mousse. Au moment de s’en prendre à la face nord, il s’est cassé en deux.
Sur la deuxième photo, prise vers 10h, on voit Gilbert Nuñez apporter un outil plus costaud à Gilles qui peut désormais, bénéficiant d’un levier grâce au manche, agir plus efficacement. On peut aussi voir que le temps d’enlever la mousse, Gilles a servi d’attraction pour la matinée. Chaque personne qui passait y allant de ses questions ou de ses commentaires, quelquefois en petit groupe. À 11h15, toute la mousse est dans la benne du camion.
Lionel Lazard, Yann Palleiro, Alain Martin, Jean-Louis Vollot finissent au karcher le nettoyage avant de boire un « 51 » avec de l’eau venue droit de Saint-Claude.
Les prochaines améliorations que l’on pourrait envisager concerneraient la réfection des becs et rosaces, un nettoyage général avec un karcher plus puissant et l’utilisation de l’un des quatre becs pour délivrer à chacun sa dose de pastis.
Il y a là une évolution très nette de l’opinion sur le sujet.
Nous n’avions jamais voté mais jusqu’à présent, au conseil comme dans le village, la mousse avait la cote. Pas de référendum cette fois et l’IFOP a refusé de faire un sondage pour La Gazette auprès des Villadéens. Nous sommes bien obligés de nous fier aux discussions informelles dans le village pour une évaluation, « au doigt mouillé », de l’opinion publique sur cette question d’importance.
Il semble bien qu’une majorité approuve l’éradication de la mousse, beaucoup de personnes reconnaissant avoir changé d’avis.
Comment expliquer ce revirement ? Les défauts pointés sur la mousse par quelques hurluberlus, il y a deux ans, sont devenus plus visibles. Le manque d’eau à la fontaine et sa grande irrégularité, ont fait passer la mousse par toutes les nuances possibles du vert, toutes les nuances du caca d’oie (tout un programme !) et toutes celles du « jaunasse » au « marronnasse ». Si une bonne mousse verte plaît, beaucoup des autres couleurs ne font pas l’unanimité.
Les parasites divers ont également fait pencher la balance : il y en a qui ont vu à l’occasion des asticots, d’autres des insectes peu ragoûtants et d’autres encore un drôle de truc gluant et dégoûtant. Bref, la mousse est devenue moins appétissante au fil du temps.
Bien sûr, une frange encore significative de l’opinion défend la mousse mais de toute façon c’est trop tard ! La décision prise en avril a été appliquée le 17 mai.
Sur notre reportage photo on peut voir dès 9h Gilles attaquer la face ouest à la massette, avec un petit burin plat. Celui-ci n’a pas résisté aux grosses concrétions calcaires que cachait en réalité une fine pellicule de mousse. Au moment de s’en prendre à la face nord, il s’est cassé en deux.
Sur la deuxième photo, prise vers 10h, on voit Gilbert Nuñez apporter un outil plus costaud à Gilles qui peut désormais, bénéficiant d’un levier grâce au manche, agir plus efficacement. On peut aussi voir que le temps d’enlever la mousse, Gilles a servi d’attraction pour la matinée. Chaque personne qui passait y allant de ses questions ou de ses commentaires, quelquefois en petit groupe. À 11h15, toute la mousse est dans la benne du camion.
Lionel Lazard, Yann Palleiro, Alain Martin, Jean-Louis Vollot finissent au karcher le nettoyage avant de boire un « 51 » avec de l’eau venue droit de Saint-Claude.
Les prochaines améliorations que l’on pourrait envisager concerneraient la réfection des becs et rosaces, un nettoyage général avec un karcher plus puissant et l’utilisation de l’un des quatre becs pour délivrer à chacun sa dose de pastis.

Gilles attaque
la face ouest
à la massette...

Gilbert Nuñez
apporte un outil plus
costaud à Gilles...

Gilles a servi
d’attraction pour
la matinée...

Lionel Lazard, Yann
Palleiro, Alain Martin,
Jean-Louis Vollot
finissent au karcher
le nettoyage...
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus...
Nous avions évoqué, dans une gazette précédente, l’existence d’une « caverne » par où circulait l’eau du canal du moulin. Celle-ci, au lieudit « le Bridoux », présentait des signes d’engorgement en raison de dépôts de « lime » ainsi que la portion du canal située en sortie à l’air libre.
Les travaux, qui ont eu lieu ce printemps, subventionnés pour un montant, taxes comprises, de 13 000 € par le conseil général, la région et la mairie de Villedieu, ont permis de venir à bout de cet obstacle. En effet, la création temporaire, au débouché de la caverne d’un « filant » en direction des « ramières » de l’Aygues (Vaucluse) a permis d’évacuer le dépôt qui obstruait le conduit souterrain. Par contre, en amont, c’est à dire, à l’entrée de celui-ci, des dalles en pierre de Beaumont, posées en travers du canal sur une longueur de 50 mètres et envahies par la végétation, ont dû être déposées au moyen d’une pelle mécanique grâce à des « spits » judicieusement placés qui servaient ainsi de points d’accroche pour le levage. Il faut dire que ces dalles pèsent environ 500 kilogrammes au moins. Le canal ainsi découvert, était quasiment obstrué par des racines et de la vase. Après curage, les dalles ont été replacées et leur étanchéité assurée par un mélange de « clapissette » et de chaux, car cette portion recouverte sert de syphon et de mise en dépôt des alluvions avant la caverne.
Mais nous n’étions pas au bout de nos peines. En effet, les végétaux enlevés sur cette portion en dessous du Bridoux, ont révélé la sortie d’une autre caverne, celle-ci en amont à 150 mètres de la précédente. Non seulement beaucoup plus longue, 250 mètres, mais complètement effondrée sur les neuf mètres de sa portion finale qui ont dû être évacués. Bien entendu, à cet endroit, l’eau atteignait pratiquement la voûte. Il est à noter qu’un arbre est à l’origine de cet effondrement. Nouveau filant temporaire et dégagement des limes, ont redonné à cette caverne son efficacité d’origine.
À l’avenir, ces filants devront être recreusés, équipés de « martillères » pour permettre le dégagement des dépôts. D’autres travaux de curage ont été nécessaires pour la remise à niveau du canal et le « laser » s’est révélé particulièrement performant. Il faut creuser ni trop ni trop peu.
Nous voilà donc dans la dernière étape qui est la prise d’eau à l’Eygues (Drôme), 200 mètres à tailler dans la ramière depuis la vanne bétonnée jusqu’au lit de la rivière. Et là, après défrichement et déboisement, patatras. La « D.D.A.F » Drôme intervient. C’est vrai, nous avons pêché par la forme : le manque d’explications de notre part aux riverains concernés en a peut-être interpellé quelques-uns. Mais sur le fond, la servitude existe et nous ne faisions que prendre nos droits attestés et écrits de manière incontestable depuis 1440 au moins.
Bref, il ne reste plus qu’à creuser 200 mètres de fossé pour arriver au résultat final, cela se fera après concertation. Villedieu, en matière d’irrigation, ne bénéficie t-il pas des mêmes droits que les autres villages ?
PETIT LEXIQUE
• Caverne - passage souterrain voûté en maçonnerie ancienne.
• Lime - dépôt d’argile et de sable calcaire.
• Filant - fossé d’évacuation et de décharge en direction d’un cours d’eau naturel.
• Ramière - étendue boisée naturelle bordant la rivière en majorité constituée de peupliers (piboules).
• Spit - cheville de perçage à laquelle on fixe une vis (ici un crochet).
• Clapissette - gravier calibré d’une épaisseur de quelques millimètres.
• Martillère - trappe métallique sur le côté d’un canal se relevant et se refermant. Les plus grandes sont munies d’un volant et d’une tige filetée.
• Laser - on s’en sert aussi dans les boîtes de nuit.
• D.D.A.F - Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
• Servitude - droit créé par l’usage et dont la nécessité est incontestable. La servitude est le droit du faible sur le fort.
Les travaux, qui ont eu lieu ce printemps, subventionnés pour un montant, taxes comprises, de 13 000 € par le conseil général, la région et la mairie de Villedieu, ont permis de venir à bout de cet obstacle. En effet, la création temporaire, au débouché de la caverne d’un « filant » en direction des « ramières » de l’Aygues (Vaucluse) a permis d’évacuer le dépôt qui obstruait le conduit souterrain. Par contre, en amont, c’est à dire, à l’entrée de celui-ci, des dalles en pierre de Beaumont, posées en travers du canal sur une longueur de 50 mètres et envahies par la végétation, ont dû être déposées au moyen d’une pelle mécanique grâce à des « spits » judicieusement placés qui servaient ainsi de points d’accroche pour le levage. Il faut dire que ces dalles pèsent environ 500 kilogrammes au moins. Le canal ainsi découvert, était quasiment obstrué par des racines et de la vase. Après curage, les dalles ont été replacées et leur étanchéité assurée par un mélange de « clapissette » et de chaux, car cette portion recouverte sert de syphon et de mise en dépôt des alluvions avant la caverne.
Mais nous n’étions pas au bout de nos peines. En effet, les végétaux enlevés sur cette portion en dessous du Bridoux, ont révélé la sortie d’une autre caverne, celle-ci en amont à 150 mètres de la précédente. Non seulement beaucoup plus longue, 250 mètres, mais complètement effondrée sur les neuf mètres de sa portion finale qui ont dû être évacués. Bien entendu, à cet endroit, l’eau atteignait pratiquement la voûte. Il est à noter qu’un arbre est à l’origine de cet effondrement. Nouveau filant temporaire et dégagement des limes, ont redonné à cette caverne son efficacité d’origine.
À l’avenir, ces filants devront être recreusés, équipés de « martillères » pour permettre le dégagement des dépôts. D’autres travaux de curage ont été nécessaires pour la remise à niveau du canal et le « laser » s’est révélé particulièrement performant. Il faut creuser ni trop ni trop peu.
Nous voilà donc dans la dernière étape qui est la prise d’eau à l’Eygues (Drôme), 200 mètres à tailler dans la ramière depuis la vanne bétonnée jusqu’au lit de la rivière. Et là, après défrichement et déboisement, patatras. La « D.D.A.F » Drôme intervient. C’est vrai, nous avons pêché par la forme : le manque d’explications de notre part aux riverains concernés en a peut-être interpellé quelques-uns. Mais sur le fond, la servitude existe et nous ne faisions que prendre nos droits attestés et écrits de manière incontestable depuis 1440 au moins.
Bref, il ne reste plus qu’à creuser 200 mètres de fossé pour arriver au résultat final, cela se fera après concertation. Villedieu, en matière d’irrigation, ne bénéficie t-il pas des mêmes droits que les autres villages ?
PETIT LEXIQUE
• Caverne - passage souterrain voûté en maçonnerie ancienne.
• Lime - dépôt d’argile et de sable calcaire.
• Filant - fossé d’évacuation et de décharge en direction d’un cours d’eau naturel.
• Ramière - étendue boisée naturelle bordant la rivière en majorité constituée de peupliers (piboules).
• Spit - cheville de perçage à laquelle on fixe une vis (ici un crochet).
• Clapissette - gravier calibré d’une épaisseur de quelques millimètres.
• Martillère - trappe métallique sur le côté d’un canal se relevant et se refermant. Les plus grandes sont munies d’un volant et d’une tige filetée.
• Laser - on s’en sert aussi dans les boîtes de nuit.
• D.D.A.F - Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
• Servitude - droit créé par l’usage et dont la nécessité est incontestable. La servitude est le droit du faible sur le fort.
Becs [ par Yves Tardieu ]
Le conseil s’est penché sur le projet d’un ferronnier de Vaison pour changer les becs de la fontaine. À suivre.
Becs de la fontaine
La saga de la fontaine continue. Le lecteur se souvient que dans son dernier numéro La Gazette relatait le nettoyage de la mousse.
À cette occasion, Yann Palleiro et Lionel Lazard suggéraient à Jean-Louis Vollot de solliciter un de leurs copains, Laurent Devaux, pour remplacer les becs de la fontaine, l'un manquant, les autres très abîmés. Jean-Louis Vollot se souvenait que le Laurent en question avait été son élève. Huguette Louis l'a contacté. Laurent Devaux a élaboré un projet qui a été présenté au conseil municipal du 4 juillet. Il s'agissait de becs beaucoup plus importants que les précédents, avec des motifs de grappes et de feuilles de vigne. Après discussion, le conseil a demandé des becs plus courts et moins chargés.
Ce sont ces becs que Laurent Devaux est venu mettre en place le mardi 25 juillet. Il est ferronnier d'art, installé à Vaison dans la zone artisanale Les Écluses (sur la route de Roaix, après la station d'épuration). Il est associé avec Laurent Duclos et leurs initiales identiques ont donné le nom de leur entreprise : 2LD décoration. Laurent Devaux connait Yann Palleiro depuis l’enfance. Il a travaillé plusieurs saisons au Centre à l'époque d'Yvelise et connaît bien Villedieu. « Je suis content et fier d'avoir fait ce travail. J'adore cette place. Je me sens un peu d'ici et ça me fait plaisir » a-t-il dit au grand reporter de La Gazette présent ce jour là…
2LD décoration,
ZA de l'écluse,
84110 Vaison la Romaine
Tél : 06 15 90 03 37
Fax : 04 90 46 55 42
À cette occasion, Yann Palleiro et Lionel Lazard suggéraient à Jean-Louis Vollot de solliciter un de leurs copains, Laurent Devaux, pour remplacer les becs de la fontaine, l'un manquant, les autres très abîmés. Jean-Louis Vollot se souvenait que le Laurent en question avait été son élève. Huguette Louis l'a contacté. Laurent Devaux a élaboré un projet qui a été présenté au conseil municipal du 4 juillet. Il s'agissait de becs beaucoup plus importants que les précédents, avec des motifs de grappes et de feuilles de vigne. Après discussion, le conseil a demandé des becs plus courts et moins chargés.
Ce sont ces becs que Laurent Devaux est venu mettre en place le mardi 25 juillet. Il est ferronnier d'art, installé à Vaison dans la zone artisanale Les Écluses (sur la route de Roaix, après la station d'épuration). Il est associé avec Laurent Duclos et leurs initiales identiques ont donné le nom de leur entreprise : 2LD décoration. Laurent Devaux connait Yann Palleiro depuis l’enfance. Il a travaillé plusieurs saisons au Centre à l'époque d'Yvelise et connaît bien Villedieu. « Je suis content et fier d'avoir fait ce travail. J'adore cette place. Je me sens un peu d'ici et ça me fait plaisir » a-t-il dit au grand reporter de La Gazette présent ce jour là…
2LD décoration,
ZA de l'écluse,
84110 Vaison la Romaine
Tél : 06 15 90 03 37
Fax : 04 90 46 55 42


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Comme il se doit, les nouveaux becs de la fontaine ont suscité des commentaires variés. Il y a ceux à qui ça plaît, très nombreux, et ceux à qui ça ne plaît pas… tout aussi nombreux. Les premiers apprécient la nouveauté et les symboles, la vigne et le vin. Les autres trouvent l'ensemble un peu « prétentieux » par rapport à la simplicité de la fontaine. Jusque-là, rien que de très normal : il aurait été étonnant que tout le monde soit du même avis.
Les interprétations se corsent un peu lorsque les commentateurs ont l’esprit mal tourné. Ceux qui avaient remarqué que la mousse pouvait faire penser à un sexe féminin, une « vulve», n'ont pu s'empêcher de voir un sexe masculin et ses attributs (substantiels) dans les nouveaux becs.
Évidemment, il faut avoir un certain état d'esprit… Chaque lecteur pourra juger sur pièces, si l'on ose dire, avec les photos ci-dessous.
Quand on a l'esprit assez vicieux pour voir ça, on l'a aussi pour transformer cette question esthétique en question politique.
On a vu un Villadéen compter les grains de raisin pour savoir s'il équivalait au nombre de conseillers municipaux. On ne sait pas si cette équivalence, (une roubignole = un conseiller), était flatteuse ou méprisante mais je crains le pire…
D'autres se sont demandé quelle mouche avait bien pu piquer le conseil municipal pour qu'il affirme ainsi brutalement sa virilité en détruisant un symbole féminin pour le remplacer par un masculin. À notre crédit, si cette interprétation doit s'imposer, notre souci de limiter la taille de l'engin et sa prétention apparente (voir la chronique municipale) montre quand même une limite (bienvenue) à ce machisme municipal.
Une interprétation potentiellement féministe a également eu son heure. Ceux qui ont pensé que les objets en question avaient été choisis par une conseillère municipale seule ont pu y voir une révolte et la volonté d’inverser les images habituelles : pas de raisons, en effet, qu’il n’y en ait toujours que pour les hommes.
On le voit, tout est dans tout, y compris son contraire et le contraire du contraire. L’essentiel reste quand même la bonne humeur.
En tout cas, tous doivent rendre hommage au conseil municipal qui, sans relâche, chaque année, doit trouver des idées nouvelles pour animer les discussions sur la place, au Centre ou sur le Bàrri. On peut même le féliciter puisqu’il y arrive !
Les interprétations se corsent un peu lorsque les commentateurs ont l’esprit mal tourné. Ceux qui avaient remarqué que la mousse pouvait faire penser à un sexe féminin, une « vulve», n'ont pu s'empêcher de voir un sexe masculin et ses attributs (substantiels) dans les nouveaux becs.
Évidemment, il faut avoir un certain état d'esprit… Chaque lecteur pourra juger sur pièces, si l'on ose dire, avec les photos ci-dessous.
Quand on a l'esprit assez vicieux pour voir ça, on l'a aussi pour transformer cette question esthétique en question politique.
On a vu un Villadéen compter les grains de raisin pour savoir s'il équivalait au nombre de conseillers municipaux. On ne sait pas si cette équivalence, (une roubignole = un conseiller), était flatteuse ou méprisante mais je crains le pire…
D'autres se sont demandé quelle mouche avait bien pu piquer le conseil municipal pour qu'il affirme ainsi brutalement sa virilité en détruisant un symbole féminin pour le remplacer par un masculin. À notre crédit, si cette interprétation doit s'imposer, notre souci de limiter la taille de l'engin et sa prétention apparente (voir la chronique municipale) montre quand même une limite (bienvenue) à ce machisme municipal.
Une interprétation potentiellement féministe a également eu son heure. Ceux qui ont pensé que les objets en question avaient été choisis par une conseillère municipale seule ont pu y voir une révolte et la volonté d’inverser les images habituelles : pas de raisons, en effet, qu’il n’y en ait toujours que pour les hommes.
On le voit, tout est dans tout, y compris son contraire et le contraire du contraire. L’essentiel reste quand même la bonne humeur.
En tout cas, tous doivent rendre hommage au conseil municipal qui, sans relâche, chaque année, doit trouver des idées nouvelles pour animer les discussions sur la place, au Centre ou sur le Bàrri. On peut même le féliciter puisqu’il y arrive !


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Sources de Saint-Laurent (3 et 4)
Le 21 février, Martial Arnaud, Dominique Bernard, François Dénéréaz, Romain Detrain, Gaël Dieu, Jérémy Dieu, Gilles Eysseric, Jonathan Fauque Timmy Fauque, Roland Fontana, Frédéric Gnilka, André Macabet, Jean-Laurent Macabet, Fredo Martin, Julien Moinault, Simon Tardieu,Yves Tardieu et André Zammit se sont rendus aux Mouillères (314 mètres) pour extraire la lime des cavernes envahies par cette boue marneuse. À midi, la tâche étant accomplie, tous ont cassé la croûte sous un soleil printanier. Au dessert : oreillettes.
Le 11 avril, Dominique Bernard,Alain Bertrand (avec sa pelle mécanique), Jean Marie Dusuzeau (avec un appareil photo), Frédéric Gnilka,André Macabet, Jean-Laurent Macabet et Frédo Martin, conseillés et visités par Yvan Raffin, Maxime Roux et Yves Tardieu, ont débroussaillé, élagué, tronçonné, abattu, brûlé, décaissé, aplani, remblayé, dragué, maçonné et repéré de huit heures du matin à sept heures passées.
Le 11 avril, Dominique Bernard,Alain Bertrand (avec sa pelle mécanique), Jean Marie Dusuzeau (avec un appareil photo), Frédéric Gnilka,André Macabet, Jean-Laurent Macabet et Frédo Martin, conseillés et visités par Yvan Raffin, Maxime Roux et Yves Tardieu, ont débroussaillé, élagué, tronçonné, abattu, brûlé, décaissé, aplani, remblayé, dragué, maçonné et repéré de huit heures du matin à sept heures passées.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
Le 6 décembre 2008, le principal objectif des travaux aux sources de Saint-Laurent consistait à aménager des passages pour apporter les matériaux destinés à réhausser les regards qui avaient été submergés par la boue lors des orages de l’automne (La Gazette n°58 du 28 décembre).
Le 17 janvier 2009 un nouveau samedi, consacré à l’élimination de la « lime » accumulée dans les cavernes, a permis d’obtenir un succès partiel. Un regard complètement obstrué a été vidé, un nouveau regard placé sur la seconde caverne. On a détourné provisoirement la source.
C’est le 21 février que la jeunesse villadéenne, aidée des employés municipaux et de quelques autres parmi les plus minces, a parachevé le nettoyage des souterrains de captage.
Pour éliminer la « lime » d’une caverne, il faut travailler courbé (la hauteur est d’environ un mètre cinquante), sans pouvoir se retourner aisément (la largeur est de l’ordre de soixante-quinze centimètres), utiliser des pelles de petite taille et des seaux que les « spéléologues » se passent en faisant la chaîne jusqu’au regard le plus proche.
Cependant, la seconde caverne, qu’une opération ancienne avait munie d’une conduite en fibrociment, est partiellement effondrée sur les deux-tiers de sa longueur. La canalisation acheminant l’eau jusqu’à Villedieu est brisée et sans doute obstruée. L’objectif du samedi 11 avril était donc de dégager cette conduite en abaissant le lit du Rieu et d’aménager un accès le long de la caverne endommagée.
Le 17 janvier 2009 un nouveau samedi, consacré à l’élimination de la « lime » accumulée dans les cavernes, a permis d’obtenir un succès partiel. Un regard complètement obstrué a été vidé, un nouveau regard placé sur la seconde caverne. On a détourné provisoirement la source.
C’est le 21 février que la jeunesse villadéenne, aidée des employés municipaux et de quelques autres parmi les plus minces, a parachevé le nettoyage des souterrains de captage.
Pour éliminer la « lime » d’une caverne, il faut travailler courbé (la hauteur est d’environ un mètre cinquante), sans pouvoir se retourner aisément (la largeur est de l’ordre de soixante-quinze centimètres), utiliser des pelles de petite taille et des seaux que les « spéléologues » se passent en faisant la chaîne jusqu’au regard le plus proche.
Cependant, la seconde caverne, qu’une opération ancienne avait munie d’une conduite en fibrociment, est partiellement effondrée sur les deux-tiers de sa longueur. La canalisation acheminant l’eau jusqu’à Villedieu est brisée et sans doute obstruée. L’objectif du samedi 11 avril était donc de dégager cette conduite en abaissant le lit du Rieu et d’aménager un accès le long de la caverne endommagée.

L’effondrement de la deuxième caverne (vue de l’amont)
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
Le chantier des sources (5 et 6) [ par Yves Tardieu ]
Un nouveau samedi aux sources était programmé le 30 mai, avec moins de main-d'œuvre et plus de matériel. Il s'agissait d'essayer de déboucher et réparer le tuyau en sortie de caverne. Le tuyau qui amène l'eau à Villedieu est branché à la sortie de la troisième caverne. Sur une vingtaine de mètres, il est dans le ruisseau, jusqu'à une vanne qui permet de couper l'eau sur tout le réseau. Ensuite, il y a environ 150 mètres de la vanne à la première « purge ». En effet, à chaque point bas du réseau, il y a la possibilité d'évacuer l'eau vers le ruisseau pour pouvoir « nettoyer » le réseau.
Mini pelle (avec, aux manettes, Alain Monteil), compresseurs et instruments divers (meuleuse, scie à métaux, etc.) étaient nécessaires pour mettre complètement à jour la purge, scier le tuyau pour pouvoir y injecter de l'air ou de l'eau, actionner les vannes, et autres manœuvres. Si le travail avance, deux mauvaises surprises ont marqué cette journée.
Le tuyau est bien bouché, sur une très grande longueur, et même si une quantité importante de boue en est sortie, il n'est pas sûr qu'il soit débouché. De plus, de la boue sort aussi de l'autre côté, en aval de la purge. Il est possible que ce soit obstrué sur une plus grande longueur encore.
Le début de la canalisation est cassé, nous le savions, mais nous découvrons qu'il est cassé en plusieurs endroits, que les « coups d'eau » du ruisseau ont déplacé son lit et, avec lui, la canalisation. Une simple réparation n'est guère envisageable.
Parmi les nombreuses découvertes faites sur ce chantier, nous constatons que les diamètres des tuyaux, extérieur et intérieur, ne correspondent à aucune norme actuelle. La présence experte de Marc Estivalet est ici particulièrement précieuse. Diamètres des tuyaux, tailles des « brides », des vannes et autres pièces n'ont aucun secret pour lui. Il évalue vite la situation, imagine les solutions, sait où trouver les matériaux de remplacement ou de réparation. Associées aux souvenirs et aux connaissances de Maxime Roux, ses compétences ont également fait merveille pour identifier les purges, les ventouses et les différentes réparations à réaliser sur le réseau. Les marquages aux sols et les piquets peints en orange dans le quartier Saint-Laurent ne sont pas des manifestations surnaturelles, mais le résultat de leur travail.
La commission des sources se réunit après chaque intervention. Le diagnostic établi le 2 juin conduit à programmer une nouvelle journée. Le projet est à nouveau double :
– refaire à neuf les vingt premiers mètres en dégageant le tuyau actuel et en le remplaçant, ce qui suppose de canaliser le ruisseau, refaire des branchements à la prise d'eau et à la vanne générale,
– poursuivre l'investigation sur le réseau en aval de la première purge, en démontant les ventouses et en vérifiant jusqu'où il est bouché.
Samedi 20 juin, rebelote : mini pelle (avec, cette fois, Alain Bertrand), compresseurs et autres matériels. Là encore, les travaux sont plus difficiles que prévu. Il faut casser le béton qui enchâsse la vanne générale, dégager et creuser.
Tout le travail programmé dans la journée ne peut être terminé, mais il y a cette fois deux résultats tangibles : les 25 premiers mètres de tuyaux sont changés pour du neuf. Et, grâce à la persévérance de Jean-Laurent et André Macabet, qui y sont retournés le dimanche, le tuyau est maintenant débouché jusqu'à la première purge.
Cependant, il y a encore du travail :
– terminer cette zone, en protégeant le tuyau, en remettant une vanne générale et une purge dans un regard accessible,
– amener provisoirement l'eau de la première à la troisième caverne avant de prévoir une réparation complète et coûteuse,
– aller voir au-delà de la première purge s'il y a encore de la boue, démonter les ventouses et les autres purges.
Tout n’est pas résolu, mais on y voit plus clair.
Mini pelle (avec, aux manettes, Alain Monteil), compresseurs et instruments divers (meuleuse, scie à métaux, etc.) étaient nécessaires pour mettre complètement à jour la purge, scier le tuyau pour pouvoir y injecter de l'air ou de l'eau, actionner les vannes, et autres manœuvres. Si le travail avance, deux mauvaises surprises ont marqué cette journée.
Le tuyau est bien bouché, sur une très grande longueur, et même si une quantité importante de boue en est sortie, il n'est pas sûr qu'il soit débouché. De plus, de la boue sort aussi de l'autre côté, en aval de la purge. Il est possible que ce soit obstrué sur une plus grande longueur encore.
Le début de la canalisation est cassé, nous le savions, mais nous découvrons qu'il est cassé en plusieurs endroits, que les « coups d'eau » du ruisseau ont déplacé son lit et, avec lui, la canalisation. Une simple réparation n'est guère envisageable.
Parmi les nombreuses découvertes faites sur ce chantier, nous constatons que les diamètres des tuyaux, extérieur et intérieur, ne correspondent à aucune norme actuelle. La présence experte de Marc Estivalet est ici particulièrement précieuse. Diamètres des tuyaux, tailles des « brides », des vannes et autres pièces n'ont aucun secret pour lui. Il évalue vite la situation, imagine les solutions, sait où trouver les matériaux de remplacement ou de réparation. Associées aux souvenirs et aux connaissances de Maxime Roux, ses compétences ont également fait merveille pour identifier les purges, les ventouses et les différentes réparations à réaliser sur le réseau. Les marquages aux sols et les piquets peints en orange dans le quartier Saint-Laurent ne sont pas des manifestations surnaturelles, mais le résultat de leur travail.
La commission des sources se réunit après chaque intervention. Le diagnostic établi le 2 juin conduit à programmer une nouvelle journée. Le projet est à nouveau double :
– refaire à neuf les vingt premiers mètres en dégageant le tuyau actuel et en le remplaçant, ce qui suppose de canaliser le ruisseau, refaire des branchements à la prise d'eau et à la vanne générale,
– poursuivre l'investigation sur le réseau en aval de la première purge, en démontant les ventouses et en vérifiant jusqu'où il est bouché.
Samedi 20 juin, rebelote : mini pelle (avec, cette fois, Alain Bertrand), compresseurs et autres matériels. Là encore, les travaux sont plus difficiles que prévu. Il faut casser le béton qui enchâsse la vanne générale, dégager et creuser.
Tout le travail programmé dans la journée ne peut être terminé, mais il y a cette fois deux résultats tangibles : les 25 premiers mètres de tuyaux sont changés pour du neuf. Et, grâce à la persévérance de Jean-Laurent et André Macabet, qui y sont retournés le dimanche, le tuyau est maintenant débouché jusqu'à la première purge.
Cependant, il y a encore du travail :
– terminer cette zone, en protégeant le tuyau, en remettant une vanne générale et une purge dans un regard accessible,
– amener provisoirement l'eau de la première à la troisième caverne avant de prévoir une réparation complète et coûteuse,
– aller voir au-delà de la première purge s'il y a encore de la boue, démonter les ventouses et les autres purges.
Tout n’est pas résolu, mais on y voit plus clair.

André Macabet démonte l’ancienne purge

L’équipe des Villadéens accompagnée de Marc Estivalet
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Sources de Saint-Laurent (fin provisoire) [ par J. M. Dusuzeau ]
Le 11 juillet, Jimmy Carraz, Alain Bertrand, André et Jérémy Dieu, Marc Estivalet, Roland Fontana, Frédéric Gnilka, André et Jean-Laurent Macabet se sont rendus aux sources pour une journée de travail destinée à relier la première et la troisième caverne par dérivation de la deuxième – provisoirement mise hors circuit –, d’achever la mise en place de la conduite de sortie de la troisième et dernière caverne, d’installer une vanne générale de l’adduction d’eau et de remplacer deux purges.
Tous avaient l’espoir d’être en avance sur l’objectif avoué à demi-mot : rétablir l’arrivée de l’eau aux fontaines de la place avant la fête votive.
Les travaux de la journée accomplis – quelques fuites aux raccords entre anciennes et nouvelles canalisations colmatées et quelques tuyaux purgés – la vanne fut ouverte. Quelques uns se rendirent, vers huit heures, du soir au lavoir de la rue des sources por en scruter le robine.
Comprimé par le liquide, l’air provoquait des gargouillements et des éructations prometteurs dans la conduite. Et enfin, à 20 heures 12 minutes, l’eau coula.
Bruce Lockardt, voisin du lavoir et témoin de l’attente, apporta alors une bouteille d’un liquide effervescent qui fut bu pour fêter l’évènement.
Dans les jours qui ont suivi, l’eau put enfin alimenter la fontaine.
Cependant, la cause du faible débit fut bientôt identifiée par Frédéric Gnilka qui remarqua, à proximité de chez lui, des traces d’humidité inhabituelles en période de sècheresse.
En creusant pour réparer, l’on constata qu’il s’agissait de la faiblesse d’un raccord ancien.
Le 3 octobre, une nouvelle journée de travail aux sources a mobilisé une équipe formée de Pierre Arnaud, Alain Bertrand, Marc Estivalet, Roland Fontana, Frédéric Gnilka, André et Jean-Laurent Macabet qui, conduite par Maxime Roux, a procédé à l’inventaire partiel des ventouses, purges, vannes et regards du réseau. Un regard proche de la ferme de Thierry Tardieu a été reconstruit solidement. Ainsi se poursuit la rénovation des sources de Saint-Laurent.
Tous avaient l’espoir d’être en avance sur l’objectif avoué à demi-mot : rétablir l’arrivée de l’eau aux fontaines de la place avant la fête votive.
Les travaux de la journée accomplis – quelques fuites aux raccords entre anciennes et nouvelles canalisations colmatées et quelques tuyaux purgés – la vanne fut ouverte. Quelques uns se rendirent, vers huit heures, du soir au lavoir de la rue des sources por en scruter le robine.
Comprimé par le liquide, l’air provoquait des gargouillements et des éructations prometteurs dans la conduite. Et enfin, à 20 heures 12 minutes, l’eau coula.
Bruce Lockardt, voisin du lavoir et témoin de l’attente, apporta alors une bouteille d’un liquide effervescent qui fut bu pour fêter l’évènement.
Dans les jours qui ont suivi, l’eau put enfin alimenter la fontaine.
Cependant, la cause du faible débit fut bientôt identifiée par Frédéric Gnilka qui remarqua, à proximité de chez lui, des traces d’humidité inhabituelles en période de sècheresse.
En creusant pour réparer, l’on constata qu’il s’agissait de la faiblesse d’un raccord ancien.
Le 3 octobre, une nouvelle journée de travail aux sources a mobilisé une équipe formée de Pierre Arnaud, Alain Bertrand, Marc Estivalet, Roland Fontana, Frédéric Gnilka, André et Jean-Laurent Macabet qui, conduite par Maxime Roux, a procédé à l’inventaire partiel des ventouses, purges, vannes et regards du réseau. Un regard proche de la ferme de Thierry Tardieu a été reconstruit solidement. Ainsi se poursuit la rénovation des sources de Saint-Laurent.

Alain Bertrand, Frédéric Gnilka, Jean-Laurent Macabet, Roland Fontana, Jérémy Dieu, Jimmy Carraz, André Dieu
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
Sources (suite) [ par J. M. Dusuzeau ]
L’opération du samedi 3 mars avait pour objet de visiter et de nettoyer le puits situé sur le parcours de la source de Saint-Claude.
L’équipe était composée de Dominique Bernard, de Marc Estivalet, le puisatier bien connu, de Roland Fontana, d’Ulysse Fontana, de Jean-Laurent Macabet et de Maxime Roux.
Le matériel comprenait des échelles, des cordes, des pompes, des pelles à manche court ainsi que des seaux, et l’équipement : des bottes cuissardes, des lampes frontales et des gants.
La précédente intervention n’avait pu aboutir, l’arrivée d’eau étant telle que malgré sa puissance la pompe n’était pas parvenue à assècher même momentanément le puits.
À la fin d’un hiver sec, le débit modéré a permis à Jean-Laurent Macabet, dûment équipé en égoutier, de descendre tout au fond et de nettoyer la boue qui s’est accumulée au fil du temps tandis que ceux restés à la surface évacuaient la gadoue à l’aide des seaux.
Il a pu s’assurer que la canalisation d’alimentation est en bon état mais aussi, comme on le pensait, que celle d’évacuation est obstruée par des concrétions.C’est donc par capilarité ou par infiltration en aval du puits que le bec de la fontaine correspondant à la source est alimenté.
L’objectif de l’expédition matinale étant atteint, l’équipe s’est dispersée après avoir dégusté le café que Laurence Cambonie, voisine du chantier, était venue offrir gentiment.
L’équipe était composée de Dominique Bernard, de Marc Estivalet, le puisatier bien connu, de Roland Fontana, d’Ulysse Fontana, de Jean-Laurent Macabet et de Maxime Roux.
Le matériel comprenait des échelles, des cordes, des pompes, des pelles à manche court ainsi que des seaux, et l’équipement : des bottes cuissardes, des lampes frontales et des gants.
La précédente intervention n’avait pu aboutir, l’arrivée d’eau étant telle que malgré sa puissance la pompe n’était pas parvenue à assècher même momentanément le puits.
À la fin d’un hiver sec, le débit modéré a permis à Jean-Laurent Macabet, dûment équipé en égoutier, de descendre tout au fond et de nettoyer la boue qui s’est accumulée au fil du temps tandis que ceux restés à la surface évacuaient la gadoue à l’aide des seaux.
Il a pu s’assurer que la canalisation d’alimentation est en bon état mais aussi, comme on le pensait, que celle d’évacuation est obstruée par des concrétions.C’est donc par capilarité ou par infiltration en aval du puits que le bec de la fontaine correspondant à la source est alimenté.
L’objectif de l’expédition matinale étant atteint, l’équipe s’est dispersée après avoir dégusté le café que Laurence Cambonie, voisine du chantier, était venue offrir gentiment.

Jean-Laurent Macabet, « égoutier » du samedi
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
