Concerts nocturnes à Villedieu
Curieux, tout de même, que les nouvelles pancartes touristiques annonçant les attractions du village ne le mentionnent pas ! Chaque soir, d’avril à juillet, la chorale des Anoures de Villedieu se produit dans le vallon qui va du lavoir à La Magnanarié, et au-delà, jusqu’à l’Aygues. Au programme, des œuvres variées chantées a capella à plusieurs voix, jusque tard dans la nuit.
Faisant preuve de beaucoup de discernement, le maître de chœur (qui désire rester anonyme) a élu domicile dans l’ancien jardin du curé. Il ne s’agit pas d’une grenouille de bénitier, mais d’un individu du genre Rana. Bien que nous n’ayons pas pu l’interviewer, nous avons pu examiner un membre de sa famille provenant d’un bassin voisin : 7 cm de long environ, peau lisse, robe verte avec des taches brunes sur le dessus, une ligne d’un vert bien clair sur la tête, de longues pattes adaptées au saut, il s’agit apparemment de Rana esculenta, la grenouille verte. Tout un honneur pour le village ! Sa présence indique d’abord que le milieu naturel est peu pollué et l’eau de bonne qualité. Mais elle nous rappelle aussi que nous devons beaucoup à ce modeste animal, qui nous a énormément appris dans le domaine de l’embryologie et des malformations naturelles. En particulier, c’est sur la grenouille verte que le biologiste Jean Rostand (vous savez, ce monsieur chauve et digne, à grosses lunettes et à moustache à la Brassens…) a découvert "l’anomalie P" au cours des années 1950.
C’est au début du printemps que les crapauds et les grenouilles choisissent leurs lieux de ponte. Dans ce vallon, qui va du lavoir à La Magnanarié, il y a plusieurs bassins, naturels ou construits, qui forment des lieux propices à la reproduction des grenouilles vertes en particulier. Les mâles atteignent en premier les lieux de ponte. Le soir, lorsque la température est assez élevée, ils se mettent à coasser. Pour cela, ils doivent gonfler deux sacs externes sortis de fentes latérales situées sous la mâchoire inférieure. Au fur et à mesure que les mâles arrivent plus nombreux, un "chœur" local se forme. Lorsqu’un mâle coasse ses voisins lui répondent, manifestant ainsi leur instinct territorial. Le chant s’amplifie jusqu’à ce que le "maître de chœur" le relance pour un nouveau "solo".
N’avons-nous, à Villedieu, que des concerts de grenouilles vertes ? Non, sur le plan musical, nous sommes riches en chants naturels de batraciens. Nos vallons abritent en effet de nombreux Crapauds des joncs, Bufo Calamita, ou Calamites. Or, ceux-ci font partie des crapauds qui coassent, d’ailleurs très fort. Pour ma part, j’ai déjà observé un Calamite dans le vallon ouest et j’entends parfois des coassements plus rauques se mêler au concert nocturne des grenouilles, mais je ne saurais jurer de rien... disons qu’il y a un certain défi pour les oreilles des auditeurs, ce qui est stimulant.
Voilà qui résume l’aspect musical de la chose. Précisons que les concerts sont gratuits et commencent généralement une heure avant le coucher du soleil. Quant à la dimension naturaliste de l’événement, je devine la question la plus pressante : ces cris sont-ils des appels à l’accouplement, et comment cela se fait-il chez les batraciens ? Eh bien, au risque de décevoir certains, non, ce ne sont généralement pas des appels sexuels. Par contre, certaines combinaisons de sons, dans certaines conditions, notamment de température, constituent effectivement des invitations de la part des mâles aux femelles, ou vice-versa.
Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà essayé de retenir entre vos mains une savonnette gluante ? Alors, voilà le problème : le mâle, super-glissant, doit littéralement saisir la femelle, super-glissante, l’étreindre et la maintenir avec ses bras autour de la taille, jusqu’à ce qu’elle déverse ses ovules, qu’il arrosera ensuite de son sperme. C’est ce qu’on appelle l’amplexus. Et certains soirs d’été, passez-moi l’expression, c’est "full d’amplexus" autour des bassins. Pour réussir leur truc, les grenouilles et les crapauds peuvent compter sur des particularités anatomiques. Ainsi, les mâles ont souvent des bras plus courts et plus musclés que les femelles, même s’ils sont en général de plus petite taille que celles-ci. Par ailleurs, beaucoup d’espèces développent des caractères sexuels secondaires à la saison des amours, caractères qui sont sous l’influence d’hormones spécifiques. Par exemple, des coussinets épineux poussent sur les doigts des mâles, leur permettant d’agripper les femelles sans glisser. Dans le cas de certaines espèces de crapauds, la peau des femelles devient plus rude ou plus verruqueuse.
Des grenouilles et des crapauds qui chantent pendant des heures, sans attendre de louanges, sans prétendre à quoi que ce soit : de vrais chefs d’œuvre anonymes. Et tout cela, à Villedieu, un village provençal typique qui offre déjà "ses remparts du XIIIème siècle, son église et son clocher, sa fontaine, sa place ombragée, son bar et ses restaurants..."
En fait, la liste des points d’intérêt est beaucoup plus longue que cela, on comprend qu’il a fallu abréger. Et puis, attention, il ne faudrait peut-être pas trop le répéter, cela va finir par se savoir !
Faisant preuve de beaucoup de discernement, le maître de chœur (qui désire rester anonyme) a élu domicile dans l’ancien jardin du curé. Il ne s’agit pas d’une grenouille de bénitier, mais d’un individu du genre Rana. Bien que nous n’ayons pas pu l’interviewer, nous avons pu examiner un membre de sa famille provenant d’un bassin voisin : 7 cm de long environ, peau lisse, robe verte avec des taches brunes sur le dessus, une ligne d’un vert bien clair sur la tête, de longues pattes adaptées au saut, il s’agit apparemment de Rana esculenta, la grenouille verte. Tout un honneur pour le village ! Sa présence indique d’abord que le milieu naturel est peu pollué et l’eau de bonne qualité. Mais elle nous rappelle aussi que nous devons beaucoup à ce modeste animal, qui nous a énormément appris dans le domaine de l’embryologie et des malformations naturelles. En particulier, c’est sur la grenouille verte que le biologiste Jean Rostand (vous savez, ce monsieur chauve et digne, à grosses lunettes et à moustache à la Brassens…) a découvert "l’anomalie P" au cours des années 1950.
C’est au début du printemps que les crapauds et les grenouilles choisissent leurs lieux de ponte. Dans ce vallon, qui va du lavoir à La Magnanarié, il y a plusieurs bassins, naturels ou construits, qui forment des lieux propices à la reproduction des grenouilles vertes en particulier. Les mâles atteignent en premier les lieux de ponte. Le soir, lorsque la température est assez élevée, ils se mettent à coasser. Pour cela, ils doivent gonfler deux sacs externes sortis de fentes latérales situées sous la mâchoire inférieure. Au fur et à mesure que les mâles arrivent plus nombreux, un "chœur" local se forme. Lorsqu’un mâle coasse ses voisins lui répondent, manifestant ainsi leur instinct territorial. Le chant s’amplifie jusqu’à ce que le "maître de chœur" le relance pour un nouveau "solo".
N’avons-nous, à Villedieu, que des concerts de grenouilles vertes ? Non, sur le plan musical, nous sommes riches en chants naturels de batraciens. Nos vallons abritent en effet de nombreux Crapauds des joncs, Bufo Calamita, ou Calamites. Or, ceux-ci font partie des crapauds qui coassent, d’ailleurs très fort. Pour ma part, j’ai déjà observé un Calamite dans le vallon ouest et j’entends parfois des coassements plus rauques se mêler au concert nocturne des grenouilles, mais je ne saurais jurer de rien... disons qu’il y a un certain défi pour les oreilles des auditeurs, ce qui est stimulant.
Voilà qui résume l’aspect musical de la chose. Précisons que les concerts sont gratuits et commencent généralement une heure avant le coucher du soleil. Quant à la dimension naturaliste de l’événement, je devine la question la plus pressante : ces cris sont-ils des appels à l’accouplement, et comment cela se fait-il chez les batraciens ? Eh bien, au risque de décevoir certains, non, ce ne sont généralement pas des appels sexuels. Par contre, certaines combinaisons de sons, dans certaines conditions, notamment de température, constituent effectivement des invitations de la part des mâles aux femelles, ou vice-versa.
Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà essayé de retenir entre vos mains une savonnette gluante ? Alors, voilà le problème : le mâle, super-glissant, doit littéralement saisir la femelle, super-glissante, l’étreindre et la maintenir avec ses bras autour de la taille, jusqu’à ce qu’elle déverse ses ovules, qu’il arrosera ensuite de son sperme. C’est ce qu’on appelle l’amplexus. Et certains soirs d’été, passez-moi l’expression, c’est "full d’amplexus" autour des bassins. Pour réussir leur truc, les grenouilles et les crapauds peuvent compter sur des particularités anatomiques. Ainsi, les mâles ont souvent des bras plus courts et plus musclés que les femelles, même s’ils sont en général de plus petite taille que celles-ci. Par ailleurs, beaucoup d’espèces développent des caractères sexuels secondaires à la saison des amours, caractères qui sont sous l’influence d’hormones spécifiques. Par exemple, des coussinets épineux poussent sur les doigts des mâles, leur permettant d’agripper les femelles sans glisser. Dans le cas de certaines espèces de crapauds, la peau des femelles devient plus rude ou plus verruqueuse.
Des grenouilles et des crapauds qui chantent pendant des heures, sans attendre de louanges, sans prétendre à quoi que ce soit : de vrais chefs d’œuvre anonymes. Et tout cela, à Villedieu, un village provençal typique qui offre déjà "ses remparts du XIIIème siècle, son église et son clocher, sa fontaine, sa place ombragée, son bar et ses restaurants..."
En fait, la liste des points d’intérêt est beaucoup plus longue que cela, on comprend qu’il a fallu abréger. Et puis, attention, il ne faudrait peut-être pas trop le répéter, cela va finir par se savoir !
Jean Pierre Rogel
Journaliste scientifique et écrivain, Jean-Pierre Rogel habite (parfois…
le plus souvent possible) au village de Villedieu...
et le reste du temps à Montréal.
Journaliste scientifique et écrivain, Jean-Pierre Rogel habite (parfois…
le plus souvent possible) au village de Villedieu...
et le reste du temps à Montréal.
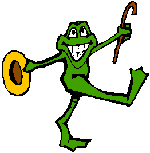


Cliquez sur les photos
pour les agrandir
Les faucons, seigneurs du ciel de Villedieu
A l’heure de l’apéro, le 4 juillet dernier, un terrible drame social a eu lieu dans la tour du château, dans la totale indifférence des apéritiveurs nichés sur la place du village à 100 mètres de là.
C’est en effet vers 20 heures qu’une respectable résidente de Villedieu a littéralement jeté ses deux enfants sur le pavé, leur signifiant qu’ils ne pouvaient plus désormais demeurer au domicile familial. Fini le confort douillet, les repas gratuits et les grasses matinées…désormais, il leur faudrait voler de leurs propres ailes.
Joignant le geste à la parole, la mère de famille s’est perchée sur un arbre voisin et a appelé ses petits pour qu’ils la rejoignent. Ceux-ci ont longuement hésité, se balançant d’arrière en avant au bord du trou dans le mur leur faisant office de nid. Puis, le plus audacieux des deux jeunes a battu furieusement des ailes pendant 30 secondes et s’est lancé dans les airs.
Lorsque le mistral l’a rabattu vers le sol, il a eu un battement d’ailes frénétique et s’est redressé. Après avoir effleuré l’arbre où sa mère l’attendait, il est vite revenu vers le nid. Une envolée de quatre secondes, la première de son existence…
Ainsi va la vie au début de l’été chez Falco tinnunculus, le faucon crécerelle. Les Villadéens témoignent que ces rapaces sont présents depuis très longtemps dans le ciel et qu’ils nichent au château. Bien qu’un couple de faucons ait apparemment déjà fait son nid sur la terrasse du château, le site le plus utilisé est la petite pièce ronde au sommet de la tour, qui communique avec l’extérieur par une petite ouverture. Cette cavité « naturelle » fait un bon nid car elle est bien protégée et leur permet de dominer du regard toute la vallée.
De source fiable, au moins deux autres nids de crécerelles ont été signalés dans le passé dans la région immédiate, un à La Magnanarié (abandonné, suite à des travaux de rénovation) et un autre à Ste-Croix près de Vaison (toujours actif). Mais ici au village, les avis divergent. Certains soutiennent que les faucons se sont toujours reproduits au château, ou du moins depuis qu’il n’est habité que temporairement pendant l’été.
D’autres disent qu’on y voit des nids que depuis 4 ou 5 ans. Quoi qu’il en soit, les observations concordent au sujet du calendrier : c’est au début d’avril que les couples se forment et s’installent dans le nid de la tour. En juin, les œufs sont éclos, les petits passent la tête au bord du trou et on voit les adultes faire des allers et retours pour les nourrir.
Fin juin ou début juillet, les fauconneaux et leurs parents s’envolent. Pour aller où cela ? « Au sud… au Sahara… en Afrique », m’a-t-on répondu (5 réponses), « dans les collines de la Drôme, où il y a plus de nourriture pour eux.. » (1 réponse), « pas très loin, car on les revoit en hiver… » (3 réponses), et « je ne sais pas... » (4 réponses). Alors, comme dans un quizz, la bonne réponse, c’est…la troisième. Ce ne sont pas des migrateurs, mais des permanents bien adaptés à la région.
Par contre, il est vrai qu’un certain nombre de crécerelles nordiques viennent passer la mauvaise saison chez nous…ah, l’attrait du midi !
Peut-être croit-on qu’ils migrent parce qu’ils quittent le nid lors de l’envol des juvéniles, comme ils ont fait cette année. Mais ils ne vont pas loin. Ils s’installent généralement – et ce fut le cas cette année - au sommet d’un ou de plusieurs grands arbres à proximité. Ils y viennent manger et se reposer, exploitant le territoire qu’ils ont découvert au printemps. En fait, tout l’été, les juvéniles apprennent à chasser avec leurs parents et ils ne les quittent que très tard à l’automne.
D’envergure plutôt modeste pour un rapace (de 70 à 85 cm) , ce faucon roux, à poitrine mouchetée, a une tête assez grosse, de longues ailes pointues et la queue allongée. La femelle est d’ordinaire plus rousse que le mâle. En chasse, on peut reconnaître ce faucon par son vol stationnaire, appelé vol « en Saint-Esprit ». Pendant de longues minutes, il se maintient sur place face au vent, observant son territoire de chasse.
Que les agriculteurs et les chasseurs se rassurent : ces rapaces ne se nourrissent que de petits rongeurs, et à l’occasion, de reptiles de petite taille et de gros insectes. A ce sujet, des chercheurs finlandais ont récemment prouvé que les crécerelles voient dans le spectre de l’ultraviolet. Cette capacité remarquable leur permet de repérer, de très haut, les traces d’urine de leurs proies favorites, les campagnols, traces qui sont bien visibles en lumière ultraviolette. Un œil de faucon, c’est donc aussi un radar à souris des champs !
Rangeons les carabines, ces oiseaux doivent impérativement être protégés et on ne doit pas les déranger. Leur présence, ainsi que celle de nombreuses autres espèces d’oiseaux comme les pies, les geais, les martinets et les mésanges, témoigne d’un milieu sain, en équilibre. Les oiseaux contrôlent notamment les explosions de populations d’insectes, parfois gênantes pour nous, humains (n’avons-nous pas passé l’été à pester contre les mouches ? Imaginez, s’il n’y avait pas eu d’oiseaux !).
Ils sont hélas menacés par le développement. Si cette espèce, la plus commune parmi les faucons, ne semble pas en diminution dans notre région, il n’en va pas de même pour son cousin le faucon hobereau… ni pour le faucon pèlerin, le busard Saint-Martin, le vautour percnoptère, le vautour fauve, l’aigle de Bonelli. La liste est longue des seigneurs du ciel qu’on n’aperçoit plus dans notre ciel, sinon à la faveur d’un projet de conservation. Allons voir les magnifiques vautours fauves ré-introduits à Rémuzat, mais soyons aussi fiers de cette richesse à préserver sur notre commune.
C’est en effet vers 20 heures qu’une respectable résidente de Villedieu a littéralement jeté ses deux enfants sur le pavé, leur signifiant qu’ils ne pouvaient plus désormais demeurer au domicile familial. Fini le confort douillet, les repas gratuits et les grasses matinées…désormais, il leur faudrait voler de leurs propres ailes.
Joignant le geste à la parole, la mère de famille s’est perchée sur un arbre voisin et a appelé ses petits pour qu’ils la rejoignent. Ceux-ci ont longuement hésité, se balançant d’arrière en avant au bord du trou dans le mur leur faisant office de nid. Puis, le plus audacieux des deux jeunes a battu furieusement des ailes pendant 30 secondes et s’est lancé dans les airs.
Lorsque le mistral l’a rabattu vers le sol, il a eu un battement d’ailes frénétique et s’est redressé. Après avoir effleuré l’arbre où sa mère l’attendait, il est vite revenu vers le nid. Une envolée de quatre secondes, la première de son existence…
Ainsi va la vie au début de l’été chez Falco tinnunculus, le faucon crécerelle. Les Villadéens témoignent que ces rapaces sont présents depuis très longtemps dans le ciel et qu’ils nichent au château. Bien qu’un couple de faucons ait apparemment déjà fait son nid sur la terrasse du château, le site le plus utilisé est la petite pièce ronde au sommet de la tour, qui communique avec l’extérieur par une petite ouverture. Cette cavité « naturelle » fait un bon nid car elle est bien protégée et leur permet de dominer du regard toute la vallée.
De source fiable, au moins deux autres nids de crécerelles ont été signalés dans le passé dans la région immédiate, un à La Magnanarié (abandonné, suite à des travaux de rénovation) et un autre à Ste-Croix près de Vaison (toujours actif). Mais ici au village, les avis divergent. Certains soutiennent que les faucons se sont toujours reproduits au château, ou du moins depuis qu’il n’est habité que temporairement pendant l’été.
D’autres disent qu’on y voit des nids que depuis 4 ou 5 ans. Quoi qu’il en soit, les observations concordent au sujet du calendrier : c’est au début d’avril que les couples se forment et s’installent dans le nid de la tour. En juin, les œufs sont éclos, les petits passent la tête au bord du trou et on voit les adultes faire des allers et retours pour les nourrir.
Fin juin ou début juillet, les fauconneaux et leurs parents s’envolent. Pour aller où cela ? « Au sud… au Sahara… en Afrique », m’a-t-on répondu (5 réponses), « dans les collines de la Drôme, où il y a plus de nourriture pour eux.. » (1 réponse), « pas très loin, car on les revoit en hiver… » (3 réponses), et « je ne sais pas... » (4 réponses). Alors, comme dans un quizz, la bonne réponse, c’est…la troisième. Ce ne sont pas des migrateurs, mais des permanents bien adaptés à la région.
Par contre, il est vrai qu’un certain nombre de crécerelles nordiques viennent passer la mauvaise saison chez nous…ah, l’attrait du midi !
Peut-être croit-on qu’ils migrent parce qu’ils quittent le nid lors de l’envol des juvéniles, comme ils ont fait cette année. Mais ils ne vont pas loin. Ils s’installent généralement – et ce fut le cas cette année - au sommet d’un ou de plusieurs grands arbres à proximité. Ils y viennent manger et se reposer, exploitant le territoire qu’ils ont découvert au printemps. En fait, tout l’été, les juvéniles apprennent à chasser avec leurs parents et ils ne les quittent que très tard à l’automne.
D’envergure plutôt modeste pour un rapace (de 70 à 85 cm) , ce faucon roux, à poitrine mouchetée, a une tête assez grosse, de longues ailes pointues et la queue allongée. La femelle est d’ordinaire plus rousse que le mâle. En chasse, on peut reconnaître ce faucon par son vol stationnaire, appelé vol « en Saint-Esprit ». Pendant de longues minutes, il se maintient sur place face au vent, observant son territoire de chasse.
Que les agriculteurs et les chasseurs se rassurent : ces rapaces ne se nourrissent que de petits rongeurs, et à l’occasion, de reptiles de petite taille et de gros insectes. A ce sujet, des chercheurs finlandais ont récemment prouvé que les crécerelles voient dans le spectre de l’ultraviolet. Cette capacité remarquable leur permet de repérer, de très haut, les traces d’urine de leurs proies favorites, les campagnols, traces qui sont bien visibles en lumière ultraviolette. Un œil de faucon, c’est donc aussi un radar à souris des champs !
Rangeons les carabines, ces oiseaux doivent impérativement être protégés et on ne doit pas les déranger. Leur présence, ainsi que celle de nombreuses autres espèces d’oiseaux comme les pies, les geais, les martinets et les mésanges, témoigne d’un milieu sain, en équilibre. Les oiseaux contrôlent notamment les explosions de populations d’insectes, parfois gênantes pour nous, humains (n’avons-nous pas passé l’été à pester contre les mouches ? Imaginez, s’il n’y avait pas eu d’oiseaux !).
Ils sont hélas menacés par le développement. Si cette espèce, la plus commune parmi les faucons, ne semble pas en diminution dans notre région, il n’en va pas de même pour son cousin le faucon hobereau… ni pour le faucon pèlerin, le busard Saint-Martin, le vautour percnoptère, le vautour fauve, l’aigle de Bonelli. La liste est longue des seigneurs du ciel qu’on n’aperçoit plus dans notre ciel, sinon à la faveur d’un projet de conservation. Allons voir les magnifiques vautours fauves ré-introduits à Rémuzat, mais soyons aussi fiers de cette richesse à préserver sur notre commune.
Jean-Pierre Rogel

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
La garrigue grandeur nature
Voilà enfin un livre consacré à la flore sauvage, aux insectes et reptiles du sud de la France.
On a du plaisir, après une balade, à y retrouver la photo et le nom des quelques fleurs vues ou cueillies dans un fossé, de retrouver sur papier glacé, l'insecte étrange qui a atterri sur la table du jardin, de connaître le nom exact du petit serpent aperçu derrière le tas de bois.
C'est un livre magnifique, facile d'accès, aux textes simples et aux innombrables photos. Il s'adresse à tous ceux, qui lors de leurs promenades, aspirent à regarder autre chose que le bout de leurs pieds.
A découvrir !
On a du plaisir, après une balade, à y retrouver la photo et le nom des quelques fleurs vues ou cueillies dans un fossé, de retrouver sur papier glacé, l'insecte étrange qui a atterri sur la table du jardin, de connaître le nom exact du petit serpent aperçu derrière le tas de bois.
C'est un livre magnifique, facile d'accès, aux textes simples et aux innombrables photos. Il s'adresse à tous ceux, qui lors de leurs promenades, aspirent à regarder autre chose que le bout de leurs pieds.
A découvrir !
Sylvie Maindiaux
Editions "Les Créations du Pélican".
Textes et photos de Jean-Michel Renault,
336 pages et environ 2 500 illustrations.
Textes et photos de Jean-Michel Renault,
336 pages et environ 2 500 illustrations.

Nous ne savions pas que le haut Vaucluse est une des régions les moins fleuries de France. C'est pourquoi le conseil général a décidé de mettre en place une opération « les villages fleuris » et proposé aux communes une aide pour décorer leur village par des plantations dont elles choisiraient la nature et les emplacements.
Huguette Louis s'est donc rendue à une réunion d'information organisée par la mairie de Vaison pour savoir quels étaient les moyens mis en œuvre. La proposition du conseil général est de financer les plantations, laissant à la charge des communes la mise en terre et l'entretien. Lorsque l'ensemble des demandes lui sera parvenu, il fournira les plants ce qui devrait se faire dans le courant de l'automne.
Renaud Tournillon, le petit-fils de M. et Mme Joubert, est paysagiste et a conseillé pour Villedieu un ensemble d'arbustes correspondant au mieux aux endroits à aménager. Le conseil municipal a accepté le devis qu'il a présenté.
Les millepertuis, romarins, cistes, lilas des indes, arbres aux papillons, ampélopsis, rosiers paysagers et lauriers tins, agrémenteront ainsi le mur du cimetière, le mur de clôture de la maison de M. et Mme Metheven (qu'occupaient M. et Mme Savy), les banquettes du parking près de l'école et l'espace derrière le garage qui lui est mitoyen.
Pour compléter cet embellissement, il a été décidé de construire un abri pour dissimuler les poubelles se trouvant près de la maison de Léopold Dieu et de déplacer celles situées près du jeu de boules en les installant près du garage derrière les écoles là aussi dissimulées par un muret comme il a été fait à l'entrée de Villedieu en venant de Roaix.
Il est important d’enrichir ainsi Villedieu que l’on découvre toujours avec bonheur par quelque route que l’on vienne.
Claude Bériot

Cliquez sur la photo
pour les agrandir
Villedieu fleuri
La municipalité de Villedieu participe à la campagne du Conseil Général de Vaucluse : villes et villages fleuris.
Six jarres fleuries ont été installées sur les banquettes face à l'école, trois autres à la hauteur de la Ramade.
A l'automne, le conseil général fournira des arbustes qui seront plantés dans différents endroits de Villedieu.
Huguette Louis prend soin des fleurs, les soigne et les arrose avec amour. Malgré son bon exemple, des personnes indélicates sont venues se servir dans certaines compositions printanières.
Faudrait-il un gendarme à chaque coin de rue ?
Six jarres fleuries ont été installées sur les banquettes face à l'école, trois autres à la hauteur de la Ramade.
A l'automne, le conseil général fournira des arbustes qui seront plantés dans différents endroits de Villedieu.
Huguette Louis prend soin des fleurs, les soigne et les arrose avec amour. Malgré son bon exemple, des personnes indélicates sont venues se servir dans certaines compositions printanières.
Faudrait-il un gendarme à chaque coin de rue ?
Yvan Raffin
Dès qu’il fait beau, il paresse au soleil et recherche en particulier les terrasses bien exposées au sud. Il ne bouge presque pas, il profite des rayons de soleil sur sa peau. De son nez pointu, il flaire l’air avec précaution. Il est bien connu de tous les Villadéens…vous pensez à quelqu’un en particulier ? Eh bien non, vous avez perdu : c’est un animal, le lézard des murailles ou lézard gris, Lacerta muralis.
Mince, plat, une longue queue, une couleur brune ou grise avec des marbrures plus ou moins nettes, de 10 à 15 cm de long : c’est lui. On le voit beaucoup sur les murs des maisons, dans les jardins et sur les sentiers autour du village, et cela, en toute saison. Mais il est farouche et fuit rapidement lorsqu’on le dérange. Autre signe distinctif : le lézard des murailles n’aime pas le mistral, il ne sort pas s’il y a du vent. Par ailleurs, l’été, aux heures les plus chaudes, il fuit le soleil... Là encore, on voit une certaine ressemblance avec le comportement du Villadéen moyen.
Comme il a une meilleure vision sur le côté, à cause de la position de ses yeux, on peut plus facilement l’approcher en lui faisant face, très, très lentement. Mais le capturer est une autre affaire... Rapide comme l’éclair, il plonge dans un trou ou une fissure de mur et ne réapparait ensuite que très prudemment. Là-dessus, une anecdote, racontée par une Villadéenne : enfants, ils s’amusaient à tendre une perche avec une ficelle et un nœud coulant au-dessus des nids de lézards gris pour les capturer, et ensuite les relâcher. « Je n’ai réussi que deux fois, dit notre intrépide. Les lézards étaient trop malins ».
S’il est aggripé par la queue, ou bien mordu par un autre animal dans cette partie du corps, le lézard gris l’abandonne pour mieux fuir. C’est ce qu’on appelle une queue autotomique : l’animal est capable de s’amputer spontanément de cet organe et survit à cette amputation. La queue va ensuite repousser, mais attention, une fois dans sa vie seulement ! Par la suite, elle ne sera plus sujette à l’autotomie.
En général, ce petit animal n’est pas importuné par les humains, même s’il vit dans les murs des maisons. Il faut dire qu’il est inoffensif et qu’il a une apparence plutôt sympathique pour un reptile. Il faut simplement veiller à lui laisser son territoire intact (et ne pas cimenter, par exemple, les murs de pierre où il niche). Sa « réputation », par ailleurs, est bonne. On le considère plutôt comme un ami des hommes. Il paraît qu’au Moyen Age on disait que lorsqu’un lézard voyait un serpent menaçant s'approcher d'une personne endormie, il lui sautait subitement sur le corps pour la prévenir du danger.
Ce petit reptile joue vaillamment son rôle dans l’écosystème. Il se nourrit essentiellement d’insectes, notamment d’araignées et de mouches. Vous souvenez-vous de l’explosion de populations d’insectes en juin dernier ? Il a contribué à la contrôler, notamment avec les martinets et les chauves-souris, espèces qui sont par ailleurs bien présentes ici. Quant à ses prédateurs, ce sont principalement les couleuvres, les vipères, les oiseaux de proie et les chats ... encore que le matou domestique moyen manque singulièrement de vitesse pour agrémenter son menu ordinaire de lézard des murailles.
Enfin, signalons qu’il a de la famille en Provence, notamment un cousin nommé Lacerta viridis. C’est un lézard vert d’environ 20 cm de long qu’on voit aussi parfois dans nos jardins et qu’on doit impérieusement protéger car il est menacé de disparition. Il y a aussi le fameux lézard ocellé, un grand lézard jaune qui vit dans les garrigues. Avec ses 60 cm de long, c’est le plus grand lézard d’Europe. On le dit ocellé parce que pendant la période des amours, les flancs du mâle se couvrent d’ocelles bleues. Bleues sur fond jaune, avec un décor de calcaire gris et de végétation brûlée par le soleil ... dommage que Van Gogh ou Cézanne n’étaient pas naturalistes, cela aurait fait de superbes sujets de peinture !
Mince, plat, une longue queue, une couleur brune ou grise avec des marbrures plus ou moins nettes, de 10 à 15 cm de long : c’est lui. On le voit beaucoup sur les murs des maisons, dans les jardins et sur les sentiers autour du village, et cela, en toute saison. Mais il est farouche et fuit rapidement lorsqu’on le dérange. Autre signe distinctif : le lézard des murailles n’aime pas le mistral, il ne sort pas s’il y a du vent. Par ailleurs, l’été, aux heures les plus chaudes, il fuit le soleil... Là encore, on voit une certaine ressemblance avec le comportement du Villadéen moyen.
Comme il a une meilleure vision sur le côté, à cause de la position de ses yeux, on peut plus facilement l’approcher en lui faisant face, très, très lentement. Mais le capturer est une autre affaire... Rapide comme l’éclair, il plonge dans un trou ou une fissure de mur et ne réapparait ensuite que très prudemment. Là-dessus, une anecdote, racontée par une Villadéenne : enfants, ils s’amusaient à tendre une perche avec une ficelle et un nœud coulant au-dessus des nids de lézards gris pour les capturer, et ensuite les relâcher. « Je n’ai réussi que deux fois, dit notre intrépide. Les lézards étaient trop malins ».
S’il est aggripé par la queue, ou bien mordu par un autre animal dans cette partie du corps, le lézard gris l’abandonne pour mieux fuir. C’est ce qu’on appelle une queue autotomique : l’animal est capable de s’amputer spontanément de cet organe et survit à cette amputation. La queue va ensuite repousser, mais attention, une fois dans sa vie seulement ! Par la suite, elle ne sera plus sujette à l’autotomie.
En général, ce petit animal n’est pas importuné par les humains, même s’il vit dans les murs des maisons. Il faut dire qu’il est inoffensif et qu’il a une apparence plutôt sympathique pour un reptile. Il faut simplement veiller à lui laisser son territoire intact (et ne pas cimenter, par exemple, les murs de pierre où il niche). Sa « réputation », par ailleurs, est bonne. On le considère plutôt comme un ami des hommes. Il paraît qu’au Moyen Age on disait que lorsqu’un lézard voyait un serpent menaçant s'approcher d'une personne endormie, il lui sautait subitement sur le corps pour la prévenir du danger.
Ce petit reptile joue vaillamment son rôle dans l’écosystème. Il se nourrit essentiellement d’insectes, notamment d’araignées et de mouches. Vous souvenez-vous de l’explosion de populations d’insectes en juin dernier ? Il a contribué à la contrôler, notamment avec les martinets et les chauves-souris, espèces qui sont par ailleurs bien présentes ici. Quant à ses prédateurs, ce sont principalement les couleuvres, les vipères, les oiseaux de proie et les chats ... encore que le matou domestique moyen manque singulièrement de vitesse pour agrémenter son menu ordinaire de lézard des murailles.
Enfin, signalons qu’il a de la famille en Provence, notamment un cousin nommé Lacerta viridis. C’est un lézard vert d’environ 20 cm de long qu’on voit aussi parfois dans nos jardins et qu’on doit impérieusement protéger car il est menacé de disparition. Il y a aussi le fameux lézard ocellé, un grand lézard jaune qui vit dans les garrigues. Avec ses 60 cm de long, c’est le plus grand lézard d’Europe. On le dit ocellé parce que pendant la période des amours, les flancs du mâle se couvrent d’ocelles bleues. Bleues sur fond jaune, avec un décor de calcaire gris et de végétation brûlée par le soleil ... dommage que Van Gogh ou Cézanne n’étaient pas naturalistes, cela aurait fait de superbes sujets de peinture !
Jean-Pierre Rogel



Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Les cigales
La cigale, symbole de la Provence, celle qui, dès que les beaux jours se pointent, annonce que l’été est installé.
Cigale la timide, ton camouflage parfait est tel qu’il est pratiquement impossible de t’apercevoir sur les troncs des arbres où tu t’installée.
Tes cousines d’outremer, celles qui vivent dans les forêts vierges de Bornéo, sont encore plus bavardes et m’ont révélé quelques secrets.
Plus grandes, à la robe chatoyante vert vif, ou les tachetées (la Pomponia Imperatoria) qui mesure près de 10 cm. Leur chant est tellement puissant que même les singes s’en bouchent les oreilles. Et puis ces cousines parlent avec un accent qui n’est pas celui d’ici. C’est évident !
La cigale est un homoptère de l’ordre des insectes. Dans le monde, il en existe quelque 4 500 espèces et en France 16.
En Provence, la cigale grise, appelée CACAN en provençal, mesure 5 cm. La cigale pygmée, la plus petite, ne fait que 2 cm. La cigale du Garric vit près des Dentelles de Montmirail. La cigale montagnarde vit, elle, dans les pins noirs sur les pentes du Ventoux.
En 1990, en Ardèche, on découvrait une cigale fossilisée datant de 8 millions d’années.
Vie et mort d'une cigale
Une vie bien compliquée. Les femelles déposent leurs œufs dans des plantes qu’elles percent à l’aide de la TARIÈRE se situant à la partie inférieure de l’abdomen. Elles creusent une quarantaine de cavités dans lesquelles est déposée une dizaine d’œufs.
Deux à trois mois plus tard, les œufs éclosent. En sortant, les larves s’extraient de l’œuf et, à l’aide d’un filament, se laissent glisser jusqu’au sol où elles vont s’enterrer pour trois à six ans pour les cigales méditerranéennes et jusqu’à 17 ans pour la Tibicina Septendecim d’Amérique. A l’aide du ROSTRE (pompe buccale), elles se gorgent de la sève des racines.
Après de nombreuses mues, elles se transforment en nymphes, émergent de leurs galeries souterraines, grimpent le long d’un support rigide et se débarrassent de leur gaine brune.
Alors une courte vie amoureuse va commencer. Le mâle, durant sa longue vie souterraine, s’est initié au solfège qu’il va mettre en pratique pour séduire sa promise qu’il entraîne dans un tango endiablé.
Leur vie sera courte, un mois tout au plus, mais avouez que c’est une bien belle histoire.
Et comment ça chante ?
Les mâles sont dotés d’une paire de cymbales situées de chaque côté de l’abdomen, contractées par des muscles et des tendons.
La répétition rapide de ces mouvements (300 à 900 par seconde) est amplifiée par la caisse de résonance interne. C’est le chant du CIGALOU que l’on entend dès que la température atteint les 22° (chaleur nécessaire à la mise en action des muscles).
Tu nous insupportes, l’après-midi, lorsque que la chaleur est trop forte, les étés de canicule et que l’on souhaiterait faire la sieste, mais tout de même, quand à la fin de l’été ton chant s’arrête ... nou manques Cigalo !
Cigale la timide, ton camouflage parfait est tel qu’il est pratiquement impossible de t’apercevoir sur les troncs des arbres où tu t’installée.
Tes cousines d’outremer, celles qui vivent dans les forêts vierges de Bornéo, sont encore plus bavardes et m’ont révélé quelques secrets.
Plus grandes, à la robe chatoyante vert vif, ou les tachetées (la Pomponia Imperatoria) qui mesure près de 10 cm. Leur chant est tellement puissant que même les singes s’en bouchent les oreilles. Et puis ces cousines parlent avec un accent qui n’est pas celui d’ici. C’est évident !
La cigale est un homoptère de l’ordre des insectes. Dans le monde, il en existe quelque 4 500 espèces et en France 16.
En Provence, la cigale grise, appelée CACAN en provençal, mesure 5 cm. La cigale pygmée, la plus petite, ne fait que 2 cm. La cigale du Garric vit près des Dentelles de Montmirail. La cigale montagnarde vit, elle, dans les pins noirs sur les pentes du Ventoux.
En 1990, en Ardèche, on découvrait une cigale fossilisée datant de 8 millions d’années.
Vie et mort d'une cigale
Une vie bien compliquée. Les femelles déposent leurs œufs dans des plantes qu’elles percent à l’aide de la TARIÈRE se situant à la partie inférieure de l’abdomen. Elles creusent une quarantaine de cavités dans lesquelles est déposée une dizaine d’œufs.
Deux à trois mois plus tard, les œufs éclosent. En sortant, les larves s’extraient de l’œuf et, à l’aide d’un filament, se laissent glisser jusqu’au sol où elles vont s’enterrer pour trois à six ans pour les cigales méditerranéennes et jusqu’à 17 ans pour la Tibicina Septendecim d’Amérique. A l’aide du ROSTRE (pompe buccale), elles se gorgent de la sève des racines.
Après de nombreuses mues, elles se transforment en nymphes, émergent de leurs galeries souterraines, grimpent le long d’un support rigide et se débarrassent de leur gaine brune.
Alors une courte vie amoureuse va commencer. Le mâle, durant sa longue vie souterraine, s’est initié au solfège qu’il va mettre en pratique pour séduire sa promise qu’il entraîne dans un tango endiablé.
Leur vie sera courte, un mois tout au plus, mais avouez que c’est une bien belle histoire.
Et comment ça chante ?
Les mâles sont dotés d’une paire de cymbales situées de chaque côté de l’abdomen, contractées par des muscles et des tendons.
La répétition rapide de ces mouvements (300 à 900 par seconde) est amplifiée par la caisse de résonance interne. C’est le chant du CIGALOU que l’on entend dès que la température atteint les 22° (chaleur nécessaire à la mise en action des muscles).
Tu nous insupportes, l’après-midi, lorsque que la chaleur est trop forte, les étés de canicule et que l’on souhaiterait faire la sieste, mais tout de même, quand à la fin de l’été ton chant s’arrête ... nou manques Cigalo !
Françoise Tercerie
| Proverbes en provençal sur les cigales • Urous de vièure coumo uno cigalo Heureux de vivre comme une cigale • Remena lou cuou coumo uno cigalo Se trémousser le derrière comme une cigale • Avé di cigalo din la testa Avoir des cigales dans la tête (faire des caprices) • Faire un cigau Faire une bêtise |


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Buisgreen et Villewich
Les lecteurs de La Gazette sont des privilégiés. Cette publication bien qu’apériodique est, en effet, l’une des seules qui présente leurs éventuelles mises au point dans le numéro même où paraît un article sujet à discussion. En voici un exemple.
Plus haut dans le présent numéro, est narrée l’installation d’un cadran solaire au beffroi de Buisson. L’auteur précise que l’heure indiquée par ce cadran avance de deux heures et neuf minutes sur l’heure légale, celle indiquée par l’horloge. Cette assertion a provoqué la réaction de T. d. C. - T. d. V., relecteur et lecteur presque assidu de La Gazette. Voici ce qu’il écrit.
L’heure de référence internationale est celle du méridien de Greenwich. Ce gros faubourg de Londres qui disposait d’un observatoire a été pris pour méridien d’origine en 1911. Ainsi est défini un « temps » fréquemment appelé « G.M.T. » pour « Greenwich Mean Time », soit temps moyen de Greenwich dont l’origine est midi. Il est donc midi G.M.T. à l’instant où le soleil est apparemment au plus haut dans le ciel sur tous les points d’une ligne imaginaire, en demi-cercle, reliant les pôles et passant par l’observatoire anglais.
La surface du globe est divisée géométriquement, et conventionnellement, en 360 degrés. Ainsi chaque méridien est exprimé par l’angle formé aux pôles par celui-ci et le méridien de Greenwich. Ce procédé permet de situer chaque point de la terre en longitude. Si l’on consulte la carte Michelin « 332 local, Drôme, Vaucluse », l’on constate que Buisson est situé par cinq degrés de longitude Est (la ligne verticale passant par Buisson est notée 5° au bas de la carte).
La sphère terrestre est également découpée en vingt-quatre fuseaux horaires comme la surface externe des quartiers d’une orange.
Buisson
Pour calculer l’écart de « temps solaire » entre Greenwich et Buisson, il convient d’établir l’équivalent en « temps » d’un degré de longitude et de le multiplier par cinq.
- La terre exécute une rotation sur elle-même par rapport au soleil en vingt-quatre heures de soixante minutes, elle tourne en mille quatre cent quarante minutes.
- Si par ailleurs le globe est divisé en 360°, chaque degré représente : 1440 divisé par 360, soit 4 minutes de « temps solaire ».
Buisson étant situé à cinq degrés de longitude Est, le soleil passe apparemment à son zénith à Buisson vingt minutes avant d’être au zénith de Greenwich.
Nous savons tous, et certains s’en plaignent, que l’heure légale est postérieure à l’heure G.M.T. de deux heures l’été et d’une heure l’hiver. La France est située dans le même fuseau horaire que Greenwich. Ainsi quand il est midi à nos montres l’été (heure légale), il est dix heures (solaire) à Greenwich et dix heures vingt minutes au cadran solaire du beffroi. C’est-à-dire que le cadran indiquera une heure quarante minutes de moins que l’horloge. L’hiver, quand le cadran de Buisson indiquera midi, il sera midi quarante à nos pendules.
Et Villedieu
La carte "3139 ET" de l’Institut Géographique National montre que le méridien de Villedieu est noté « 3 gd » au bas de la feuille. Vérifiez et vous verrez que Villedieu aussi possède son méridien officiel. C’est qu’en 1891, la République avait fixé un « découpage » cartographique du globe en quatre cents grades d’angles de longitude à partir du méridien passant par l’observatoire de Paris.
Ainsi pour établir l’écart de « temps solaire » entre Villedieu et Paris, il faut rechercher l’équivalent en temps d’un grade puis le multiplier par trois. La terre exécutant une rotation en mille quatre cent quarante minutes, elle tourne en quatre-vingt six mille secondes. Chaque grade représente un laps de temps de : 86 400 divisé par 400, soit 216 secondes, soit trois minutes et trente-six secondes. Villedieu est donc à dix minutes et quarante-huit secondes solaires de Paris. En d’autres termes, on peu dire que la « culmination » du soleil dans le ciel du lotissement Gustave Tardieu au Connier se produit dix minutes et quarante-huit secondes avant sa « culmination » dans le ciel du jardin de l’observatoire de Paris.
Et Greenwich
Si l’on sait, en consultant les livres, que le méridien de Paris, référence en grades, est situé à neuf minutes et vingt et une secondes de celui de Greenwich, référence en degrés, on peut conclure que le midi solaire intervient vingt minutes et neuf secondes à Villedieu avant celui de Londres. Ainsi Buisson et Villedieu, cités quasi-jumelles, sont distantes quand même de neuf secondes pour le soleil.
Bien sûr, tout ceci est approximativement vrai, car la terre n’est pas tout à fait ronde et n’exécute pas une rotation sur elle-même par rapport au soleil en exactement et constamment vingt-quatre heures.
En résumé
Cette remise des pendules à l’heure est peut-être d’une précision helvétique pour les habitants de Villedieu qui entendent sonner l’horloge du beffroi à peu près trois fois par heure. Contrairement aux montres en panne qui sont à l’heure deux fois par jour, l’horloge n’y est presque jamais. Certains disent que c’est l’usure du temps malgré les efforts du garde... Je prétends qu’elle a décidé, un jour, de prendre sa liberté républicaine et de sonner l’heure qui lui plait, sans doute pour ne pas être confondue avec l’exactitude banale de l’angélus. Comme son cadran à la représentation numérique pleine de fantaisie imaginative, elle crée un temps inconstant mais constamment précoce. C’est une horloge « prévenante » pour retardataires invétérés.
Plus haut dans le présent numéro, est narrée l’installation d’un cadran solaire au beffroi de Buisson. L’auteur précise que l’heure indiquée par ce cadran avance de deux heures et neuf minutes sur l’heure légale, celle indiquée par l’horloge. Cette assertion a provoqué la réaction de T. d. C. - T. d. V., relecteur et lecteur presque assidu de La Gazette. Voici ce qu’il écrit.
L’heure de référence internationale est celle du méridien de Greenwich. Ce gros faubourg de Londres qui disposait d’un observatoire a été pris pour méridien d’origine en 1911. Ainsi est défini un « temps » fréquemment appelé « G.M.T. » pour « Greenwich Mean Time », soit temps moyen de Greenwich dont l’origine est midi. Il est donc midi G.M.T. à l’instant où le soleil est apparemment au plus haut dans le ciel sur tous les points d’une ligne imaginaire, en demi-cercle, reliant les pôles et passant par l’observatoire anglais.
La surface du globe est divisée géométriquement, et conventionnellement, en 360 degrés. Ainsi chaque méridien est exprimé par l’angle formé aux pôles par celui-ci et le méridien de Greenwich. Ce procédé permet de situer chaque point de la terre en longitude. Si l’on consulte la carte Michelin « 332 local, Drôme, Vaucluse », l’on constate que Buisson est situé par cinq degrés de longitude Est (la ligne verticale passant par Buisson est notée 5° au bas de la carte).
La sphère terrestre est également découpée en vingt-quatre fuseaux horaires comme la surface externe des quartiers d’une orange.
Buisson
Pour calculer l’écart de « temps solaire » entre Greenwich et Buisson, il convient d’établir l’équivalent en « temps » d’un degré de longitude et de le multiplier par cinq.
- La terre exécute une rotation sur elle-même par rapport au soleil en vingt-quatre heures de soixante minutes, elle tourne en mille quatre cent quarante minutes.
- Si par ailleurs le globe est divisé en 360°, chaque degré représente : 1440 divisé par 360, soit 4 minutes de « temps solaire ».
Buisson étant situé à cinq degrés de longitude Est, le soleil passe apparemment à son zénith à Buisson vingt minutes avant d’être au zénith de Greenwich.
Nous savons tous, et certains s’en plaignent, que l’heure légale est postérieure à l’heure G.M.T. de deux heures l’été et d’une heure l’hiver. La France est située dans le même fuseau horaire que Greenwich. Ainsi quand il est midi à nos montres l’été (heure légale), il est dix heures (solaire) à Greenwich et dix heures vingt minutes au cadran solaire du beffroi. C’est-à-dire que le cadran indiquera une heure quarante minutes de moins que l’horloge. L’hiver, quand le cadran de Buisson indiquera midi, il sera midi quarante à nos pendules.
Et Villedieu
La carte "3139 ET" de l’Institut Géographique National montre que le méridien de Villedieu est noté « 3 gd » au bas de la feuille. Vérifiez et vous verrez que Villedieu aussi possède son méridien officiel. C’est qu’en 1891, la République avait fixé un « découpage » cartographique du globe en quatre cents grades d’angles de longitude à partir du méridien passant par l’observatoire de Paris.
Ainsi pour établir l’écart de « temps solaire » entre Villedieu et Paris, il faut rechercher l’équivalent en temps d’un grade puis le multiplier par trois. La terre exécutant une rotation en mille quatre cent quarante minutes, elle tourne en quatre-vingt six mille secondes. Chaque grade représente un laps de temps de : 86 400 divisé par 400, soit 216 secondes, soit trois minutes et trente-six secondes. Villedieu est donc à dix minutes et quarante-huit secondes solaires de Paris. En d’autres termes, on peu dire que la « culmination » du soleil dans le ciel du lotissement Gustave Tardieu au Connier se produit dix minutes et quarante-huit secondes avant sa « culmination » dans le ciel du jardin de l’observatoire de Paris.
Et Greenwich
Si l’on sait, en consultant les livres, que le méridien de Paris, référence en grades, est situé à neuf minutes et vingt et une secondes de celui de Greenwich, référence en degrés, on peut conclure que le midi solaire intervient vingt minutes et neuf secondes à Villedieu avant celui de Londres. Ainsi Buisson et Villedieu, cités quasi-jumelles, sont distantes quand même de neuf secondes pour le soleil.
Bien sûr, tout ceci est approximativement vrai, car la terre n’est pas tout à fait ronde et n’exécute pas une rotation sur elle-même par rapport au soleil en exactement et constamment vingt-quatre heures.
En résumé
Cette remise des pendules à l’heure est peut-être d’une précision helvétique pour les habitants de Villedieu qui entendent sonner l’horloge du beffroi à peu près trois fois par heure. Contrairement aux montres en panne qui sont à l’heure deux fois par jour, l’horloge n’y est presque jamais. Certains disent que c’est l’usure du temps malgré les efforts du garde... Je prétends qu’elle a décidé, un jour, de prendre sa liberté républicaine et de sonner l’heure qui lui plait, sans doute pour ne pas être confondue avec l’exactitude banale de l’angélus. Comme son cadran à la représentation numérique pleine de fantaisie imaginative, elle crée un temps inconstant mais constamment précoce. C’est une horloge « prévenante » pour retardataires invétérés.
Jean Marie Dusuzeau

>>> Cliquez ici
pour apprendre à
construire votre
cadran solaire
personnel...
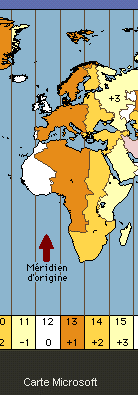
>>> Cliquez là
pour découvrir
différentes méthodes
de détermination de
midi, heure solaire...

Les Baud figuiers du Palis
Majo et les figuiers
Depuis mon enfance, en Algérie, le figuier fait partie des arbres qui me sont indispensables ; peut-être parce qu'il contribue à l'histoire de ma famille.
Vers la fin du XIXe siècle, mon grand-père retourna dans sa Calabre natale. A son retour, comme il était interdit de passer des végétaux d'un pays à l'autre, il prit dans la propriété de ses parents une branche de figuier qu'il tailla en canne. Pendant tout le voyage de retour vers l'Algérie, il trempa sa canne toutes les nuits dans un seau d'eau. Arrivé à Guelma, il planta sa canne à l'entrée de l'orangeraie qui entourait la maison qu'il était en train de construire pour sa femme et ses huit enfants. Quelques années plus tard, enfants et petits-enfants s'amusèrent tous dans les branches d'un arbre majestueux qui, en plus, les régalait de fruits succulents. Lorsque l'un d'entre nous s'éloignait, il emportait avec lui une canne de figuier et la replantait avec amour dans son nouveau lieu de vie. Ainsi le vieux figuier a-t-il des rejetons à Aix en Provence, à Propriano, à Lézan, à Ribaute les Tavernes...
Il n'y en a pas encore à Villedieu, pourtant, dans notre jardin, deux figuiers nous régalent de leurs fruits en juillet et septembre. Aussi, cette année, j'irai à Lézan couper une canne et la replanterai pour que mes petits-enfants puissent savourer les fruits de leur arrière arrière arrière grand-père.
Toute cette histoire explique pourquoi je considère, avec tous les passionnés d'arbres et plantes méditerranéens, Pierre Baud comme le plus grand spécialiste des figuiers.
Pierre Baud et les figuiers
Pierre Baud exploite trois hectares et demi de plants de figuiers au Palis et les trois cents variétés qu'il possède pourraient être considérées comme collection nationale. C'est son père Lucien qui implante en 1955 un verger avec figuiers et autres arbres fruitiers pour la commercialisation de fruits, mais en 1956 les figuiers gèlent. L'année d'après ils repartent de la souche et en 1963 l'hiver rigoureux détruit à nouveau les arbres. Il replante alors figuiers et peupliers en culture de pleine terre car la demande des agriculteurs "pieds noirs" est très forte.
Pierre Baud reprend l'exploitation après des études spécialisées en arboriculture et quelques années d'enseignement au lycée agricole de Saint Paul Trois Châteaux. Il lui faut trouver de nouveaux débouchés pour ses trois hectares et demi. Il se lance alors dans la recherche des multiples variétés de figuiers et choisit d'en commercialiser les plants. Sa notoriété dépasse vite les limites du département et sa production aujourd'hui s'écoule pour 90 % en vente de plants en gros et 5 % au détail ; il arrive même à expédier des figuiers en Italie, pays du figuier !
Alors que sa collection présente plus de 300 variétés sur plus de 1 000 dans le monde, il en cultive essentiellement 12 pour le marché de gros et 35 pour les nombreux amateurs. Sa recherche de nouvelles variétés l'amène à parcourir le bassin méditerranéen. Ainsi a-t-il découvert dans les Pouilles, au sud extrême de l'Italie, plus de 80 variétés. Il en rapportera 10 parmi les plus intéressantes et peut-être n'en sélectionnera-t-il que deux ou trois.
Le figuier
Pierre Baud est intarissable lorsqu'il parle "figuier". Le figuier est un des arbres fruitiers les plus anciens, sa trace remonte à 8 000 ans. A l'origine c'est lui qui fut représenté comme arbre aux fruits tentateurs à la curiosité d'Eve dans le Jardin d'Eden. Il est indissociable du paysage méditerranéen, il en est le symbole de la fertilité, de l'hospitalité et de la convivialité. Il peut pousser dans les endroits les plus difficiles. Pour vous en convaincre, cherchez le figuier qui pousse dans un mur entre Sarrians et Vacqueyras. Depuis 100 ans les racines, le tronc et les pierres s'enlacent et s’entremêlent. Admirez le vite car le propriétaire envisage de le détruire dans peu de temps pour préserver son mur. Pourtant cette union pierre et arbre résiste au temps.
La culture du figuier se pratique essentiellement en pleine terre, sauf exception : monsieur de la Quintinie, jardinier à Versailles, fit pousser 700 figuiers en pots afin de pouvoir garnir la table de Louis XIV de fruits en pleine maturité durant six mois.
Le figuier est soit unifère : une récolte en automne, soit bifère : une récolte en fin de printemps et une en fin d'été. Les figues fleurs qui mûrissent au mois de juillet sur le bois de l'année précédente assurent, selon les variétés et les années, de 10 à 50 % de la récolte. Elles sont alors parthénocarpiques : elles mûrissent sans avoir besoin de pollinisation. Les figues d'automne sont appelées secondes et constituent le plus gros de la production. La récolte peut s'étaler du 1er août aux premières gelées selon les variétés. Pour être pollinisées il faut l'intervention du blastophage, petit insecte de la famille des diptères. L'arbre résiste jusqu'à moins 12°C mais, après avoir gelé, il peut repartir de la souche. Il a besoin d'arrosages copieux et espacés. Il se multiplie facilement par marcottage ou par bouturage. En raison de son bois creux et tendre, de sa faible aptitude à cicatriser, la taille devra être effectuée au printemps à la montée de la sève. Si les variétés unifères peuvent être taillées sévèrement, il faudra, sur les bifères, se contenter de limiter la hauteur et effectuer un petit éclaircissage.
Le livre du figuier
Pierre Baud, avec Raoul Reichratch du restaurant Les Grands Prés à Roaix et Reinhard Rosenau, photographe à Malaucène, mettent la touche finale à l'élaboration de leur livre intitulé "Figues". Ils ont fondé pour cela leur maison d'édition "Target". La maquette que nous avons pu admirer nous a séduites, la mise en page est claire, 25 variétés y sont décrites. Les recettes sont illustrées de photos de grande qualité. Jusqu'au 10 mars, une souscription permet de l'acheter au prix de 39,75 euros. Après sa parution, le prix public sera de 45 euros. Un beau cadeau en perspective. Des bons de souscription sont disponibles au café du Centre.
Depuis mon enfance, en Algérie, le figuier fait partie des arbres qui me sont indispensables ; peut-être parce qu'il contribue à l'histoire de ma famille.
Vers la fin du XIXe siècle, mon grand-père retourna dans sa Calabre natale. A son retour, comme il était interdit de passer des végétaux d'un pays à l'autre, il prit dans la propriété de ses parents une branche de figuier qu'il tailla en canne. Pendant tout le voyage de retour vers l'Algérie, il trempa sa canne toutes les nuits dans un seau d'eau. Arrivé à Guelma, il planta sa canne à l'entrée de l'orangeraie qui entourait la maison qu'il était en train de construire pour sa femme et ses huit enfants. Quelques années plus tard, enfants et petits-enfants s'amusèrent tous dans les branches d'un arbre majestueux qui, en plus, les régalait de fruits succulents. Lorsque l'un d'entre nous s'éloignait, il emportait avec lui une canne de figuier et la replantait avec amour dans son nouveau lieu de vie. Ainsi le vieux figuier a-t-il des rejetons à Aix en Provence, à Propriano, à Lézan, à Ribaute les Tavernes...
Il n'y en a pas encore à Villedieu, pourtant, dans notre jardin, deux figuiers nous régalent de leurs fruits en juillet et septembre. Aussi, cette année, j'irai à Lézan couper une canne et la replanterai pour que mes petits-enfants puissent savourer les fruits de leur arrière arrière arrière grand-père.
Toute cette histoire explique pourquoi je considère, avec tous les passionnés d'arbres et plantes méditerranéens, Pierre Baud comme le plus grand spécialiste des figuiers.
Pierre Baud et les figuiers
Pierre Baud exploite trois hectares et demi de plants de figuiers au Palis et les trois cents variétés qu'il possède pourraient être considérées comme collection nationale. C'est son père Lucien qui implante en 1955 un verger avec figuiers et autres arbres fruitiers pour la commercialisation de fruits, mais en 1956 les figuiers gèlent. L'année d'après ils repartent de la souche et en 1963 l'hiver rigoureux détruit à nouveau les arbres. Il replante alors figuiers et peupliers en culture de pleine terre car la demande des agriculteurs "pieds noirs" est très forte.
Pierre Baud reprend l'exploitation après des études spécialisées en arboriculture et quelques années d'enseignement au lycée agricole de Saint Paul Trois Châteaux. Il lui faut trouver de nouveaux débouchés pour ses trois hectares et demi. Il se lance alors dans la recherche des multiples variétés de figuiers et choisit d'en commercialiser les plants. Sa notoriété dépasse vite les limites du département et sa production aujourd'hui s'écoule pour 90 % en vente de plants en gros et 5 % au détail ; il arrive même à expédier des figuiers en Italie, pays du figuier !
Alors que sa collection présente plus de 300 variétés sur plus de 1 000 dans le monde, il en cultive essentiellement 12 pour le marché de gros et 35 pour les nombreux amateurs. Sa recherche de nouvelles variétés l'amène à parcourir le bassin méditerranéen. Ainsi a-t-il découvert dans les Pouilles, au sud extrême de l'Italie, plus de 80 variétés. Il en rapportera 10 parmi les plus intéressantes et peut-être n'en sélectionnera-t-il que deux ou trois.
Le figuier
Pierre Baud est intarissable lorsqu'il parle "figuier". Le figuier est un des arbres fruitiers les plus anciens, sa trace remonte à 8 000 ans. A l'origine c'est lui qui fut représenté comme arbre aux fruits tentateurs à la curiosité d'Eve dans le Jardin d'Eden. Il est indissociable du paysage méditerranéen, il en est le symbole de la fertilité, de l'hospitalité et de la convivialité. Il peut pousser dans les endroits les plus difficiles. Pour vous en convaincre, cherchez le figuier qui pousse dans un mur entre Sarrians et Vacqueyras. Depuis 100 ans les racines, le tronc et les pierres s'enlacent et s’entremêlent. Admirez le vite car le propriétaire envisage de le détruire dans peu de temps pour préserver son mur. Pourtant cette union pierre et arbre résiste au temps.
La culture du figuier se pratique essentiellement en pleine terre, sauf exception : monsieur de la Quintinie, jardinier à Versailles, fit pousser 700 figuiers en pots afin de pouvoir garnir la table de Louis XIV de fruits en pleine maturité durant six mois.
Le figuier est soit unifère : une récolte en automne, soit bifère : une récolte en fin de printemps et une en fin d'été. Les figues fleurs qui mûrissent au mois de juillet sur le bois de l'année précédente assurent, selon les variétés et les années, de 10 à 50 % de la récolte. Elles sont alors parthénocarpiques : elles mûrissent sans avoir besoin de pollinisation. Les figues d'automne sont appelées secondes et constituent le plus gros de la production. La récolte peut s'étaler du 1er août aux premières gelées selon les variétés. Pour être pollinisées il faut l'intervention du blastophage, petit insecte de la famille des diptères. L'arbre résiste jusqu'à moins 12°C mais, après avoir gelé, il peut repartir de la souche. Il a besoin d'arrosages copieux et espacés. Il se multiplie facilement par marcottage ou par bouturage. En raison de son bois creux et tendre, de sa faible aptitude à cicatriser, la taille devra être effectuée au printemps à la montée de la sève. Si les variétés unifères peuvent être taillées sévèrement, il faudra, sur les bifères, se contenter de limiter la hauteur et effectuer un petit éclaircissage.
Le livre du figuier
Pierre Baud, avec Raoul Reichratch du restaurant Les Grands Prés à Roaix et Reinhard Rosenau, photographe à Malaucène, mettent la touche finale à l'élaboration de leur livre intitulé "Figues". Ils ont fondé pour cela leur maison d'édition "Target". La maquette que nous avons pu admirer nous a séduites, la mise en page est claire, 25 variétés y sont décrites. Les recettes sont illustrées de photos de grande qualité. Jusqu'au 10 mars, une souscription permet de l'acheter au prix de 39,75 euros. Après sa parution, le prix public sera de 45 euros. Un beau cadeau en perspective. Des bons de souscription sont disponibles au café du Centre.
Annette Gros et Majo Raffin
|
Une recette du livre : Crostini de figues et chèvre mi-frais...
- Tranches de pain de campagne (1/2 cm d’épaisseur). - Fromages de chèvre mi-sec. - Figues (de préférence noires pour la couleur). - Huile d’olive. - Ail, sel, thym. Faire dorer les tranches de pain sous le gril. Les sortir et les frotter encore chaudes avec la gousse d’ail. Arroser d’un filet d’huile d’olive. Couper le fromage en lamelles et les figues en fines tranches. Les disposer sur la tartine en les intercalant. Arroser de nouveau d’un trait d’huile d’olive. Saupoudrer de thym (frais de préférence) et de fleur de sel. Refaire gratiner au four et servir chaud. |


Pierre Baud
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Le jaseur polaire du Mont Serein (2,5°C)
Le jeu de mots est tentant, on pourrait dire que cet oiseau est un serin du Ventoux venu des îles (Canaries).
« Rien à voir avec la choucroute » comme disent les Alsaciens, c’est un oiseau polaire. S’il figure dans La Gazette, c’est pour le plaisir. Le metteur en page du numéro 30 l’a trouvé beau. Il rend grâce à François Dénéréaz qui lui a fourni la photo.
Le Jaseur pourrait illustrer le froid, il pourrait illustrer le printemps, mais s’il n’est pas illustre, sauf peut-être chez les ornithologues, il suffit à illustrer ce coin de périodique.
Puissions-nous l’entendre jaser (si son ramage ressemble à...) lors d’un « boeuf » sur la place, un beau soir de printemps, s’il décide de passer par le village en quittant sa station de sports d’hiver pour émigrer vers quelque coin de l’Arctique, pendant que les hirondelles venues d’Afrique viendront ici nous manger les moucherons dans les assiettes !
« Rien à voir avec la choucroute » comme disent les Alsaciens, c’est un oiseau polaire. S’il figure dans La Gazette, c’est pour le plaisir. Le metteur en page du numéro 30 l’a trouvé beau. Il rend grâce à François Dénéréaz qui lui a fourni la photo.
Le Jaseur pourrait illustrer le froid, il pourrait illustrer le printemps, mais s’il n’est pas illustre, sauf peut-être chez les ornithologues, il suffit à illustrer ce coin de périodique.
Puissions-nous l’entendre jaser (si son ramage ressemble à...) lors d’un « boeuf » sur la place, un beau soir de printemps, s’il décide de passer par le village en quittant sa station de sports d’hiver pour émigrer vers quelque coin de l’Arctique, pendant que les hirondelles venues d’Afrique viendront ici nous manger les moucherons dans les assiettes !
Jean-Marie Dusuzeau

Le Jaseur...
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
La première photo ci-contre aurait pu être une photo mystère ou alors on aurait pu jouer au jeu des sept erreurs ou encore simplement poser la question suivante : « qu’y a-t-il à voir sur cette photo ? » Cette dernière question aurait été particulièrement vicieuse puisque ce qu’il y a à voir c’est un manque, un trou, dans un paysage si familier (et si beau il faut bien le dire) que peut-être notre œil n’y voit plus grand chose.
Un trou ? Celui causé par la chute d’un pin le mardi 1er mars (-0,2°C), jour de vent violent qui a aussi provoqué la chute d’un arbre près de chez Garagnon et d’un poteau téléphonique au Palis. Jean-Louis Vollot et Gilles Eysseric ont débité l’arbre et dégagé la route. Ce micro-événement est l’occasion de nous rappeler que nous n’étions plus habitués aux longues périodes de mistral de cet hiver, associées à des températures un peu frisquettes. Il aurait pu faire l’objet d’une brève mais l’article sera un peu plus long car ces pins ont une histoire.
On peut en compter neuf. Le premier, le plus proche du village est tout chétif. Les autres sont assez vigoureux. En fait, le remblai qui constitue le talus est essentiellement composé de gravats qui datent de l’époque où la route s’est agrandie et où le virage a pris sa forme actuelle. Les premiers arbres en sortant du village en patissent.
Ils devraient y en avoir onze pour qu’ils soient au complet mais l’un était déjà mort, séché sur place probablement après qu’un coup de vent, déjà, ait cassé quelques racines.
Onze ce pourrait être une équipe de foot mais non : il s’agissait du conseil municipal de 1977 qui comprenait onze membres. Chaque conseiller nouvellement élu a offert et planté son arbre. Le garde champêtre, Maxime Roux, avait préparé les trous. Il était aller chercher de la terre sur le terrain actuel du lotissement qui était un terrain vague, près du cabanon disparu de Chambon et de la terre de bruyère à Uchaux. Les arbres venaient de la pépinière Chauvin de Saint Pantaléon les Vignes.
L’idée de cette plantation serait lié au fait que l’année 1977 avait été déclarée « année de l’arbre ».
Les avis divergent sur l’ordre de la plantation. Pour les uns, les arbres ont été plantés par ordre d’âge des conseillers, du plus jeune au plus âgé en partant du village. A cette époque, la liste gagnante, dite « Liste républicaine et démocratique, et d’intérêt local » était à forte tonalité d’« union de la gauche » avec plusieurs membres des partis communiste et socialiste.
Elle était composé par ordre d’âge de Jacky Nancy (27 ans, le 8e sur la photo en partant de la gauche), Roger Tortel alias le « Zé » à qui La Gazette avait attribué un Renault express gris, dans un précédent numéro, alors qu’il possède un berlingot, (28 ans, le 7e), Alain Martin (32 ans, le 12e), Micheline Grangeon (la seule femme, 33 ans, la 6e), Michel Lazard (34 ans, le 1er), Henri Favier (42 ans, le 11e), André Tardieu (1er adjoint, 45 ans, le 4e sur la photo), Raymond Joubert (48 ans, le 9e), Pierre Fontana (2e adjoint, 51 ans, le 5e sur la photo), Maxime Arrighi (52 ans, le 10e), Wilfrid Brieux (maire, 71 ans, le 2e). Il manque donc les arbres de Roger Tortel et Alain Martin. Jacky Nancy ne trouve pas le sien très flamboyant.
Pour les autres, l’ordre choisi plaçait en tête le maire (Brieux) puis ses adjoints (Tardieu puis Fontana) puis l’ordre d’âge. Une variante de cette version propose Brieux puis Tardieu puis l’ordre d’âge.
Si l’arbre du maire est le plus proche de Villedieu les manquants sont ceux de Tardieu et d’Arrighi ou de Fontana... Si l’arbre du maire est le plus éloigné, les manquants sont à nouveau ceux des plus jeunes.
Maxime Roux voulait son arbre aussi mais la DDE qui n’était pas très chaude pour cette plantation avait exigé que les arbres soient plantés plus proches que prévu et en a refusé un douzième. Il avait acheté un cèdre qu’il a finalement planté sur la dernière banquette du parking et que tout le monde peut voir aujourd’hui.
Cette plantation avait dû susciter quelques critiques et commentaires dans le village juste après une élection qui avait vu trois listes s’affronter (deux listes et demie car l’une d’entre elle était incomplète). En effet, dans le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 3 juin 1977, on peut lire : « Il est rappelé que les pins qui sont implantés à la sortie du village sur la route de Roaix au nombre de onze ont été offerts gracieusement par chaque conseiller ».
Un trou ? Celui causé par la chute d’un pin le mardi 1er mars (-0,2°C), jour de vent violent qui a aussi provoqué la chute d’un arbre près de chez Garagnon et d’un poteau téléphonique au Palis. Jean-Louis Vollot et Gilles Eysseric ont débité l’arbre et dégagé la route. Ce micro-événement est l’occasion de nous rappeler que nous n’étions plus habitués aux longues périodes de mistral de cet hiver, associées à des températures un peu frisquettes. Il aurait pu faire l’objet d’une brève mais l’article sera un peu plus long car ces pins ont une histoire.
On peut en compter neuf. Le premier, le plus proche du village est tout chétif. Les autres sont assez vigoureux. En fait, le remblai qui constitue le talus est essentiellement composé de gravats qui datent de l’époque où la route s’est agrandie et où le virage a pris sa forme actuelle. Les premiers arbres en sortant du village en patissent.
Ils devraient y en avoir onze pour qu’ils soient au complet mais l’un était déjà mort, séché sur place probablement après qu’un coup de vent, déjà, ait cassé quelques racines.
Onze ce pourrait être une équipe de foot mais non : il s’agissait du conseil municipal de 1977 qui comprenait onze membres. Chaque conseiller nouvellement élu a offert et planté son arbre. Le garde champêtre, Maxime Roux, avait préparé les trous. Il était aller chercher de la terre sur le terrain actuel du lotissement qui était un terrain vague, près du cabanon disparu de Chambon et de la terre de bruyère à Uchaux. Les arbres venaient de la pépinière Chauvin de Saint Pantaléon les Vignes.
L’idée de cette plantation serait lié au fait que l’année 1977 avait été déclarée « année de l’arbre ».
Les avis divergent sur l’ordre de la plantation. Pour les uns, les arbres ont été plantés par ordre d’âge des conseillers, du plus jeune au plus âgé en partant du village. A cette époque, la liste gagnante, dite « Liste républicaine et démocratique, et d’intérêt local » était à forte tonalité d’« union de la gauche » avec plusieurs membres des partis communiste et socialiste.
Elle était composé par ordre d’âge de Jacky Nancy (27 ans, le 8e sur la photo en partant de la gauche), Roger Tortel alias le « Zé » à qui La Gazette avait attribué un Renault express gris, dans un précédent numéro, alors qu’il possède un berlingot, (28 ans, le 7e), Alain Martin (32 ans, le 12e), Micheline Grangeon (la seule femme, 33 ans, la 6e), Michel Lazard (34 ans, le 1er), Henri Favier (42 ans, le 11e), André Tardieu (1er adjoint, 45 ans, le 4e sur la photo), Raymond Joubert (48 ans, le 9e), Pierre Fontana (2e adjoint, 51 ans, le 5e sur la photo), Maxime Arrighi (52 ans, le 10e), Wilfrid Brieux (maire, 71 ans, le 2e). Il manque donc les arbres de Roger Tortel et Alain Martin. Jacky Nancy ne trouve pas le sien très flamboyant.
Pour les autres, l’ordre choisi plaçait en tête le maire (Brieux) puis ses adjoints (Tardieu puis Fontana) puis l’ordre d’âge. Une variante de cette version propose Brieux puis Tardieu puis l’ordre d’âge.
Si l’arbre du maire est le plus proche de Villedieu les manquants sont ceux de Tardieu et d’Arrighi ou de Fontana... Si l’arbre du maire est le plus éloigné, les manquants sont à nouveau ceux des plus jeunes.
Maxime Roux voulait son arbre aussi mais la DDE qui n’était pas très chaude pour cette plantation avait exigé que les arbres soient plantés plus proches que prévu et en a refusé un douzième. Il avait acheté un cèdre qu’il a finalement planté sur la dernière banquette du parking et que tout le monde peut voir aujourd’hui.
Cette plantation avait dû susciter quelques critiques et commentaires dans le village juste après une élection qui avait vu trois listes s’affronter (deux listes et demie car l’une d’entre elle était incomplète). En effet, dans le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 3 juin 1977, on peut lire : « Il est rappelé que les pins qui sont implantés à la sortie du village sur la route de Roaix au nombre de onze ont été offerts gracieusement par chaque conseiller ».
Yves Tardieu


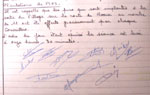
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Un beau matin Mélu se rend à son pigeonnier. Quelle n’est pas sa surprise de trouver un intrus en ce lieu. Un compagnon de plume était là et courtise déjà la belle pigeonne maîtresse de céans.
Curieux, Mélu s’approche et aperçoit dans les plumes et le duvet du bel inconnu un objet bizarre. Il attrape l’animal et découvre aux pattes de celui-ci, deux bagues. Un pigeon voyageur vient de faire étape dans son pigeonnier.
Intrigué, avec l’aide de sa voisine il déchiffre le message qui n’est autre que le nom et le numéro de téléphone d’une personne habitant les Pyrénées-orientales.
Il appelle donc ce monsieur qui possède bien un élevage de pigeons dans ce lointain département et avait noté la disparition d’un de ses locataires depuis quelques mois.
Devant la distance à parcourir celui-ci renonce à son pigeon et le confie à Mélu qui en devient l’heureux propriétaire. Cette personne promet de passer rendre visite à Mélu et à son pigeon s’il le peut dans l’été.
En attendant, les deux tourter…, non, pigeons ont convolé en justes noces et maintenant sont parents de deux pigeonneaux. Le beau voyageur est allé rejoindre la volière de son nouveau propriétaire mais peut-être rêve-t-il déjà à de belles envolées et à de nouveaux cieux à explorer.
Curieux, Mélu s’approche et aperçoit dans les plumes et le duvet du bel inconnu un objet bizarre. Il attrape l’animal et découvre aux pattes de celui-ci, deux bagues. Un pigeon voyageur vient de faire étape dans son pigeonnier.
Intrigué, avec l’aide de sa voisine il déchiffre le message qui n’est autre que le nom et le numéro de téléphone d’une personne habitant les Pyrénées-orientales.
Il appelle donc ce monsieur qui possède bien un élevage de pigeons dans ce lointain département et avait noté la disparition d’un de ses locataires depuis quelques mois.
Devant la distance à parcourir celui-ci renonce à son pigeon et le confie à Mélu qui en devient l’heureux propriétaire. Cette personne promet de passer rendre visite à Mélu et à son pigeon s’il le peut dans l’été.
En attendant, les deux tourter…, non, pigeons ont convolé en justes noces et maintenant sont parents de deux pigeonneaux. Le beau voyageur est allé rejoindre la volière de son nouveau propriétaire mais peut-être rêve-t-il déjà à de belles envolées et à de nouveaux cieux à explorer.
Armelle Dénéréaz


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Marthe Bonnet
Dans l’article sur les pins du conseil municipal de 1977, j’ai oublié un personnage de la photo, à mon grand regret. En fait, la légende de la photo prévue initialement a été remplacée par un paragraphe dans l’article et la secrétaire de mairie, qui n’était pas élue, a disparu de l’énumération des conseillers.

Marthe Bonnet était malgré tout présente grâce à l’extrait du registre des délibérations municipales que nous avons publié. Ses comptes rendus détaillés sont rédigés avec une écriture très lisible et dans un style très clair, sans aucune faute ni rature.
Yves Tardieu
Encore une historie de Drômois... Celle-là n’est pas une rumeur, elle est vraie. Du 14 au 28 mai dernier, on a vu circuler de nuit dans la commune une camionnette immatriculée 26. Sur les chemins vicinaux et aux abords du village, elle s’arrêtait et deux individus en sortaient, équipés d’une sorte d’antenne comme pour la télé, qu’il tendaient alentour. Au son d’un « bip, bip, bip » tout de même assez discret, ils tentaient de repérer les déplacements d’une petite bestiole volante répondant au doux nom de minioptère de Schreibers (mini, pour les intimes).
C’est une chauve-souris assez courante dans tout le sud de l’Europe. De taille moyenne, front bombé, pelage gris-brun, museau très court, plutôt mignonne (enfin, ça peut se discuter...). Elle vit en colonies dans des grottes naturelles situées dans les massifs calcaires de nos régions. Peu de temps après le coucher du soleil, elle sort chasser des papillons et des moustiques, d’un vol rapide qui rappelle celui des hirondelles et des martinets.
La campagne en cours, menée par le centre ornithologique Rhône-Alpes et son antenne de la Drôme, avait pour but de mieux connaître les déplacements nocturnes de l’espèce, liés à sa recherche de nourriture. Les spécialistes ont donc suivi par radio-pistage des chauves-souris de Schreibers sur lesquelles ils avaient préalablement fixé un mini-émetteur (ce qui en soi est un exploit : je n’ai pas assisté à celui-là, mais pour avoir aidé un jour un spécialiste à poser un émetteur sur une autre espèce de chauve-souris cavernicole, je peux vous assurer qu’il faut avoir des réflexes rapides et des nerfs d’acier pour capturer un animal alors que toute la colonie crie et fonce dans toutes les directions alentour).
Les biologistes du centre ornithologique qui ont sillonné la commune s’intéressaient particulièrement aux déplacements nocturnes de chauves-souris repérées dans des cavernes naturelles près de Suze-la-Rousse. Ils ont donc prospecté dans un rayon d’environ 30 kilomètres alentour, ce qui correspond à la zone normale de recherche de nourriture de cette espèce. Une zone tout de même assez étendue pour une petite bête qui ne fait que 15 à 18 grammes. Il n’est sans doute pas impossible qu’il y ait d’autres colonies de Minoptères de Shreibers plus proches de nous dans la région, car en fait cette espèce est assez répandue.
Au village, on sait qu’on voit souvent des chauve-souris, notamment les nuits de printemps et d’été. Ce ne sont probablement pas toutes des mini, il y a sans doute d’autres espèces communes comme le grand murin dans nos cieux. Mais leur attitude en vol est caractéristique : les chauve-souris se suivent en groupe et passent en vols rapides dans les rues et les jardins, en chasse d’insectes à quelques mètres au dessus du sol. Elles contournent toujours les sources lumineuses en accélérant ; c’est un réflexe chez elles. Lorsqu’elles découvrent tout à coup une source de lumière vive, elles fuient car elles recherchent la noirceur, donc elles accélèrent. Pour savoir où est l’obstacle (un mur, aussi bien qu’un lampadaire) elles disposent d’un merveilleux moyen d’écholocation naturel : elles émettent des ultra-sons et analysent l’écho pour savoir où elles se situent dans l’espace. C’est un principe que le sonar des marins n’a fait qu’imiter.
Pourquoi devrait-on se préoccuper des chauve-souris, au risque de troubler le sommeil des Villadéens, quelques nuits tous les cinq ou six ans ?
Ceux et celles qui vivent à la campagne savent à quel point l’équilibre entre les animaux est important, à quel point, par exemple, il nous faut des oiseaux et des chauve souris pour contrôler les populations d’insectes volants. Ils savent à quel point la santé générale de notre environnement naturel – ce qu’il en reste, qui est une richesse – en dépend totalement. Mais, pour répondre à la question, on peut simplement penser à la beauté du vivant et j’ai le goût de citer un grand et sage homme, Charles Darwin, qui terminait ainsi son fameux livre "L’Origine des espèces", en 1859 : « Tandis que la planète poursuivait ses révolutions selon la loi immuable de la gravitation, une infinité de formes merveilleuses et étonnantes, nées d’un commencement très simple, n’ont cessé de se développer et se développent encore ».
C’est une chauve-souris assez courante dans tout le sud de l’Europe. De taille moyenne, front bombé, pelage gris-brun, museau très court, plutôt mignonne (enfin, ça peut se discuter...). Elle vit en colonies dans des grottes naturelles situées dans les massifs calcaires de nos régions. Peu de temps après le coucher du soleil, elle sort chasser des papillons et des moustiques, d’un vol rapide qui rappelle celui des hirondelles et des martinets.
La campagne en cours, menée par le centre ornithologique Rhône-Alpes et son antenne de la Drôme, avait pour but de mieux connaître les déplacements nocturnes de l’espèce, liés à sa recherche de nourriture. Les spécialistes ont donc suivi par radio-pistage des chauves-souris de Schreibers sur lesquelles ils avaient préalablement fixé un mini-émetteur (ce qui en soi est un exploit : je n’ai pas assisté à celui-là, mais pour avoir aidé un jour un spécialiste à poser un émetteur sur une autre espèce de chauve-souris cavernicole, je peux vous assurer qu’il faut avoir des réflexes rapides et des nerfs d’acier pour capturer un animal alors que toute la colonie crie et fonce dans toutes les directions alentour).
Les biologistes du centre ornithologique qui ont sillonné la commune s’intéressaient particulièrement aux déplacements nocturnes de chauves-souris repérées dans des cavernes naturelles près de Suze-la-Rousse. Ils ont donc prospecté dans un rayon d’environ 30 kilomètres alentour, ce qui correspond à la zone normale de recherche de nourriture de cette espèce. Une zone tout de même assez étendue pour une petite bête qui ne fait que 15 à 18 grammes. Il n’est sans doute pas impossible qu’il y ait d’autres colonies de Minoptères de Shreibers plus proches de nous dans la région, car en fait cette espèce est assez répandue.
Au village, on sait qu’on voit souvent des chauve-souris, notamment les nuits de printemps et d’été. Ce ne sont probablement pas toutes des mini, il y a sans doute d’autres espèces communes comme le grand murin dans nos cieux. Mais leur attitude en vol est caractéristique : les chauve-souris se suivent en groupe et passent en vols rapides dans les rues et les jardins, en chasse d’insectes à quelques mètres au dessus du sol. Elles contournent toujours les sources lumineuses en accélérant ; c’est un réflexe chez elles. Lorsqu’elles découvrent tout à coup une source de lumière vive, elles fuient car elles recherchent la noirceur, donc elles accélèrent. Pour savoir où est l’obstacle (un mur, aussi bien qu’un lampadaire) elles disposent d’un merveilleux moyen d’écholocation naturel : elles émettent des ultra-sons et analysent l’écho pour savoir où elles se situent dans l’espace. C’est un principe que le sonar des marins n’a fait qu’imiter.
Pourquoi devrait-on se préoccuper des chauve-souris, au risque de troubler le sommeil des Villadéens, quelques nuits tous les cinq ou six ans ?
Ceux et celles qui vivent à la campagne savent à quel point l’équilibre entre les animaux est important, à quel point, par exemple, il nous faut des oiseaux et des chauve souris pour contrôler les populations d’insectes volants. Ils savent à quel point la santé générale de notre environnement naturel – ce qu’il en reste, qui est une richesse – en dépend totalement. Mais, pour répondre à la question, on peut simplement penser à la beauté du vivant et j’ai le goût de citer un grand et sage homme, Charles Darwin, qui terminait ainsi son fameux livre "L’Origine des espèces", en 1859 : « Tandis que la planète poursuivait ses révolutions selon la loi immuable de la gravitation, une infinité de formes merveilleuses et étonnantes, nées d’un commencement très simple, n’ont cessé de se développer et se développent encore ».
Jean-Pierre Rogel
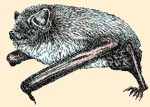
Dessin de
Jeane Montano-Meunier,
extrait de "Inventaire de
la faune de France",
Nathan-MNHN,
Paris, 1992...
Cliquez sur le dessin
pour l'agrandir
L'ambroisie
Gare aux allergies ! De la mi-août au début octobre, un nouvel envahisseur de nos champs et de nos bords de route est à l’œuvre, c’est l’ambroisie. Cette plante annuelle herbacée libère son pollen dans le vent, ce qui entraîne des symptômes chez les personnes sensibles : yeux gonflés, yeux qui coulent, c’est la rhinite allergique ou « rhume des foins » dans toute sa splendeur. Parfois, le pollen peut déclencher aussi de l’asthme. De plus en plus de personnes semblent souffrir de ces problèmes de santé, et bien entendu cette plante n’est pas la seule responsable, mais il serait bon de savoir la reconnaître et l’éviter – voire s’en débarrasser – car ce nouveau « polluant biologique » semble implanté pour de bon dans notre région. Et on en a aperçu dans des fossés de bord de routes de la commune, ce qui signifie qu’elle est présente sur notre territoire, sans toutefois qu’on puisse préciser les « zones rouges » plus affectées (elle se retrouve surtout dans les bords de friche et sur les terres remuées).
L’ambroisie à feuilles d’armoise est originaire des prairies de l’Amérique du nord. Comment est-elle parvenue chez nous ? On se perd en hypothèses. Cela va des semences de légumineuses importées qui auraient été contaminées, à la pharmacie personnelle de curistes américains fréquentant les villes thermales. On accuse le fourrage des chevaux de l’armée américains pendant la première guerre mondiale : truffé de graines d’ambroisie, il se serait répandu dans notre environnement. Quoiqu’il en soit, l’ambroisie est arrivée plus tôt en Europe, il y a au moins deux siècles et depuis, elle s’étend partout.
Ce n’est que depuis peu qu’on a compris son rôle dans les allergies, cependant : en 1966, une première recherche sur les allergies dans la région de Lyon la met en cause. En 2004, on la signale dans 64 départements français. En assez forte concentration dans la région Rhône-Alpes, cette « plante envahissante » fait depuis peu l’objet d’arrêtés d’éradication dans plusieurs départements, dont la Drôme et le Vaucluse. C’est donc devenu un enjeu de santé publique.
La méthode la plus simple, la moins coûteuse et qui n’entraîne aucun risque est l’arrachage manuel de la plante. Le meilleur moment pour le faire est avant la floraison, au début d’août. Si on le fait ainsi, les plantes ne produiront pas alors leurs millions de grains de pollen, elles ne se reproduiront pas et n’envahiront pas les terrains. On peut toucher sans danger la plante pour l’arracher, elle ne crée pas d’allergie cutanée de contact (dermatite).
À part cette méthode manu militari, on peut évidemment employer l’artillerie lourde des désherbants chimiques, mais il existe assez peu d’herbicides efficaces et ils ne sont pas sans impact sur l’environnement. Si vous avez de l’ambroisie à feuilles d’armoise sur votre terrain, donc, les arracher et les brûler est ce qui convient le mieux - pour votre santé, et pour celle de tous vos voisins.
L’ambroisie à feuilles d’armoise est originaire des prairies de l’Amérique du nord. Comment est-elle parvenue chez nous ? On se perd en hypothèses. Cela va des semences de légumineuses importées qui auraient été contaminées, à la pharmacie personnelle de curistes américains fréquentant les villes thermales. On accuse le fourrage des chevaux de l’armée américains pendant la première guerre mondiale : truffé de graines d’ambroisie, il se serait répandu dans notre environnement. Quoiqu’il en soit, l’ambroisie est arrivée plus tôt en Europe, il y a au moins deux siècles et depuis, elle s’étend partout.
Ce n’est que depuis peu qu’on a compris son rôle dans les allergies, cependant : en 1966, une première recherche sur les allergies dans la région de Lyon la met en cause. En 2004, on la signale dans 64 départements français. En assez forte concentration dans la région Rhône-Alpes, cette « plante envahissante » fait depuis peu l’objet d’arrêtés d’éradication dans plusieurs départements, dont la Drôme et le Vaucluse. C’est donc devenu un enjeu de santé publique.
La méthode la plus simple, la moins coûteuse et qui n’entraîne aucun risque est l’arrachage manuel de la plante. Le meilleur moment pour le faire est avant la floraison, au début d’août. Si on le fait ainsi, les plantes ne produiront pas alors leurs millions de grains de pollen, elles ne se reproduiront pas et n’envahiront pas les terrains. On peut toucher sans danger la plante pour l’arracher, elle ne crée pas d’allergie cutanée de contact (dermatite).
À part cette méthode manu militari, on peut évidemment employer l’artillerie lourde des désherbants chimiques, mais il existe assez peu d’herbicides efficaces et ils ne sont pas sans impact sur l’environnement. Si vous avez de l’ambroisie à feuilles d’armoise sur votre terrain, donc, les arracher et les brûler est ce qui convient le mieux - pour votre santé, et pour celle de tous vos voisins.
Plus d'infos :
• www.ambroisie.info
• perso.wanadoo.fr/afeda
• www.rnsa.asso.fr
Jean Pierre Rogel

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Fai pas fre, mai boufa [ par T.d.c - T.d.v. ]
Selon un proverbe attribué à nos amis d'outre-Quiévrain (modifié par un conducteur de camion bleu) : « Neige en Provence, Noël en décembre et Paco Rabanne » comme concluait Michel Colucci. On pourrait dire aussi qu'après les vendanges, la chasse, la taille des vignes et la cueillette des olives s'effectuent généralement à la fin de l'automne et en hiver.
C'est là que je veux en venir. Quand on travaille dehors par les temps qui courent, on est « gelé ». Si l'on dispose d'une bonne couche de couenne ou si l'on se couvre de plusieurs épaisseurs de vêtements isolants, on résiste un peu plus longtemps au froid.
Nombreux sont ceux qui disent, d'expérience, qu'il est rare qu'il gèle quand la bise souffle mais que, cependant, l'on se refroidit plus vite par temps de mistral, même bien emmitouflé. Pourtant le vent est à la même température que l'air.
Des études ont été menées afin de mesurer l'effet réfrigérant des courants d'air sur la pâte humaine.
Par exemple un vent de huit kilomètres par heure (soit de deux degrés Beaufort) (1) provoquera un refroidissement, que l'on pourrait qualifier de physiologique, d'un à deux degrés par rapport à la température sous abri.
Un vent de seize kilomètres par heure (soit de trois degrés Beaufort) (2) provoquera un refroidissement de six degrés pour une température au-dessus de zéro, et de neuf degrés pour une température de moins sept degrés au thermomètre.
Un vent de soixante-huit kilomètres par heure (soit de huit degrés Beaufort) (3) – ce n'est pas rare dans les vignes de Villedieu – provoquera un refroidissement de treize degrés pour une température de dix degrés, seize degrés pour une température de quatre degrés (4), vingt degrés pour une température de moins un degré, vingt-trois degrés pour une température de moins sept degrés, vingt-six degrés pour une température de moins douze degrés.
Au delà de soixante-huit kilomètres par heure, l'accroissement de la vitesse du vent n'accroît plus le refroidissement. Notons enfin que si par vent faible ou nul, on se déplace sans abri aux vitesses ci-indiquées, le phénomène est identique.
La sensation semble évidente, mais l'exposé chiffré un peu compliqué. Pour résumer, disons que rester dehors à moins un degré par une bise de soixante kilomètres par heure, c'est un peu comme couper les sarments de bouleau en Sibérie par temps calme.
Les tailleuses et les tailleurs, les cueilleuses et les cueilleurs, les chasseresses et les chasseurs ont bien du mérite quand « ça bouffe », même par quatre degrés au-dessus de zéro au thermomètre.
Il leur reste toutefois la solution, dos au vent, de tailler en pétrolette, cueillir en patinette à moteur ou de chasser à courre.
(1) Deux degrés Beaufort (5) : légère brise.
(2) Trois degrés Beaufort : petite brise.
(3) Huit degrés Beaufort : coup de vent.
(4) Et pourtant à quatre degrés, même par ouragan (plus de cent dix-huit kilomètres par heure), l'eau ne gèle pas.
(5) C'est Sir Francis Beaufort (1774-1857), officier de la marine britannique malgré son nom à consonance bien de chez nous qui a inventé non pas le fromage mais l'échelle. Certains disent que c'est Richter, mais lui, je crains qu'il nous fasse trembler.
C'est là que je veux en venir. Quand on travaille dehors par les temps qui courent, on est « gelé ». Si l'on dispose d'une bonne couche de couenne ou si l'on se couvre de plusieurs épaisseurs de vêtements isolants, on résiste un peu plus longtemps au froid.
Nombreux sont ceux qui disent, d'expérience, qu'il est rare qu'il gèle quand la bise souffle mais que, cependant, l'on se refroidit plus vite par temps de mistral, même bien emmitouflé. Pourtant le vent est à la même température que l'air.
Des études ont été menées afin de mesurer l'effet réfrigérant des courants d'air sur la pâte humaine.
Par exemple un vent de huit kilomètres par heure (soit de deux degrés Beaufort) (1) provoquera un refroidissement, que l'on pourrait qualifier de physiologique, d'un à deux degrés par rapport à la température sous abri.
Un vent de seize kilomètres par heure (soit de trois degrés Beaufort) (2) provoquera un refroidissement de six degrés pour une température au-dessus de zéro, et de neuf degrés pour une température de moins sept degrés au thermomètre.
Un vent de soixante-huit kilomètres par heure (soit de huit degrés Beaufort) (3) – ce n'est pas rare dans les vignes de Villedieu – provoquera un refroidissement de treize degrés pour une température de dix degrés, seize degrés pour une température de quatre degrés (4), vingt degrés pour une température de moins un degré, vingt-trois degrés pour une température de moins sept degrés, vingt-six degrés pour une température de moins douze degrés.
Au delà de soixante-huit kilomètres par heure, l'accroissement de la vitesse du vent n'accroît plus le refroidissement. Notons enfin que si par vent faible ou nul, on se déplace sans abri aux vitesses ci-indiquées, le phénomène est identique.
La sensation semble évidente, mais l'exposé chiffré un peu compliqué. Pour résumer, disons que rester dehors à moins un degré par une bise de soixante kilomètres par heure, c'est un peu comme couper les sarments de bouleau en Sibérie par temps calme.
Les tailleuses et les tailleurs, les cueilleuses et les cueilleurs, les chasseresses et les chasseurs ont bien du mérite quand « ça bouffe », même par quatre degrés au-dessus de zéro au thermomètre.
Il leur reste toutefois la solution, dos au vent, de tailler en pétrolette, cueillir en patinette à moteur ou de chasser à courre.
(1) Deux degrés Beaufort (5) : légère brise.
(2) Trois degrés Beaufort : petite brise.
(3) Huit degrés Beaufort : coup de vent.
(4) Et pourtant à quatre degrés, même par ouragan (plus de cent dix-huit kilomètres par heure), l'eau ne gèle pas.
(5) C'est Sir Francis Beaufort (1774-1857), officier de la marine britannique malgré son nom à consonance bien de chez nous qui a inventé non pas le fromage mais l'échelle. Certains disent que c'est Richter, mais lui, je crains qu'il nous fasse trembler.
La clématite, une plante bien de chez nous [ par Monique Hennemann-Armand ]
Nom : clématite vitalla. Famille : renonculacées.
Clématite : son nom de consonance agréable est d'origine grecque. Klema : terme signifiant sarment, liane. Les latins n'adopteront ce nom que très tard. Il ne sera mis dans le dictionnaire français qu’en 1559. Bien sûr, les habitants de France n'ont pas attendu cette date pour la baptiser d'une région à une autre soit : la rome, la rampille, le traîneau, la traînasse, la regourtilla (du cévenol s'entortiller). D'autres noms plus imagés font allusion à l'aspect duveteux de ses fruits ou à son utilisation : barbe du bon Dieu, cheveux de la Vierge, bois de bique, fumerotte (en Franche-Comté) joie du voyageur, ornements du chemin, chevelure de Notre-Dame, velie ou veillire (Territoire de Belfort).
La clématite est une liane. On dirait une grosse corde fibreuse, s'effilochant en lambeaux qui peut ramper sur le sol ou grimper le plus souvent dans les arbres par de petites vrilles.
Au printemps, les feuilles naissent opposées (réparties symétriquement d'une part et d'autre de la tige). Les feuilles sont de forme triangulaire et présentent une dent caractéristique de chaque côté du limbe.
La clématite fleurit en été (juillet-août). Les fleurs ont quatre pétales de couleur blancs jaunâtres, légèrement odorants avec des étamines très saillantes. A l'automne, les fleurs se transforment en fruits poilus prolongés par des menues chenilles duveteuses qui laissent croire à une deuxième floraison plus qu'apparente.
Dans nos jardins, cette humble clématite des haies a des parentes plus éclatantes comme la clématite des Alpes. Elle est proche de la clématite du Japon à grandes fleurs aux multiples couleurs cultivées par les horticulteurs européens. On rencontre la clématite dans toute l'Europe et elle affectionne plus particulièrement les sols calcaires. En Provence, elle se trouve dans de nombreuses haies, chemins et bords de ruisseau...
Ses jeunes pousses sont comestibles à condition de les faire cuire très longtemps dans de l'eau. Sa longue tige fibreuse qui peut atteindre parfois 30 mètres peut être utilisée comme lien en remplacement du fil de fer galvanisé. Mais surtout elle est une matière première pour la vannerie rustique (muselière, fonds de corbeilles à anses, paniers à couver, ruches pour les abeilles.
La clématite a la propriété de se consumer comme du tabac. Louis Pergaud dans son roman « la guerre des boutons » en 1912 décrit des garçons adolescents savourant les cigarettes rudimentaires à la fin du repas.
En Provence, dans l'affinage des picodons, certaines personnes entourent le fromage de feuilles de clématites que l'on renouvelle chaque semaine pour en préserver l'humidité surtout par temps sec. Curieux pouvoir. Les feuilles écrasées et appliquées contre la peau humaine provoquent des inflammations, des ulcérations spectaculaires mais superficielles si bien que certaines personnes du début du siècle dernier usèrent de ce pouvoir pour réaliser des vols ou obtenir de l'habitant visité la pitié ou éventuellement de l'argent d'où le nom d'herbe aux gueux.
Une légende périgourdine prétend que la clématite est à l'origine du chant nocturne du rossignol. La voici : autrefois, il y a très très longtemps, le rossignol dormait toute la nuit. Mais un soir, il s'assoupit sur une branche où grimpait une clématite. Dans les ténèbres, la clématite se hissa et ses vrilles ligotèrent les pattes du passereau. Celui-ci au réveil eut bien du mal à se « dépêtrer » de cette liane pour prendre son envol. Depuis pour ne pas renouveler cette mauvaise aventure celui-ci chante la nuit. « Dormiraï più più più più me toursounaïre la vi ».
Clématite : son nom de consonance agréable est d'origine grecque. Klema : terme signifiant sarment, liane. Les latins n'adopteront ce nom que très tard. Il ne sera mis dans le dictionnaire français qu’en 1559. Bien sûr, les habitants de France n'ont pas attendu cette date pour la baptiser d'une région à une autre soit : la rome, la rampille, le traîneau, la traînasse, la regourtilla (du cévenol s'entortiller). D'autres noms plus imagés font allusion à l'aspect duveteux de ses fruits ou à son utilisation : barbe du bon Dieu, cheveux de la Vierge, bois de bique, fumerotte (en Franche-Comté) joie du voyageur, ornements du chemin, chevelure de Notre-Dame, velie ou veillire (Territoire de Belfort).
La clématite est une liane. On dirait une grosse corde fibreuse, s'effilochant en lambeaux qui peut ramper sur le sol ou grimper le plus souvent dans les arbres par de petites vrilles.
Au printemps, les feuilles naissent opposées (réparties symétriquement d'une part et d'autre de la tige). Les feuilles sont de forme triangulaire et présentent une dent caractéristique de chaque côté du limbe.
La clématite fleurit en été (juillet-août). Les fleurs ont quatre pétales de couleur blancs jaunâtres, légèrement odorants avec des étamines très saillantes. A l'automne, les fleurs se transforment en fruits poilus prolongés par des menues chenilles duveteuses qui laissent croire à une deuxième floraison plus qu'apparente.
Dans nos jardins, cette humble clématite des haies a des parentes plus éclatantes comme la clématite des Alpes. Elle est proche de la clématite du Japon à grandes fleurs aux multiples couleurs cultivées par les horticulteurs européens. On rencontre la clématite dans toute l'Europe et elle affectionne plus particulièrement les sols calcaires. En Provence, elle se trouve dans de nombreuses haies, chemins et bords de ruisseau...
Ses jeunes pousses sont comestibles à condition de les faire cuire très longtemps dans de l'eau. Sa longue tige fibreuse qui peut atteindre parfois 30 mètres peut être utilisée comme lien en remplacement du fil de fer galvanisé. Mais surtout elle est une matière première pour la vannerie rustique (muselière, fonds de corbeilles à anses, paniers à couver, ruches pour les abeilles.
La clématite a la propriété de se consumer comme du tabac. Louis Pergaud dans son roman « la guerre des boutons » en 1912 décrit des garçons adolescents savourant les cigarettes rudimentaires à la fin du repas.
En Provence, dans l'affinage des picodons, certaines personnes entourent le fromage de feuilles de clématites que l'on renouvelle chaque semaine pour en préserver l'humidité surtout par temps sec. Curieux pouvoir. Les feuilles écrasées et appliquées contre la peau humaine provoquent des inflammations, des ulcérations spectaculaires mais superficielles si bien que certaines personnes du début du siècle dernier usèrent de ce pouvoir pour réaliser des vols ou obtenir de l'habitant visité la pitié ou éventuellement de l'argent d'où le nom d'herbe aux gueux.
Une légende périgourdine prétend que la clématite est à l'origine du chant nocturne du rossignol. La voici : autrefois, il y a très très longtemps, le rossignol dormait toute la nuit. Mais un soir, il s'assoupit sur une branche où grimpait une clématite. Dans les ténèbres, la clématite se hissa et ses vrilles ligotèrent les pattes du passereau. Celui-ci au réveil eut bien du mal à se « dépêtrer » de cette liane pour prendre son envol. Depuis pour ne pas renouveler cette mauvaise aventure celui-ci chante la nuit. « Dormiraï più più più più me toursounaïre la vi ».


La clématite
est une liane...
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Pour saluer nos collines… [ par Jean-Pierre Rogel ]
« Tous les parfums de la Provence dans une pinède »… « des bois qui sentent bon le thym et le romarin »… « des sentiers courant entre les vignes et les oliviers ». Vous ne trouverez peut-être pas ces expressions fleuries à propos de Villedieu dans les livres de randonnées pédestres ou les guides écologiques à la mode, mais nous avons tout cela autour du village.
Pour en profiter, il suffit d'avoir de bonnes chaussures de marche et d'ouvrir l'œil. Nous avons beaucoup de chemins qui traversent le territoire de la commune, certains étant peu fréquentés et en décor naturel, et beaucoup de plantes, d'oiseaux et d'animaux qui n'attendent que notre visite. Qui plus est, en toutes saisons puisqu'il ne fait jamais trop froid, ni trop chaud (bon, d'accord, il y a quelques journées aux températures extrêmes, mais si peu…).
Chacun peut se tailler ses propres parcours de balade à pied, des boucles d'une ou deux heures à partir du centre du village, mais pour ceux qui veulent connaître ce que j'appellerai « une grande classique de Villedieu », je vais la décrire ci-dessous. C'est une de mes balades préférées, et j'ai eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes du village, tant des résidants permanents que saisonniers, la connaissent et la pratiquent. Elle est même fléchée sur la majorité du parcours, ce qui la rend plus facile pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la topographie locale.
Sur certaines cartes – notamment, la carte IGN Top 25 numéro 3139 – elle figure comme étant une boucle autour du Bois des Adrets, en fait une boucle un peu décalée vers l'Est et vers le Sud. Sur le terrain, il existe en réalité de petites différences avec ce qu'indique la carte, mais ce n'est pas grave car en suivant le fléchage, on se retrouve facilement.
Alors, voici : en partant du village, vous vous dirigez vers la route rurale qui monte vers la colline Saint-Laurent. À l'embranchement en « Y » où il y a une citerne (le point 268 m sur les cartes), vous prenez à gauche vers la Serre de la Donne. Passé cette ferme, la route goudronnée cède la place à un chemin de terre, que vous suivez sur 200 mètres, avant de tomber sur une pancarte qui porte des flèches bleues pointant vers le bas de la colline et des flèches blanches pointant vers le haut. Vous allez vers le haut, à travers un champ de vignes, et vous arrivez sur une petite crête boisée (si vous préférez marcher moins, vous pouvez vous rendre en auto jusque-là et vous y garer, cela constitue un bon point de départ).
C'est ici que commence le fléchage, en petites flèches jaunes de plastique, vers le Bois des Adrets.
De là, vous suivez un agréable chemin forestier sur environ un kilomètre et demi, avec une belle vue sur le Plan de Mirabel à un certain moment. À la pointe Est du bois, il faut tourner abruptement à droite, plein Sud, sur un chemin caillouteux qui monte raide. Bientôt, vous êtes sur une crête qui vous permet de dominer la vallée vers Mirabel. Une fois, j'y ai vu une biche avec ses deux faons.
Vous vous dirigez ensuite vers le Bois des Ausselons ; le sentier, toujours fléché, serpente dans une agréable pinède. Il y a des pins d'Alep, des buis, quelques chênes à travers cela, et des buissons de sarriette. J'y ai souvent vu des traces de sanglier. Au sommet des Ausselons, regardez bien, vous devriez trouver la borne métallique fichée en terre. C'est le point géodésique indiquant le sommet de la colline, à 423 mètres.
Le sentier vous entraîne ensuite à descendre cette butte. En sortant du bois, un kilomètre plus loin, vous tombez sur un fléchage différent, flèches bleues vers la droite (ne pas les suivre pour ce circuit) et blanches vers la gauche. Vous suivez alors ces marques, à travers champs et vignes : le sentier vous conduit à la route qui descend de Font-Froide. Quand vous arrivez à cette route, vous la prenez à droite, en descendant. Cela vous ramènera au carrefour en « Y » avec la citerne. Si vous êtes à pied, il vous reste à continuer tout droit vers le village. Si votre auto est garée sur la crête, vous tournez à droite et vous la rejoignez après à peine dix minutes de marche.
Dans ce « grand classique » de la randonnée pédestre villadéenne, lorsque vous retrouvez la route rurale qui descend de Font-Froide, vous pouvez opter pour une boucle supplémentaire. Cela consiste à remonter vers le Bois du Roi, une autre colline dominante, qui est traversée par quelques chemins d'exploitation. Du moment que vous progressez vers le Sud, vous finirez par tomber sur le Valat des Estaillades. Vous rejoignez alors la route goudronnée qui retourne au village, par ce qu'on nomme ici « le quartier de la Montagne ».
Personnellement, je fais peu souvent ce grand circuit des deux bois, celui des Adrets et du Roi, car alors il faut compter pratiquement trois heures et demie de marche. Mais en été, avec un bon chapeau et une grosse bouteille d'eau – précautions élémentaires qu'il ne fait jamais de mal de répéter à nos amis visiteurs de passage – c'est la manière royale de saluer nos collines.
Lors de ces promenades, que peut-on voir, en plus de se maintenir en forme et de respirer le grand air ? Je dirais que cela dépend de l'humeur du marcheur et ce qui l'intéresse. Mais, chose certaine, il y a des arbres, des fleurs, des plantes aromatiques, des oiseaux, des insectes et des petits animaux en grande abondance, tout cela au rythme changeant des saisons. On est au cœur d'une végétation méditerranéenne relativement variée, dans des écosystèmes assez riches, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Bien entendu, ce n'est pas la nature sauvage : on est toujours proche des champs et des habitations, et la fragmentation des habitats naturels est un problème sérieux pour ces animaux et ces plantes, de plus en plus « coincés ».
La marque de l'homme est partout et l'agriculture, en particulier, rogne année après année sur les boisés – sujet délicat dont il faudrait bien reparler un jour. Mais dans l'ensemble, nous sommes très chanceux d'avoir ces petits morceaux de forêt autour du village et ils sont très précieux. « Tous les parfums de la Provence dans une pinède »… « des bois qui sentent bon le thym et le romarin »… « des sentiers courant entre les vignes et les oliviers ». Ne cherchez plus et laissez tomber les phrases ronflantes : nous avons tout cela ici !
Pour en profiter, il suffit d'avoir de bonnes chaussures de marche et d'ouvrir l'œil. Nous avons beaucoup de chemins qui traversent le territoire de la commune, certains étant peu fréquentés et en décor naturel, et beaucoup de plantes, d'oiseaux et d'animaux qui n'attendent que notre visite. Qui plus est, en toutes saisons puisqu'il ne fait jamais trop froid, ni trop chaud (bon, d'accord, il y a quelques journées aux températures extrêmes, mais si peu…).
Chacun peut se tailler ses propres parcours de balade à pied, des boucles d'une ou deux heures à partir du centre du village, mais pour ceux qui veulent connaître ce que j'appellerai « une grande classique de Villedieu », je vais la décrire ci-dessous. C'est une de mes balades préférées, et j'ai eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes du village, tant des résidants permanents que saisonniers, la connaissent et la pratiquent. Elle est même fléchée sur la majorité du parcours, ce qui la rend plus facile pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la topographie locale.
Sur certaines cartes – notamment, la carte IGN Top 25 numéro 3139 – elle figure comme étant une boucle autour du Bois des Adrets, en fait une boucle un peu décalée vers l'Est et vers le Sud. Sur le terrain, il existe en réalité de petites différences avec ce qu'indique la carte, mais ce n'est pas grave car en suivant le fléchage, on se retrouve facilement.
Alors, voici : en partant du village, vous vous dirigez vers la route rurale qui monte vers la colline Saint-Laurent. À l'embranchement en « Y » où il y a une citerne (le point 268 m sur les cartes), vous prenez à gauche vers la Serre de la Donne. Passé cette ferme, la route goudronnée cède la place à un chemin de terre, que vous suivez sur 200 mètres, avant de tomber sur une pancarte qui porte des flèches bleues pointant vers le bas de la colline et des flèches blanches pointant vers le haut. Vous allez vers le haut, à travers un champ de vignes, et vous arrivez sur une petite crête boisée (si vous préférez marcher moins, vous pouvez vous rendre en auto jusque-là et vous y garer, cela constitue un bon point de départ).
C'est ici que commence le fléchage, en petites flèches jaunes de plastique, vers le Bois des Adrets.
De là, vous suivez un agréable chemin forestier sur environ un kilomètre et demi, avec une belle vue sur le Plan de Mirabel à un certain moment. À la pointe Est du bois, il faut tourner abruptement à droite, plein Sud, sur un chemin caillouteux qui monte raide. Bientôt, vous êtes sur une crête qui vous permet de dominer la vallée vers Mirabel. Une fois, j'y ai vu une biche avec ses deux faons.
Vous vous dirigez ensuite vers le Bois des Ausselons ; le sentier, toujours fléché, serpente dans une agréable pinède. Il y a des pins d'Alep, des buis, quelques chênes à travers cela, et des buissons de sarriette. J'y ai souvent vu des traces de sanglier. Au sommet des Ausselons, regardez bien, vous devriez trouver la borne métallique fichée en terre. C'est le point géodésique indiquant le sommet de la colline, à 423 mètres.
Le sentier vous entraîne ensuite à descendre cette butte. En sortant du bois, un kilomètre plus loin, vous tombez sur un fléchage différent, flèches bleues vers la droite (ne pas les suivre pour ce circuit) et blanches vers la gauche. Vous suivez alors ces marques, à travers champs et vignes : le sentier vous conduit à la route qui descend de Font-Froide. Quand vous arrivez à cette route, vous la prenez à droite, en descendant. Cela vous ramènera au carrefour en « Y » avec la citerne. Si vous êtes à pied, il vous reste à continuer tout droit vers le village. Si votre auto est garée sur la crête, vous tournez à droite et vous la rejoignez après à peine dix minutes de marche.
Dans ce « grand classique » de la randonnée pédestre villadéenne, lorsque vous retrouvez la route rurale qui descend de Font-Froide, vous pouvez opter pour une boucle supplémentaire. Cela consiste à remonter vers le Bois du Roi, une autre colline dominante, qui est traversée par quelques chemins d'exploitation. Du moment que vous progressez vers le Sud, vous finirez par tomber sur le Valat des Estaillades. Vous rejoignez alors la route goudronnée qui retourne au village, par ce qu'on nomme ici « le quartier de la Montagne ».
Personnellement, je fais peu souvent ce grand circuit des deux bois, celui des Adrets et du Roi, car alors il faut compter pratiquement trois heures et demie de marche. Mais en été, avec un bon chapeau et une grosse bouteille d'eau – précautions élémentaires qu'il ne fait jamais de mal de répéter à nos amis visiteurs de passage – c'est la manière royale de saluer nos collines.
Lors de ces promenades, que peut-on voir, en plus de se maintenir en forme et de respirer le grand air ? Je dirais que cela dépend de l'humeur du marcheur et ce qui l'intéresse. Mais, chose certaine, il y a des arbres, des fleurs, des plantes aromatiques, des oiseaux, des insectes et des petits animaux en grande abondance, tout cela au rythme changeant des saisons. On est au cœur d'une végétation méditerranéenne relativement variée, dans des écosystèmes assez riches, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Bien entendu, ce n'est pas la nature sauvage : on est toujours proche des champs et des habitations, et la fragmentation des habitats naturels est un problème sérieux pour ces animaux et ces plantes, de plus en plus « coincés ».
La marque de l'homme est partout et l'agriculture, en particulier, rogne année après année sur les boisés – sujet délicat dont il faudrait bien reparler un jour. Mais dans l'ensemble, nous sommes très chanceux d'avoir ces petits morceaux de forêt autour du village et ils sont très précieux. « Tous les parfums de la Provence dans une pinède »… « des bois qui sentent bon le thym et le romarin »… « des sentiers courant entre les vignes et les oliviers ». Ne cherchez plus et laissez tomber les phrases ronflantes : nous avons tout cela ici !

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Au bord de nos rivières [ par Brigitte Rochas ]
Si vos promenades vous emmènent le long de l'Aygues, vous avez peut-être entendu des claquements secs provenant de la surface de la rivière, c'est un castor qui frappe l'eau avec sa queue pour avertir ses congénères d'un danger.
Vous avez pu remarquer des mini-plans d'eau aménagés près des berges : ces petits « étangs » peu profonds – 60 cm – sont situés près des bords et délimités, côté libre, par une digue formée d'un amas de branchages et de boue.
Ces réalisations sont l'oeuvre des castors et protègent l'entrée de leur habitat ou terrier, entrée qui est toujours au dessous du niveau de l'eau. Il n'est pas facile d'apercevoir le castor car il est de mœurs nocturnes ou crépusculaires, pourtant sa présence est avérée.
– Un pêcheur installé au bord de l'étang de la Gardette en a aperçu plusieurs, le jour.
– Un verger de jeunes pommiers a été partiellement détruit dans la vallée de l'Ouvèze ; les castors avaient sectionné et transporté les troncs pour réaliser l'aménagement de leur domaine.
– Ailleurs, un autre aménagement démoli au tractopelle a été reconstruit en deux nuits.
Ce castor européen – castor fiber – appartient à la famille des rongeurs ainsi que le castor américain – castor canadensis – malgré quelques différences en taille, couleur et habitat.
Les deux espèces sont végétariennes et se nourrissent de racines, d'écorces, d'herbes, de feuilles et de certains fruits – poires, pommes, glands, châtaignes.
La construction de leur habitat nécessite un minimum de végétation, saule, frêne, noisetier, bouleau, une faible pente, l % environ et 60 cm d'eau afin de pouvoir dissimuler l'entrée. Cet abri, toujours construit au sec, assure la sécurité du castor et de sa famille ; il sert aussi à stocker les réserves de nourriture.
Les castors sont monogames. La cellule familiale se compose des parents, des jeunes de l'année ainsi que de ceux de l'année précédente. À l'âge de deux ans, les jeunes sont chassés par les parents.
Le domaine du castor s'étend sur un à deux kilomètres du cours d'eau. Son « propriétaire » contrôle régulièrement l'état des différents aménagements afin de réaliser les réparations nécessaires.
Ce gros rongeur a le corps trapu, les pattes postérieures palmées et tous les doigts portent des griffes ; la queue est plate et écailleuse. Il mesure de 90 cm à 120 cm de long dont 30 cm pour la queue, sa hauteur au garrot est de 16 à 18 cm. Il pèse entre 12 et 28 kg. Son pelage brun roux est plus clair sur le ventre, sa fourrure épaisse est imperméable. Il peut vivre une vingtaine d'années. Le castor est un excellent nageur mais c'est une proie facile sur la terre ferme.
Cet animal possède des incisives biseautées et tranchantes ; les incisives inférieures s'usent plus vite que les supérieures. Lorsqu'il coupe une branche, le castor plante ses incisives supérieures et se sert des inférieures comme de ciseaux à bois pour tailler des copeaux. Les branches qu'il coupe mesurent de deux à 15 cm de diamètre, mais peuvent être bien plus grosses.
Autrefois présents sur tout le territoire français, les castors avaient vu leur nombre se réduire à cause de la destruction de leur habitat, de la qualité de leur fourrure, de leur chair, et du piégeage pour récupérer le « castoréum », substance sécrétée par les glandes odorantes utilisée en pharmacie.
Depuis les années 50, le castor est une espèce protégée, sa population s'accroît. Son intervention sur les petits cours d'eau freine l'érosion, en tempère le débit ; elle augmente la capacité piscicole des rivières, favorise la dispersion des graines des plantes aquatiques.
Castor vient du grec kastor mais son nom gaulois, bièvre, se retrouve encore dans l'appellation de certains villages.
Vous avez pu remarquer des mini-plans d'eau aménagés près des berges : ces petits « étangs » peu profonds – 60 cm – sont situés près des bords et délimités, côté libre, par une digue formée d'un amas de branchages et de boue.
Ces réalisations sont l'oeuvre des castors et protègent l'entrée de leur habitat ou terrier, entrée qui est toujours au dessous du niveau de l'eau. Il n'est pas facile d'apercevoir le castor car il est de mœurs nocturnes ou crépusculaires, pourtant sa présence est avérée.
– Un pêcheur installé au bord de l'étang de la Gardette en a aperçu plusieurs, le jour.
– Un verger de jeunes pommiers a été partiellement détruit dans la vallée de l'Ouvèze ; les castors avaient sectionné et transporté les troncs pour réaliser l'aménagement de leur domaine.
– Ailleurs, un autre aménagement démoli au tractopelle a été reconstruit en deux nuits.
Ce castor européen – castor fiber – appartient à la famille des rongeurs ainsi que le castor américain – castor canadensis – malgré quelques différences en taille, couleur et habitat.
Les deux espèces sont végétariennes et se nourrissent de racines, d'écorces, d'herbes, de feuilles et de certains fruits – poires, pommes, glands, châtaignes.
La construction de leur habitat nécessite un minimum de végétation, saule, frêne, noisetier, bouleau, une faible pente, l % environ et 60 cm d'eau afin de pouvoir dissimuler l'entrée. Cet abri, toujours construit au sec, assure la sécurité du castor et de sa famille ; il sert aussi à stocker les réserves de nourriture.
Les castors sont monogames. La cellule familiale se compose des parents, des jeunes de l'année ainsi que de ceux de l'année précédente. À l'âge de deux ans, les jeunes sont chassés par les parents.
Le domaine du castor s'étend sur un à deux kilomètres du cours d'eau. Son « propriétaire » contrôle régulièrement l'état des différents aménagements afin de réaliser les réparations nécessaires.
Ce gros rongeur a le corps trapu, les pattes postérieures palmées et tous les doigts portent des griffes ; la queue est plate et écailleuse. Il mesure de 90 cm à 120 cm de long dont 30 cm pour la queue, sa hauteur au garrot est de 16 à 18 cm. Il pèse entre 12 et 28 kg. Son pelage brun roux est plus clair sur le ventre, sa fourrure épaisse est imperméable. Il peut vivre une vingtaine d'années. Le castor est un excellent nageur mais c'est une proie facile sur la terre ferme.
Cet animal possède des incisives biseautées et tranchantes ; les incisives inférieures s'usent plus vite que les supérieures. Lorsqu'il coupe une branche, le castor plante ses incisives supérieures et se sert des inférieures comme de ciseaux à bois pour tailler des copeaux. Les branches qu'il coupe mesurent de deux à 15 cm de diamètre, mais peuvent être bien plus grosses.
Autrefois présents sur tout le territoire français, les castors avaient vu leur nombre se réduire à cause de la destruction de leur habitat, de la qualité de leur fourrure, de leur chair, et du piégeage pour récupérer le « castoréum », substance sécrétée par les glandes odorantes utilisée en pharmacie.
Depuis les années 50, le castor est une espèce protégée, sa population s'accroît. Son intervention sur les petits cours d'eau freine l'érosion, en tempère le débit ; elle augmente la capacité piscicole des rivières, favorise la dispersion des graines des plantes aquatiques.
Castor vient du grec kastor mais son nom gaulois, bièvre, se retrouve encore dans l'appellation de certains villages.

Castor canadensis
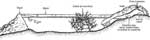
Aménagement réalisé par le castor
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Pique-nique sur le Ventoux [ par Jean-Pierre Rogel ]
La Gazette ne ménage pas ses efforts pour enrichir ses lecteurs. Elle ouvre, dans ce numéro, une nouvelle rubrique suggérée par Jean-Pierre Rogel qui, comme son nom l’indique, traitera de la nature.
« Nous sommes à la fontaine de la Grave, mince filet d’eau reçu au sortir du sol dans une série de longues auges en troncs de hêtres, où les bergers de la montagne viennent faire boire leurs troupeaux. La température de la source est de sept degrés, fraîcheur inestimable pour nous qui sortons de la fournaise caniculaire de la plaine. »
C’est Jean-Henri Fabre, le grand naturaliste de Sérignan, qui décrit une de ses nombreuses ascensions du Ventoux, vers 1860. La fontaine de la Grave existe toujours, on peut la voir en descendant du sommet du mont Ventoux sur la route départementale 974, dans l’avant-dernier virage avant le chalet Reynard.
À son habitude, Fabre est précis et enthousiaste dans sa description, s’extasiant autant sur les plantes rares qu’il découvre que sur la nourriture hissée à dos d’âne par ses amis (« voici les gigots bourrés d’ ail... et le maître dessert, l’oignon qui se mange cru avec du sel »).
La mention des bergers et de leurs troupeaux nous plonge au cœur de ce qui a le plus changé sur le mont Ventoux. Le couvert végétal que nous voyons aujourd’hui est en effet très différent de celui qu’on voyait, il y a un siècle et demi. C’est le résultat d’un vaste programme de reboisement qui a commencé sur le flanc sud en 1861 et s’est poursuivi pendant près de 70 ans. Quelques années plus tôt en effet, en 1856, des inondations catastrophiques avaient eu lieu dans les bassins de la Loire et du Rhône et l’opinion publique avait poussé les responsables à ouvrir un immense chantier de reboisement sur les versants des montagnes françaises.
Ainsi, contrairement à ce qu’on pense parfois, ce ne sont pas les ravages crées par le broutage intensif des moutons ou bien le déboisement pour la construction des maisons qui a incité l’État à agir, mais plutôt des catastrophes naturelles et leurs conséquences. Il reste cependant que, de 1250, date à laquelle le seigneur Barral des Baux autorisa les habitants de Bédoin « et tous leurs enfants nés et à naître » à couper du bois, défricher la forêt et faire paître leurs bêtes, jusque à cette période de la fin du XIXe siècle, les forêts du Ventoux ont été exploitées, et fort probablement surexploitées selon les critères écologiques, c’est-à-dire au delà de la capacité naturelle de régénération.
Cela ne passa pas inaperçu toutefois, puisque les autorités ont tenté vainement, pendant au moins deux siècles, d’enrayer le phénomène. Il a tout de même fallu que les dommages, sous forme d’inondations et d’érosion dans les piémonts, soient très importants pour que les choses bougent en 1860.
On a donc reboisé massivement et par étage. Il existe en effet un étagement naturel de la végétation selon l’altitude, qui est dû au climat, aux sols et aux expositions.
Sur le versant nord du mont Ventoux où il y a moins de lumière et de fortes pentes, on trouve des plantes caractéristiques des milieux continentaux, en particulier alpins. Sur le flanc sud, la végétation est typiquement méditerranéenne. Toujours est-il que les ingénieurs des Eaux et Forêts ont beaucoup utilisé les essences présentes naturellement, comme le chêne vert, le pin d’Alep et le pin sylvestre, jusqu’à 1 200 m. Au-dessus, ils ont essayé de reboiser avec des hêtres, mais avec moins de succès. En revanche, ils ont introduit massivement deux essences étrangères à la région : le pin noir d’Autriche et le cèdre de l’Atlas. C’est un ingénieur nomme François Tichadou qui a été le premier à introduire le cèdre de l’Atlas sur 15 hectares près de Bédoin, à partir de graines qu’il avait lui-même récoltées dans les massifs de l’Atlas en Algérie. Par dissémination naturelle, cet arbre a magnifiquement colonisé à ce jour près de 400 hectares.
Les travaux préparatoires ont été importants. On a redressé des cours d’eau, et préparé les sols sur de grandes étendues. Pour les chênes, par exemple, il était courant de creuser un trou pour y disposer une centaine de glands, afin d’espérer un bouquet de trois ou quatre arbres. Pour les résineux, on a établi des pépinières sur place et replanté de jeunes pousses. Au total, plus de 8 000 hectares ont été ainsi reboisés. Aujourd’hui, le couvert forestier est d’environ 20 000 hectares et descend pratiquement jusque au pied du massif, à l’exception de la partie sommitale.
Les résultats sont spectaculaires. La biodiversité végétale et animale sur le mont Ventoux est, de nos jours, sans doute supérieure à ce qu’elle était il y a deux siècles. Plus de 100 espèces d’oiseaux y nichent, on y croise des sangliers aussi bien que des chevreuils, des cerfs et des chamois. Sans parler de la quinzaine d’espèces de plantes rares d’altitude qui ont fait la réputation du Ventoux sur la scène internationale, telle la campanule des Alpes et la rarissime nivéole de Fabre. Les différents statuts de protection, dont celui de réserve de la biosphère accordé par l’Unesco en 1990 et celui de site Natura 2000 pour le sommet, ont établi une protection durable de ce massif remarquable. Ce qui n’exclut pas une certaine exploitation forestière dans de grandes zones sur la base d’une sylviculture responsable et respectueuse des écosystèmes. Même le pastoralisme, qui est de retour dans quelques communes, continue à maintenir des milieux ouverts intéressants.
Pour un écologiste, la richesse de la forêt du Ventoux est une fête permanente, un plaisir sans cesse renouvelé. Bien sûr, tout n’est pas rose : il y a des zones manifestement dégradées par des installations mal pensées, notamment autour du mont Serein et du chalet Reynard. Il faut espérer des actions correctrices de cette situation. Mais sur le fond, la leçon à en tirer est simple et convaincante : oui, on peut restaurer des écosystèmes, on peut « rebâtir » des forêts et en faire une gestion durable pour les générations à venir.
Merci, François Tichadou, d’avoir eu une vision à long terme pour le Ventoux, merci d’être allé chercher ces cônes semenciers dans les montagnes d’Algérie pour reconstruire le géant de la Provence.
« Nous sommes à la fontaine de la Grave, mince filet d’eau reçu au sortir du sol dans une série de longues auges en troncs de hêtres, où les bergers de la montagne viennent faire boire leurs troupeaux. La température de la source est de sept degrés, fraîcheur inestimable pour nous qui sortons de la fournaise caniculaire de la plaine. »
C’est Jean-Henri Fabre, le grand naturaliste de Sérignan, qui décrit une de ses nombreuses ascensions du Ventoux, vers 1860. La fontaine de la Grave existe toujours, on peut la voir en descendant du sommet du mont Ventoux sur la route départementale 974, dans l’avant-dernier virage avant le chalet Reynard.
À son habitude, Fabre est précis et enthousiaste dans sa description, s’extasiant autant sur les plantes rares qu’il découvre que sur la nourriture hissée à dos d’âne par ses amis (« voici les gigots bourrés d’ ail... et le maître dessert, l’oignon qui se mange cru avec du sel »).
La mention des bergers et de leurs troupeaux nous plonge au cœur de ce qui a le plus changé sur le mont Ventoux. Le couvert végétal que nous voyons aujourd’hui est en effet très différent de celui qu’on voyait, il y a un siècle et demi. C’est le résultat d’un vaste programme de reboisement qui a commencé sur le flanc sud en 1861 et s’est poursuivi pendant près de 70 ans. Quelques années plus tôt en effet, en 1856, des inondations catastrophiques avaient eu lieu dans les bassins de la Loire et du Rhône et l’opinion publique avait poussé les responsables à ouvrir un immense chantier de reboisement sur les versants des montagnes françaises.
Ainsi, contrairement à ce qu’on pense parfois, ce ne sont pas les ravages crées par le broutage intensif des moutons ou bien le déboisement pour la construction des maisons qui a incité l’État à agir, mais plutôt des catastrophes naturelles et leurs conséquences. Il reste cependant que, de 1250, date à laquelle le seigneur Barral des Baux autorisa les habitants de Bédoin « et tous leurs enfants nés et à naître » à couper du bois, défricher la forêt et faire paître leurs bêtes, jusque à cette période de la fin du XIXe siècle, les forêts du Ventoux ont été exploitées, et fort probablement surexploitées selon les critères écologiques, c’est-à-dire au delà de la capacité naturelle de régénération.
Cela ne passa pas inaperçu toutefois, puisque les autorités ont tenté vainement, pendant au moins deux siècles, d’enrayer le phénomène. Il a tout de même fallu que les dommages, sous forme d’inondations et d’érosion dans les piémonts, soient très importants pour que les choses bougent en 1860.
On a donc reboisé massivement et par étage. Il existe en effet un étagement naturel de la végétation selon l’altitude, qui est dû au climat, aux sols et aux expositions.
Sur le versant nord du mont Ventoux où il y a moins de lumière et de fortes pentes, on trouve des plantes caractéristiques des milieux continentaux, en particulier alpins. Sur le flanc sud, la végétation est typiquement méditerranéenne. Toujours est-il que les ingénieurs des Eaux et Forêts ont beaucoup utilisé les essences présentes naturellement, comme le chêne vert, le pin d’Alep et le pin sylvestre, jusqu’à 1 200 m. Au-dessus, ils ont essayé de reboiser avec des hêtres, mais avec moins de succès. En revanche, ils ont introduit massivement deux essences étrangères à la région : le pin noir d’Autriche et le cèdre de l’Atlas. C’est un ingénieur nomme François Tichadou qui a été le premier à introduire le cèdre de l’Atlas sur 15 hectares près de Bédoin, à partir de graines qu’il avait lui-même récoltées dans les massifs de l’Atlas en Algérie. Par dissémination naturelle, cet arbre a magnifiquement colonisé à ce jour près de 400 hectares.
Les travaux préparatoires ont été importants. On a redressé des cours d’eau, et préparé les sols sur de grandes étendues. Pour les chênes, par exemple, il était courant de creuser un trou pour y disposer une centaine de glands, afin d’espérer un bouquet de trois ou quatre arbres. Pour les résineux, on a établi des pépinières sur place et replanté de jeunes pousses. Au total, plus de 8 000 hectares ont été ainsi reboisés. Aujourd’hui, le couvert forestier est d’environ 20 000 hectares et descend pratiquement jusque au pied du massif, à l’exception de la partie sommitale.
Les résultats sont spectaculaires. La biodiversité végétale et animale sur le mont Ventoux est, de nos jours, sans doute supérieure à ce qu’elle était il y a deux siècles. Plus de 100 espèces d’oiseaux y nichent, on y croise des sangliers aussi bien que des chevreuils, des cerfs et des chamois. Sans parler de la quinzaine d’espèces de plantes rares d’altitude qui ont fait la réputation du Ventoux sur la scène internationale, telle la campanule des Alpes et la rarissime nivéole de Fabre. Les différents statuts de protection, dont celui de réserve de la biosphère accordé par l’Unesco en 1990 et celui de site Natura 2000 pour le sommet, ont établi une protection durable de ce massif remarquable. Ce qui n’exclut pas une certaine exploitation forestière dans de grandes zones sur la base d’une sylviculture responsable et respectueuse des écosystèmes. Même le pastoralisme, qui est de retour dans quelques communes, continue à maintenir des milieux ouverts intéressants.
Pour un écologiste, la richesse de la forêt du Ventoux est une fête permanente, un plaisir sans cesse renouvelé. Bien sûr, tout n’est pas rose : il y a des zones manifestement dégradées par des installations mal pensées, notamment autour du mont Serein et du chalet Reynard. Il faut espérer des actions correctrices de cette situation. Mais sur le fond, la leçon à en tirer est simple et convaincante : oui, on peut restaurer des écosystèmes, on peut « rebâtir » des forêts et en faire une gestion durable pour les générations à venir.
Merci, François Tichadou, d’avoir eu une vision à long terme pour le Ventoux, merci d’être allé chercher ces cônes semenciers dans les montagnes d’Algérie pour reconstruire le géant de la Provence.

Cèdres de l’Atlas

Pins sylvestres
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
La salamandre tachetée [ par Brigitte Rochas ]
Avec les jours qui grandissent, le soleil qui devient plus chaud, la nature sort de son sommeil hivernal et certains animaux engourdis par le froid réapparaissent ; les reptiles et les amphibiens sont de ceux-là. La salamandre tachetée a attiré mon attention car depuis quelques années j’ai l’occasion d’en observer un petit groupe.
Cet amphibien urodèle a la morphologie d’un lézard. Sa peau noire et huileuse porte des taches jaunes sur le dos, la forme et la disposition de ces taches constituent la « carte d’identité » de chaque spécimen. Les amphibiens sont des vertébrés à peau nue qui respirent à la fois par la peau et par les poumons.
D’une taille de 17 à 25 centimètres, ces animaux pèsent jusqu’à 150 grammes et peuvent vivre plus de 20 ans.
À l’instar des lézards, la salamandre peut faire repousser un de ses membres ou une partie de son corps perdue lors d’une rencontre malheureuse.
Les vieilles souches en décomposition, les cavernes, les tas de pierres et les amas de feuilles mortes leur offrent un excellent habitat toujours un peu humide où cette espèce trouve les larves, les petits vers, les insectes et les limaces dont les adultes se nourrissent ; c’est son flair qui la guide vers ses proies.
Discrète, de moeurs plutôt nocturnes, on peut l’apercevoir dans la journée après une petite pluie lorsque le vent se fait discret. Son calme olympien, ses mouvements lents et patauds, tout indique qu’elle ne redoute guère les prédateurs que sa livrée colorée repousse : les secrétions de sa peau sont un poison (une neurotoxine inhibitrice du rythme cardiaque) pour les animaux ; malheur à la martre, à la chouette ou au chien qui les avalerait.
L’accouplement a lieu d’avril à septembre. Les femelles, ovovivipares, gardent les oeufs dans leur utérus ; là, ils se métamorphosent en larves. Des 70 oeufs fécondés seule une vingtaine se développera, les plus forts se nourrissant des plus faibles. À la fin de l’hiver, les femelles gravides se rapprochent des points d’eau pour y déposer les larves traversant alors des voies de circulation au risque de se faire écraser. Caractérisées par leurs trois paires de branchies externes plumeuses, elles apprécient l’eau claire des petits ruisseaux où le courant n’est pas trop fort ; elles passent beaucoup de temps cachées sous les pierres, se nourrissent des minuscules animaux aquatiques et pratiquent même le cannibalisme. Quelques mois plus tard, devenues adultes, elles quittent ce milieu et partent sur la terre ferme à la recherche d’un abri.
La répartition géographique de ces amphibiens s’étend de l’Europe du Sud à l’Europe de l’Ouest, de l’Afrique du Nord à l’Extrême Orient ; la salamandre géante du Japon peut mesurer un mètre cinquante.
Autrefois, la salamandre était considérée comme un animal de mauvaise augure. Au Moyen-âge, on la disait capable de tuer d’un regard, d’abuser des femmes, de contaminer le vin ou l’herbe...
Quelques anecdotes à son sujet :
– Lorsqu’au printemps, les bûcherons mettaient le feu aux vieilles souches où elles avaient passé l’hiver ; que pouvaient-elles faire, sinon essayer d’échapper aux flammes ? Selon ces hommes, soit elles naissaient du feu, soit elles y étaient insensibles.
– Un seigneur aurait aussi proposé 100 pièces d’or à quiconque lui ramènerait une salamandre morte.
– La personne mordue par une salamandre devait, pour guérir, consulter autant de médecins que l’animal avait de taches sur le dos.
– Enfin, emblème de l’étendard de François1er, elle symbolisait, selon certains, son ardeur amoureuse .On retrouve la salamandre sculptée sur la porte d’honneur du château d’Amboise et aux plafonds de nombreux châteaux de la Renaissance, Chambord, Fontainebleau. Elle figure aussi dans les armoiries du Havre, de Gennes dans le Maine et Loire, de Sarlat la Cadena et de Vitry le François.
Aujourd’hui, la salamandre tachetée voit son espace vital (biotope) se restreindre à cause des activités humaines : développement de l’agriculture, fragmentation de son habitat, drainage des zones humides.
Depuis 1976, cet animal, comme d’autres amphibiens, fait partie des espèces protégées.
Cet amphibien urodèle a la morphologie d’un lézard. Sa peau noire et huileuse porte des taches jaunes sur le dos, la forme et la disposition de ces taches constituent la « carte d’identité » de chaque spécimen. Les amphibiens sont des vertébrés à peau nue qui respirent à la fois par la peau et par les poumons.
D’une taille de 17 à 25 centimètres, ces animaux pèsent jusqu’à 150 grammes et peuvent vivre plus de 20 ans.
À l’instar des lézards, la salamandre peut faire repousser un de ses membres ou une partie de son corps perdue lors d’une rencontre malheureuse.
Les vieilles souches en décomposition, les cavernes, les tas de pierres et les amas de feuilles mortes leur offrent un excellent habitat toujours un peu humide où cette espèce trouve les larves, les petits vers, les insectes et les limaces dont les adultes se nourrissent ; c’est son flair qui la guide vers ses proies.
Discrète, de moeurs plutôt nocturnes, on peut l’apercevoir dans la journée après une petite pluie lorsque le vent se fait discret. Son calme olympien, ses mouvements lents et patauds, tout indique qu’elle ne redoute guère les prédateurs que sa livrée colorée repousse : les secrétions de sa peau sont un poison (une neurotoxine inhibitrice du rythme cardiaque) pour les animaux ; malheur à la martre, à la chouette ou au chien qui les avalerait.
L’accouplement a lieu d’avril à septembre. Les femelles, ovovivipares, gardent les oeufs dans leur utérus ; là, ils se métamorphosent en larves. Des 70 oeufs fécondés seule une vingtaine se développera, les plus forts se nourrissant des plus faibles. À la fin de l’hiver, les femelles gravides se rapprochent des points d’eau pour y déposer les larves traversant alors des voies de circulation au risque de se faire écraser. Caractérisées par leurs trois paires de branchies externes plumeuses, elles apprécient l’eau claire des petits ruisseaux où le courant n’est pas trop fort ; elles passent beaucoup de temps cachées sous les pierres, se nourrissent des minuscules animaux aquatiques et pratiquent même le cannibalisme. Quelques mois plus tard, devenues adultes, elles quittent ce milieu et partent sur la terre ferme à la recherche d’un abri.
La répartition géographique de ces amphibiens s’étend de l’Europe du Sud à l’Europe de l’Ouest, de l’Afrique du Nord à l’Extrême Orient ; la salamandre géante du Japon peut mesurer un mètre cinquante.
Autrefois, la salamandre était considérée comme un animal de mauvaise augure. Au Moyen-âge, on la disait capable de tuer d’un regard, d’abuser des femmes, de contaminer le vin ou l’herbe...
Quelques anecdotes à son sujet :
– Lorsqu’au printemps, les bûcherons mettaient le feu aux vieilles souches où elles avaient passé l’hiver ; que pouvaient-elles faire, sinon essayer d’échapper aux flammes ? Selon ces hommes, soit elles naissaient du feu, soit elles y étaient insensibles.
– Un seigneur aurait aussi proposé 100 pièces d’or à quiconque lui ramènerait une salamandre morte.
– La personne mordue par une salamandre devait, pour guérir, consulter autant de médecins que l’animal avait de taches sur le dos.
– Enfin, emblème de l’étendard de François1er, elle symbolisait, selon certains, son ardeur amoureuse .On retrouve la salamandre sculptée sur la porte d’honneur du château d’Amboise et aux plafonds de nombreux châteaux de la Renaissance, Chambord, Fontainebleau. Elle figure aussi dans les armoiries du Havre, de Gennes dans le Maine et Loire, de Sarlat la Cadena et de Vitry le François.
Aujourd’hui, la salamandre tachetée voit son espace vital (biotope) se restreindre à cause des activités humaines : développement de l’agriculture, fragmentation de son habitat, drainage des zones humides.
Depuis 1976, cet animal, comme d’autres amphibiens, fait partie des espèces protégées.

Têtard

Couple
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
La huppe [ par Brigitte Rochas ]
Dès la fin février, on peut entendre une musique particulière « houp, houp, houp » ; ce chant original signale le retour de la huppe fasciée dans notre région. Si le chant est caractéristique de l'espèce, le plumage l'est encore davantage.
De couleur rose orangé pour le corps, les ailes sont rayées de noir et blanc, mais c'est la tête qui retient l'attention avec sa huppe érectile colorée dont les pointes sont noires ; cette dernière, très mobile, est presque toujours en mouvement, elle est d'ailleurs à l'origine du nom donné à l'oiseau.
Ce migrateur de taille moyenne, 28 centimètres, est le seul représentant de la famille des upupidés.
Son envergure peut atteindre 45 centimètres et son vol saccadé et bondissant ressemble beaucoup à celui d'un papillon. Il pèse de 50 à 80 grammes et peut vivre onze ans.
Au retour d'Afrique où ils passent la saison froide, les couples reviennent généralement s'installer dans le même quartier ; ils choisissent l'anfractuosité d'un vieil arbre, un nid de pic abandonné ou l'abri de la toiture d'une ferme, d'une bergerie pour faire un nid sommaire où la femelle pond de cinq à sept œufs gris brun parfois tachetés de blanc. La couvaison dure 18 jours, la mère ne quitte pas son nid, le mâle se charge de la nourrir pendant cette période ; les parents élèvent les petits ensembles, mais ne se chargent pas de l'évacuation des défécations de leur progéniture ; cette odeur nauséabonde sert même à décourager les prédateurs et si, par hasard, un intrus ose s'approcher, les jeunes se retournent et n'hésitent pas à envoyer leur fiente dans sa direction. Les oisillons prennent leur envol au bout de trois ou quatre semaines ; la famille reprend la route de l'Afrique dès la fin août.
Le long bec effilé et arqué de la huppe lui permet de fouiller le sol pour trouver sa nourriture : larves, insectes, sauterelles, criquets, araignées, limaces, scarabées, grillons, fourmis et parfois des insectes en vol.
Son habitat préféré est un espace ouvert dans lequel les haies et les champs offrent toutes les ressources nécessaires à son alimentation.
Sa répartition géographique s'étend de l'Europe du Sud à la partie méridionale de la Russie. Elle n'est pas chassée sauf en Roumanie et à Malte.
Dans quelques régions d'Afrique du Nord, la huppe est capturée, car certaines parties de son corps sont utilisées pour des pratiques médicales ou magiques.
Cet oiseau est connu depuis l'Antiquité puisqu'on trouve de nombreux dessins la représentant en Égypte et en Turquie.
Depuis 2008, la huppe fasciée est l'oiseau national d'Israël.
De couleur rose orangé pour le corps, les ailes sont rayées de noir et blanc, mais c'est la tête qui retient l'attention avec sa huppe érectile colorée dont les pointes sont noires ; cette dernière, très mobile, est presque toujours en mouvement, elle est d'ailleurs à l'origine du nom donné à l'oiseau.
Ce migrateur de taille moyenne, 28 centimètres, est le seul représentant de la famille des upupidés.
Son envergure peut atteindre 45 centimètres et son vol saccadé et bondissant ressemble beaucoup à celui d'un papillon. Il pèse de 50 à 80 grammes et peut vivre onze ans.
Au retour d'Afrique où ils passent la saison froide, les couples reviennent généralement s'installer dans le même quartier ; ils choisissent l'anfractuosité d'un vieil arbre, un nid de pic abandonné ou l'abri de la toiture d'une ferme, d'une bergerie pour faire un nid sommaire où la femelle pond de cinq à sept œufs gris brun parfois tachetés de blanc. La couvaison dure 18 jours, la mère ne quitte pas son nid, le mâle se charge de la nourrir pendant cette période ; les parents élèvent les petits ensembles, mais ne se chargent pas de l'évacuation des défécations de leur progéniture ; cette odeur nauséabonde sert même à décourager les prédateurs et si, par hasard, un intrus ose s'approcher, les jeunes se retournent et n'hésitent pas à envoyer leur fiente dans sa direction. Les oisillons prennent leur envol au bout de trois ou quatre semaines ; la famille reprend la route de l'Afrique dès la fin août.
Le long bec effilé et arqué de la huppe lui permet de fouiller le sol pour trouver sa nourriture : larves, insectes, sauterelles, criquets, araignées, limaces, scarabées, grillons, fourmis et parfois des insectes en vol.
Son habitat préféré est un espace ouvert dans lequel les haies et les champs offrent toutes les ressources nécessaires à son alimentation.
Sa répartition géographique s'étend de l'Europe du Sud à la partie méridionale de la Russie. Elle n'est pas chassée sauf en Roumanie et à Malte.
Dans quelques régions d'Afrique du Nord, la huppe est capturée, car certaines parties de son corps sont utilisées pour des pratiques médicales ou magiques.
Cet oiseau est connu depuis l'Antiquité puisqu'on trouve de nombreux dessins la représentant en Égypte et en Turquie.
Depuis 2008, la huppe fasciée est l'oiseau national d'Israël.

La huppe fasciée
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
Les ocres de Roussillon [ par Brigitte Rochas ]
La diversité des paysages du Vaucluse attire de nombreux visiteurs dans notre département. Des bords du Rhône au Mont Ventoux, du comtat Venaissin à l'Enclave des Papes, du Lubéron à la plaine de la Durance, les curiosités ne manquent pas.
Les bancs de calcaire blanc coiffés par le vert des arbres à feuilles persistantes, chênes verts et pins, caractérisent les monts de Vaucluse et le Lubéron.
Près de là, la géologie est à l'origine d'une formation particulière : le village de Roussillon et ses environs ressemblent à une carte postale tant par ses couleurs que par son relief. Bien sûr, ce que l'on voit aujourd'hui raconte l'histoire du pays à travers les millénaires, mais aussi celle des hommes qui ont exploité cette richesse depuis le milieu du XIXe siècle.
Les falaises de Roussillon sont connues pour leur diversité de coloris : du jaune clair au rouge foncé, de l'orangé au brun, parfois du rose au violet jusqu'au vert et au gris. Si sous le soleil c'est un éblouissement, la pluie, elle, ne fait qu'augmenter l'intensité des couleurs.
La force et la violence de juxtaposition de ces teintes ont donné naissance à quelques légendes.
L'une raconte que ces terres sont teintées par le sang des anges déchus lors de leur combat contre l'archange Gabriel.
Une autre dit ceci : Sirmonde, épouse délaissée du terrible Raymond de Roussillon, aimait un jeune troubadour ; fou de jalousie, le châtelain tua son rival d'un coup de dague, préleva son cœur et après l'avoir fait préparé, il le fit déguster par sa femme qui trouva le mets délicieux. Apprenant la vérité, elle se jeta du haut des falaises qui se teintèrent alors de son sang.
Plus sérieusement, quelle est l'origine de ces couleurs ? Comment sont-elles apparues ?
Il y a des millions d'années, la mer recouvrait la Provence ; pendant une longue période, des débris organiques, végétaux et minéraux arrachés à l'environnement s'accumulèrent sur une épaisseur de trente mètres.
Lors du plissement alpin, la mer s'est retirée mettant à jour les sédiments déposés au fond de l'eau.
Ces sédiments sablonneux sont constitués pour plus de 80 % de silice (quartz) ; ils contiennent aussi d'autres éléments minéraux à l'origine de l'apparition des ocres : de l'argile ou kaolinite pure, teintée par des oxydes de fer dont le coloris varie selon le degré d'hydratation, de faibles quantités de manganèse, de zinc, d'aluminium, de mercure, de plomb et de carbonate de calcium.
La combinaison de ces différents éléments à travers les siècles fait naitre le large éventail des pigments disponibles actuellement, vingt-quatre selon les spécialistes en la matière.
Depuis la préhistoire et sur tous les continents, les hommes ont utilisé les pigments présents dans leur environnement pour laisser des traces des évènements importants de leur histoire, de leurs croyances philosophiques ou religieuses comme en témoignent les peintures rupestres des grottes Lascaux et Chauvet chez nous, les dessins aborigènes d'Uluru en Australie et ceux découverts dans le Hoggar en Afrique ou encore dans le sud-est de la Chine.
Dans la région de Roussillon, l'exploitation de cette ressource a débuté au XIXe siècle. L'extraction des pigments colorés des ocres était réalisée par lévigation afin de prélever les particules légères dispersées à la surface de l'eau. La Doa, rivière locale, fournit toute l'eau nécessaire.
Après séchage, cuisson, broyage et conditionnement, les pigments étaient prêts pour la commercialisation. Cette exploitation industrielle a amené son lot de nuisances : décès de mineurs, villages et maisons envahis par une poussière très fine.
Ces pigments sont de nos jours très utilisés dans le bâtiment, les arts picturaux et la décoration.
Deux sentiers balisés sont accessibles à tous à Roussillon, mais toute la région recèle de nombreuses curiosités : Gargas, le Colorado de Rustrel (miniature du canyon du Colorado américain), Bédoin et ses cheminées de fée.
Les bancs de calcaire blanc coiffés par le vert des arbres à feuilles persistantes, chênes verts et pins, caractérisent les monts de Vaucluse et le Lubéron.
Près de là, la géologie est à l'origine d'une formation particulière : le village de Roussillon et ses environs ressemblent à une carte postale tant par ses couleurs que par son relief. Bien sûr, ce que l'on voit aujourd'hui raconte l'histoire du pays à travers les millénaires, mais aussi celle des hommes qui ont exploité cette richesse depuis le milieu du XIXe siècle.
Les falaises de Roussillon sont connues pour leur diversité de coloris : du jaune clair au rouge foncé, de l'orangé au brun, parfois du rose au violet jusqu'au vert et au gris. Si sous le soleil c'est un éblouissement, la pluie, elle, ne fait qu'augmenter l'intensité des couleurs.
La force et la violence de juxtaposition de ces teintes ont donné naissance à quelques légendes.
L'une raconte que ces terres sont teintées par le sang des anges déchus lors de leur combat contre l'archange Gabriel.
Une autre dit ceci : Sirmonde, épouse délaissée du terrible Raymond de Roussillon, aimait un jeune troubadour ; fou de jalousie, le châtelain tua son rival d'un coup de dague, préleva son cœur et après l'avoir fait préparé, il le fit déguster par sa femme qui trouva le mets délicieux. Apprenant la vérité, elle se jeta du haut des falaises qui se teintèrent alors de son sang.
Plus sérieusement, quelle est l'origine de ces couleurs ? Comment sont-elles apparues ?
Il y a des millions d'années, la mer recouvrait la Provence ; pendant une longue période, des débris organiques, végétaux et minéraux arrachés à l'environnement s'accumulèrent sur une épaisseur de trente mètres.
Lors du plissement alpin, la mer s'est retirée mettant à jour les sédiments déposés au fond de l'eau.
Ces sédiments sablonneux sont constitués pour plus de 80 % de silice (quartz) ; ils contiennent aussi d'autres éléments minéraux à l'origine de l'apparition des ocres : de l'argile ou kaolinite pure, teintée par des oxydes de fer dont le coloris varie selon le degré d'hydratation, de faibles quantités de manganèse, de zinc, d'aluminium, de mercure, de plomb et de carbonate de calcium.
La combinaison de ces différents éléments à travers les siècles fait naitre le large éventail des pigments disponibles actuellement, vingt-quatre selon les spécialistes en la matière.
Depuis la préhistoire et sur tous les continents, les hommes ont utilisé les pigments présents dans leur environnement pour laisser des traces des évènements importants de leur histoire, de leurs croyances philosophiques ou religieuses comme en témoignent les peintures rupestres des grottes Lascaux et Chauvet chez nous, les dessins aborigènes d'Uluru en Australie et ceux découverts dans le Hoggar en Afrique ou encore dans le sud-est de la Chine.
Dans la région de Roussillon, l'exploitation de cette ressource a débuté au XIXe siècle. L'extraction des pigments colorés des ocres était réalisée par lévigation afin de prélever les particules légères dispersées à la surface de l'eau. La Doa, rivière locale, fournit toute l'eau nécessaire.
Après séchage, cuisson, broyage et conditionnement, les pigments étaient prêts pour la commercialisation. Cette exploitation industrielle a amené son lot de nuisances : décès de mineurs, villages et maisons envahis par une poussière très fine.
Ces pigments sont de nos jours très utilisés dans le bâtiment, les arts picturaux et la décoration.
Deux sentiers balisés sont accessibles à tous à Roussillon, mais toute la région recèle de nombreuses curiosités : Gargas, le Colorado de Rustrel (miniature du canyon du Colorado américain), Bédoin et ses cheminées de fée.

Une des falaises des ocres de Roussillon

Le sentier balisé pour la visite des ocres de Roussillon
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Tout le monde connaît le Condor des Andes, celui de la chanson, l'oiseau roi de la Cordillère. Il fait partie de la famille des vautours. Répandu dans toute l'Amérique latine, il n'est pas menacé de disparition, même s'il est en nette diminution dans certaines régions. Par contre, il a un cousin en Amérique du Nord, qui est rare et menacé. C'est le Condor de Californie. En 1982, il n'en restait que 21 dans la nature.
Aujourd'hui, grâce à un programme du gouvernement américain, ils sont plus de 300, répartis en deux populations, une en Arizona et l'autre en Californie.
Un matin de décembre, il y a trois ans, j'ai passé une matinée mémorable à attendre l'arrivée des condors. Nous étions à la réserve de Bitter Creek, à deux heures de route au nord de Los Angeles. Ce coin de pays, fait de hauts plateaux entrecoupés par de profonds canyons, est le domaine vital d'une cinquantaine de vautours qui, tous, ont été réintroduits dans la nature à partir d'élevage en zoo.
Ce jour-là, nous nous sommes levés tôt et nous avons attendu longtemps. Très longtemps, même. Le biologiste Jesse Grantham, que nous accompagnions, nous avait conduits à l'aube en camion en haut d'un canyon. Munis de jumelles, nous scrutions le ciel : pas de trace de condors. Au début, il y avait une légère brume dans la vallée en contrebas et nous savions que ce n'était pas bon signe pour les condors. Quand la brume s'est déchirée, il n'y avait toujours rien à voir. Pour Jesse, il était encore trop tôt pour voir ses protégés en action. Pour prendre leur envol, les condors ont besoin d'air chaud. Ce matin-là, il faisait un peu trop froid. Toutefois, avec son appareil de télémétrie, Jesse avait repéré deux groupes au repos au sommet de grands pins à environ trois kilomètres de là. Il pointait ses jumelles et hochait la tête en disant qu'il les voyait, mais moi je ne distinguais rien.
Et puis, ils sont apparus. D'abord assez loin sur la droite, là où l’on ne les attendait pas, au sommet d'une falaise. Ils tournaient dans les airs et tentaient de s'élever, mais ne semblaient pas y parvenir. « C'est en fait très simple, dit Jesse. Ils font constamment des cercles, cherchant les courants d'air chaud. S'il y en a un qui réussit, les autres se placent à cet endroit et ils font la même chose ». Ce jour-là, une douzaine de grands vautours sont sortis. Ils sont restés à planer au-dessus des contreforts les plus exposés au soleil et ne sont pas remontés tout en haut du canyon. Mais à la fin, ils étaient assez près pour qu'on puisse admirer leurs silhouettes d'un noir quasi absolu, aux longues ailes. Une envergure de près de trois mètres, un grand maître des vents, un roi du vol plané.
Pourquoi est-ce que je raconte tout cela ? Parce qu'il se trouve que nous avons tout près de nous de magnifiques vautours, eux aussi issus d'un programme de réintroduction, et qui mériteraient d'être tout aussi célèbres. Ce sont les vautours des Baronnies, que l'on peut voir tout autour de Rémuzat. Le cœur de la colonie se trouve dans les gorges de l'Eygues, entre Saint-May et Rémuzat, et plusieurs circuits de randonnée pédestre permettent de les découvrir. Les non-marcheurs peuvent même les observer depuis la place du village à Rémuzat, près de l'office du tourisme, qui diffuse de précieuses informations sur l'association « Vautours en Baronnies ».
C'est en 1987 qu'est née l'idée d'un programme de réintroduction des vautours fauves et moines. Ils avaient auparavant quasiment disparu. Deux causes distinctes y avaient contribué : le poison utilisé lors des campagnes de destruction du loup et de l'ours, et la loi sur l'équarrissage, interdisant aux éleveurs de déposer les cadavres d'animaux d'élevage dans la nature. La présence des vautours, en fait, remonte à fort longtemps et a toujours été liée au pastoralisme. Les moutons ouvrent le paysage, empêchant la colonisation par les arbres. Cela facilite le travail du vautour qui, du haut des airs, survole ces terrains à la recherche de cadavres de petits ou de gros mammifères. À plusieurs, et parfois à plusieurs espèces, puisque le vautour fauve et le vautour moine ne mangent pas les mêmes parties. Ces animaux sont extraordinairement efficaces pour dépecer un cadavre de mouton. Cela limite entre autres la propagation des virus, donc des maladies animales.
Le vautour fauve, Gyps fulvus, a une envergure qui peut atteindre 2,80 mètres ; corps fauve, tête blanche, il vit en colonies et utilise les falaises pour se reposer ou pour construire son nid. C'est pour lui qu'on a conçu ce programme de réintroduction. Depuis 1996, environ 80 individus ont été relâchés et se sont bien adaptés à la vie dans la nature. Le vautour moine, Ægypius monachus, un peu plus grand, a quant à lui une sorte de tonsure sur la tête qui lui confère son nom. Mais ce n'est pas facile de l'apercevoir. Lui, il niche en « colonies lâches » dans des arbres. Ces oiseaux vivent très longtemps, près de 50 ans. Avec le succès remarquable de ce programme de réintroduction, on a eu la surprise de voir revenir dans les baronnies le petit vautour percnoptère, Neophron percnopterus. Il est noir et blanc, avec une belle tête jaune, un peu hirsute.
Contrairement aux deux autres, c'est un oiseau migrateur. Il passe l'hiver en Afrique et est présent dans les Baronnies de mars à septembre.
Vraiment, c'est un spectacle naturel grandiose que de voir évoluer dans le ciel des Baronnies ces magnifiques oiseaux. Et puis, vos chances de les voir n'importe quel jour de l'année en vous pointant à Rémuzat (jumelles conseillées) sont bien plus grandes que celles de voir des condors, pour un Californien. En plus, le coin est magnifique pour les balades. Mes préférées ? J'aime monter directement sur le Plateau Saint-Laurent au-dessus de Rémuzat, qu'on aborde par le village de Saint-May (parking pour promeneurs au bout de la route de terre). Autre option : en partant du centre de Rémuzat, on peut monter au rocher du Caire (775 mètres) en une boucle d'environ 2 heures 30. Enfin, un autre sentier vous conduit à l'opposé, vers la montagne qui fait face au rocher du Caire. En cas de doute, se renseigner à la bien nommée « Maison des vautours », place du Champ de Mars à Rémuzat, au 04 75 27 85 71.
Aujourd'hui, grâce à un programme du gouvernement américain, ils sont plus de 300, répartis en deux populations, une en Arizona et l'autre en Californie.
Un matin de décembre, il y a trois ans, j'ai passé une matinée mémorable à attendre l'arrivée des condors. Nous étions à la réserve de Bitter Creek, à deux heures de route au nord de Los Angeles. Ce coin de pays, fait de hauts plateaux entrecoupés par de profonds canyons, est le domaine vital d'une cinquantaine de vautours qui, tous, ont été réintroduits dans la nature à partir d'élevage en zoo.
Ce jour-là, nous nous sommes levés tôt et nous avons attendu longtemps. Très longtemps, même. Le biologiste Jesse Grantham, que nous accompagnions, nous avait conduits à l'aube en camion en haut d'un canyon. Munis de jumelles, nous scrutions le ciel : pas de trace de condors. Au début, il y avait une légère brume dans la vallée en contrebas et nous savions que ce n'était pas bon signe pour les condors. Quand la brume s'est déchirée, il n'y avait toujours rien à voir. Pour Jesse, il était encore trop tôt pour voir ses protégés en action. Pour prendre leur envol, les condors ont besoin d'air chaud. Ce matin-là, il faisait un peu trop froid. Toutefois, avec son appareil de télémétrie, Jesse avait repéré deux groupes au repos au sommet de grands pins à environ trois kilomètres de là. Il pointait ses jumelles et hochait la tête en disant qu'il les voyait, mais moi je ne distinguais rien.
Et puis, ils sont apparus. D'abord assez loin sur la droite, là où l’on ne les attendait pas, au sommet d'une falaise. Ils tournaient dans les airs et tentaient de s'élever, mais ne semblaient pas y parvenir. « C'est en fait très simple, dit Jesse. Ils font constamment des cercles, cherchant les courants d'air chaud. S'il y en a un qui réussit, les autres se placent à cet endroit et ils font la même chose ». Ce jour-là, une douzaine de grands vautours sont sortis. Ils sont restés à planer au-dessus des contreforts les plus exposés au soleil et ne sont pas remontés tout en haut du canyon. Mais à la fin, ils étaient assez près pour qu'on puisse admirer leurs silhouettes d'un noir quasi absolu, aux longues ailes. Une envergure de près de trois mètres, un grand maître des vents, un roi du vol plané.
Pourquoi est-ce que je raconte tout cela ? Parce qu'il se trouve que nous avons tout près de nous de magnifiques vautours, eux aussi issus d'un programme de réintroduction, et qui mériteraient d'être tout aussi célèbres. Ce sont les vautours des Baronnies, que l'on peut voir tout autour de Rémuzat. Le cœur de la colonie se trouve dans les gorges de l'Eygues, entre Saint-May et Rémuzat, et plusieurs circuits de randonnée pédestre permettent de les découvrir. Les non-marcheurs peuvent même les observer depuis la place du village à Rémuzat, près de l'office du tourisme, qui diffuse de précieuses informations sur l'association « Vautours en Baronnies ».
C'est en 1987 qu'est née l'idée d'un programme de réintroduction des vautours fauves et moines. Ils avaient auparavant quasiment disparu. Deux causes distinctes y avaient contribué : le poison utilisé lors des campagnes de destruction du loup et de l'ours, et la loi sur l'équarrissage, interdisant aux éleveurs de déposer les cadavres d'animaux d'élevage dans la nature. La présence des vautours, en fait, remonte à fort longtemps et a toujours été liée au pastoralisme. Les moutons ouvrent le paysage, empêchant la colonisation par les arbres. Cela facilite le travail du vautour qui, du haut des airs, survole ces terrains à la recherche de cadavres de petits ou de gros mammifères. À plusieurs, et parfois à plusieurs espèces, puisque le vautour fauve et le vautour moine ne mangent pas les mêmes parties. Ces animaux sont extraordinairement efficaces pour dépecer un cadavre de mouton. Cela limite entre autres la propagation des virus, donc des maladies animales.
Le vautour fauve, Gyps fulvus, a une envergure qui peut atteindre 2,80 mètres ; corps fauve, tête blanche, il vit en colonies et utilise les falaises pour se reposer ou pour construire son nid. C'est pour lui qu'on a conçu ce programme de réintroduction. Depuis 1996, environ 80 individus ont été relâchés et se sont bien adaptés à la vie dans la nature. Le vautour moine, Ægypius monachus, un peu plus grand, a quant à lui une sorte de tonsure sur la tête qui lui confère son nom. Mais ce n'est pas facile de l'apercevoir. Lui, il niche en « colonies lâches » dans des arbres. Ces oiseaux vivent très longtemps, près de 50 ans. Avec le succès remarquable de ce programme de réintroduction, on a eu la surprise de voir revenir dans les baronnies le petit vautour percnoptère, Neophron percnopterus. Il est noir et blanc, avec une belle tête jaune, un peu hirsute.
Contrairement aux deux autres, c'est un oiseau migrateur. Il passe l'hiver en Afrique et est présent dans les Baronnies de mars à septembre.
Vraiment, c'est un spectacle naturel grandiose que de voir évoluer dans le ciel des Baronnies ces magnifiques oiseaux. Et puis, vos chances de les voir n'importe quel jour de l'année en vous pointant à Rémuzat (jumelles conseillées) sont bien plus grandes que celles de voir des condors, pour un Californien. En plus, le coin est magnifique pour les balades. Mes préférées ? J'aime monter directement sur le Plateau Saint-Laurent au-dessus de Rémuzat, qu'on aborde par le village de Saint-May (parking pour promeneurs au bout de la route de terre). Autre option : en partant du centre de Rémuzat, on peut monter au rocher du Caire (775 mètres) en une boucle d'environ 2 heures 30. Enfin, un autre sentier vous conduit à l'opposé, vers la montagne qui fait face au rocher du Caire. En cas de doute, se renseigner à la bien nommée « Maison des vautours », place du Champ de Mars à Rémuzat, au 04 75 27 85 71.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
La lavande [ par Brigitte Rochas ]
Dès le début de l'été, les paysages de notre région se parent des couleurs si caractéristiques de la campagne de Haute-Provence ; les champs de lavande aux tons bleu-violet voisinent avec les champs de céréales d'un beau jaune doré et les taches vert-sombre des arbres. À ce tableau s'ajoutent les senteurs apportées par le vent.
Il y a des siècles, les Romains utilisaient déjà les fleurs de lavande pour parfumer le linge et le bain. Le mot lavande vient d'ailleurs de lavare, laver en latin.
En France, la lavande se cultive dans les Alpes de Haute-Provence autour de Digne et de Valensole, dans le sud de la Drôme : dans les Baronnies avec la ville de Buis, dans le Tricastin à Grignan, dans les Hautes-Alpes autour de Gap, enfin dans le Vaucluse aux environs de Sault, sur les pentes du mont Ventoux et dans l'enclave des Papes à Valréas. Au Canada, en Europe de l'Est et en Tasmanie, on rencontre aussi des champs de lavande.
Derrière ce que nous appelons « lavande » se cachent différentes espèces de plantes. Toutes appartiennent à la famille des labiées et se présentent sous forme d'arbustes pouvant atteindre un mètre de hauteur. Un terrain calcaire, sec, caillouteux et ensoleillé, leur convient très bien. Toutes sont très mellifères et régulièrement fréquentées par les abeilles.
La lavande papillon (Lavandula stoechas), très décorative, se rencontre fréquemment à l'état sauvage sur un vaste territoire ; elle ne présente pas un grand intérêt en parfumerie.
La lavande fine officinale (Lavandula angustifolia) que l'on rencontre encore quelquefois à l'état sauvage en moyenne montagne entre 600 et 1 400 mètres d'altitude. Sa culture recouvre environ 4 000 hectares. On la reconnaît à ses petites feuilles grises, à ses fleurs d'un bleu très caractéristique, à son parfum frais, vert et légèrement camphré. Le renouvellement des plantations peut se faire par semis. Son huile essentielle (15 kilogrammes d'huile à l'hectare) est utilisée en aromathérapie pour ses propriétés antispasmodiques (crampes), calmantes contre le stress et l'insomnie, la douleur (rhumatisme ou arthrite). Son action antiseptique lutte contre les affections des voies respiratoires en inhalation. Elle favorise la résolution de nombreux problèmes cutanés : dermatoses, eczéma, cicatrisation des plaies. Enfin elle repousse les attaques de moustiques et autres insectes, dont les mites. L'huile de lavande fine est prisée aussi en cosmétique et en parfumerie. Elle est la seule à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée.
À Sault et à Mévouillon, pousse une lavande fine particulièrement bleue utilisée pour réaliser les bouquets et les sachets très appréciés des visiteurs de la région.
L'aspic (Lavandula latifolia) à la floraison plus tardive, aux feuilles plus larges, très odorantes, aux fleurs disposées en trois brins, a une odeur très camphrée.
Le lavandin, ou lavande hybride, hybride spontané de Lavandula angustifolia et de Lavandula latifolia, a été découvert en 1930. Il se plaît jusqu’à 600 mètres d’altitude. Ses quatre variétés (Grosso, Abrial, Sumian et Super) très résistantes se répartissent sur 17 000 hectares. L'essence de lavandin trouve de nombreux débouchés en parfumerie industrielle.
Le développement de la parfumerie dans le pays grassois, une meilleure répartition des distilleries et l’amélioration des voies de communication ont favorisé la culture du lavandin dans les années cinquante, supplantant alors celle de la lavande fine.
Les jeunes plants de lavandin sont obtenus par bouturage en pleine terre, ce qui induit plus d’homogénéité dans l'évolution et la floraison de la plante et facilite la mécanisation de la culture. La durée de rentabilité d'un champ est de l'ordre de huit ans.
L'extraction de l'essence de lavande est réalisée par distillation, passage de vapeur d'eau au travers des fleurs coupées, selon deux procédés un peu différents : « broyage vert » à partir de la récolte fraîchement coupée ou distillation tardive de la récolte séchée en plein air.
Autrefois, la récolte manuelle à la faucille avait lieu aux heures chaudes de juillet et d'août, afin que l'élévation diurne de la température favorise la montée de l'essence dans les sommités florales. Aujourd'hui, toutes les activités sont réalisées mécaniquement de la plantation à la cueillette.
Si la lavande et le lavandin ne sont pas très exigeants, ils sont néanmoins exposés à l'agression d'insectes tels que la cécidomyie et la méligèthe.
La fleur de lavande possède son message dans le langage des fleurs : « répondez-moi ». En France, elle symbolise le 46e anniversaire de mariage. Émile Zola, écrivain méridional, a écrit : « Mais les fenêtres restaient grandes ouvertes sur le vaste ciel d’été, le vent du soir entrait, brûlant encore, chargé d’une lointaine odeur de lavande ».
Il y a des siècles, les Romains utilisaient déjà les fleurs de lavande pour parfumer le linge et le bain. Le mot lavande vient d'ailleurs de lavare, laver en latin.
En France, la lavande se cultive dans les Alpes de Haute-Provence autour de Digne et de Valensole, dans le sud de la Drôme : dans les Baronnies avec la ville de Buis, dans le Tricastin à Grignan, dans les Hautes-Alpes autour de Gap, enfin dans le Vaucluse aux environs de Sault, sur les pentes du mont Ventoux et dans l'enclave des Papes à Valréas. Au Canada, en Europe de l'Est et en Tasmanie, on rencontre aussi des champs de lavande.
Derrière ce que nous appelons « lavande » se cachent différentes espèces de plantes. Toutes appartiennent à la famille des labiées et se présentent sous forme d'arbustes pouvant atteindre un mètre de hauteur. Un terrain calcaire, sec, caillouteux et ensoleillé, leur convient très bien. Toutes sont très mellifères et régulièrement fréquentées par les abeilles.
La lavande papillon (Lavandula stoechas), très décorative, se rencontre fréquemment à l'état sauvage sur un vaste territoire ; elle ne présente pas un grand intérêt en parfumerie.
La lavande fine officinale (Lavandula angustifolia) que l'on rencontre encore quelquefois à l'état sauvage en moyenne montagne entre 600 et 1 400 mètres d'altitude. Sa culture recouvre environ 4 000 hectares. On la reconnaît à ses petites feuilles grises, à ses fleurs d'un bleu très caractéristique, à son parfum frais, vert et légèrement camphré. Le renouvellement des plantations peut se faire par semis. Son huile essentielle (15 kilogrammes d'huile à l'hectare) est utilisée en aromathérapie pour ses propriétés antispasmodiques (crampes), calmantes contre le stress et l'insomnie, la douleur (rhumatisme ou arthrite). Son action antiseptique lutte contre les affections des voies respiratoires en inhalation. Elle favorise la résolution de nombreux problèmes cutanés : dermatoses, eczéma, cicatrisation des plaies. Enfin elle repousse les attaques de moustiques et autres insectes, dont les mites. L'huile de lavande fine est prisée aussi en cosmétique et en parfumerie. Elle est la seule à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée.
À Sault et à Mévouillon, pousse une lavande fine particulièrement bleue utilisée pour réaliser les bouquets et les sachets très appréciés des visiteurs de la région.
L'aspic (Lavandula latifolia) à la floraison plus tardive, aux feuilles plus larges, très odorantes, aux fleurs disposées en trois brins, a une odeur très camphrée.
Le lavandin, ou lavande hybride, hybride spontané de Lavandula angustifolia et de Lavandula latifolia, a été découvert en 1930. Il se plaît jusqu’à 600 mètres d’altitude. Ses quatre variétés (Grosso, Abrial, Sumian et Super) très résistantes se répartissent sur 17 000 hectares. L'essence de lavandin trouve de nombreux débouchés en parfumerie industrielle.
Le développement de la parfumerie dans le pays grassois, une meilleure répartition des distilleries et l’amélioration des voies de communication ont favorisé la culture du lavandin dans les années cinquante, supplantant alors celle de la lavande fine.
Les jeunes plants de lavandin sont obtenus par bouturage en pleine terre, ce qui induit plus d’homogénéité dans l'évolution et la floraison de la plante et facilite la mécanisation de la culture. La durée de rentabilité d'un champ est de l'ordre de huit ans.
L'extraction de l'essence de lavande est réalisée par distillation, passage de vapeur d'eau au travers des fleurs coupées, selon deux procédés un peu différents : « broyage vert » à partir de la récolte fraîchement coupée ou distillation tardive de la récolte séchée en plein air.
Autrefois, la récolte manuelle à la faucille avait lieu aux heures chaudes de juillet et d'août, afin que l'élévation diurne de la température favorise la montée de l'essence dans les sommités florales. Aujourd'hui, toutes les activités sont réalisées mécaniquement de la plantation à la cueillette.
Si la lavande et le lavandin ne sont pas très exigeants, ils sont néanmoins exposés à l'agression d'insectes tels que la cécidomyie et la méligèthe.
La fleur de lavande possède son message dans le langage des fleurs : « répondez-moi ». En France, elle symbolise le 46e anniversaire de mariage. Émile Zola, écrivain méridional, a écrit : « Mais les fenêtres restaient grandes ouvertes sur le vaste ciel d’été, le vent du soir entrait, brûlant encore, chargé d’une lointaine odeur de lavande ».


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Le kaki [ par Brigitte Rochas ]
Dès que l'automne arrive dans nos jardins, les végétaux se parent de couleurs allant du vert au brun en passant par le jaune, l'orange, le roux ou le bordeaux. Plus tard, les premières gelées hivernales et le mistral emportent les feuilles sèches laissant les branches et les troncs nus ; pourtant un arbre porte de beaux fruits orange, c'est le plaqueminier ou kaki.
Cet arbre, de la famille des ébénacées, est originaire des pays chauds d'Extrême-Orient, la Chine et le Japon, même si une espèce de ce végétal pousse en Virginie en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs de leur pays d'origine que viennent les noms désignant cet arbre. Au Japon, kaki désigne à la fois l'arbre et le fruit alors que plaquemine et plaqueminier trouvent leur origine dans le mot algonquin1, des autochtones de Virginie, piakimina ; enfin, en botanique, on utilise le terme de « diospyros kaki ».
Cultivé en Chine depuis 1300, au Japon depuis 1850, il se répand dans les régions chaudes à la suite des voyages réalisés par les explorateurs. Joseph Banks, botaniste du capitaine Cook, l'introduit en Europe. Le kaki ou plaqueminier se plaît dans les zones où poussent l'olivier et le figuier où sa culture commence vers le milieu du XIXe siècle.
Cet arbre, haut de 12 mètres, porte de grandes feuilles caduques entières, d'un beau vert brillant sur le dessus et « tomenteuses2 dessous », feuilles qui prennent une belle teinte rouge avant de tomber. L'écorce est grise et craquelée. Les fleurs d'un blanc jaunâtre se forment sur les pousses de l'année en juin et juillet. Un même sujet peut porter des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les insectes se chargent de la pollinisation, une fleur femelle non fécondée donne un fruit sans pépins.
Le fruit, kaki ou plaquemine, est une grosse baie globuleuse dont la forme rappelle celle de la tomate, de 5 à 10 cm de diamètre. La peau fine est recouverte d'une pruine3, la chair juteuse, légèrement fibreuse, est sucrée à maturité. D'un goût âpre et astringent dû à sa richesse en tannin avant maturité, on le dit meilleur après les premières gelées lorsqu'il devient blet. Il est très riche en glucose (20 %), en vitamine C, en provitamine A, en sels minéraux et en phénols ; il est donc très utile dans la prévention des maladies cardio-vasculaires.
On le consomme nature, en confiture, en dessert ou séché comme les figues.
Il existe aujourd'hui différents cultivars4 : sharon, fuyu, etc. ; certains, à fort développement donnent des fruits sans pépins, au goût moins astringent, que l'on croque comme une pomme ; ils arrivent d'Espagne, d'Israël ou d'Afrique du Sud.
Il se multiplie essentiellement par greffe, le meilleur porte-greffe étant l'espèce d'origine virginienne.
De culture facile, il a besoin d'un arrosage régulier pendant sa première année (un jour sur deux). Très résistant, il supporte des températures de -15°,-20°. Robuste, il apprécie un sol riche, profond et bien drainé ; il est peu sensible aux maladies. La récolte peut atteindre 150 kilos.
Son bois dur rappelle celui de l'ébène. Aux États-Unis, il sert à fabriquer la tête des clubs de golf, les queues de billard et les arcs. En Orient, Chine, Corée et Japon, il est utilisé pour la réalisation de panneaux de meubles.
Bien mis en valeur, un peu isolé, au soleil et à l'abri du vent, le plaqueminier est l'ornement hivernal de nombreux jardins méditerranéens. Ses fruits font le régal des étourneaux. Pour nous, provençaux, il semble annoncer la fête de Noël.
1. population indienne du Québec
2 qui a l’aspect du duvet
3. couche cireuse, légèrement poudreuse, présente sur certains fruits
4. variété obtenue en culture dont les caractères génétiques ne sont pas transmissibles. Cultivar est un néologisme fabriqué à partir des mots cultivé et variété.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar
Cet arbre, de la famille des ébénacées, est originaire des pays chauds d'Extrême-Orient, la Chine et le Japon, même si une espèce de ce végétal pousse en Virginie en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs de leur pays d'origine que viennent les noms désignant cet arbre. Au Japon, kaki désigne à la fois l'arbre et le fruit alors que plaquemine et plaqueminier trouvent leur origine dans le mot algonquin1, des autochtones de Virginie, piakimina ; enfin, en botanique, on utilise le terme de « diospyros kaki ».
Cultivé en Chine depuis 1300, au Japon depuis 1850, il se répand dans les régions chaudes à la suite des voyages réalisés par les explorateurs. Joseph Banks, botaniste du capitaine Cook, l'introduit en Europe. Le kaki ou plaqueminier se plaît dans les zones où poussent l'olivier et le figuier où sa culture commence vers le milieu du XIXe siècle.
Cet arbre, haut de 12 mètres, porte de grandes feuilles caduques entières, d'un beau vert brillant sur le dessus et « tomenteuses2 dessous », feuilles qui prennent une belle teinte rouge avant de tomber. L'écorce est grise et craquelée. Les fleurs d'un blanc jaunâtre se forment sur les pousses de l'année en juin et juillet. Un même sujet peut porter des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les insectes se chargent de la pollinisation, une fleur femelle non fécondée donne un fruit sans pépins.
Le fruit, kaki ou plaquemine, est une grosse baie globuleuse dont la forme rappelle celle de la tomate, de 5 à 10 cm de diamètre. La peau fine est recouverte d'une pruine3, la chair juteuse, légèrement fibreuse, est sucrée à maturité. D'un goût âpre et astringent dû à sa richesse en tannin avant maturité, on le dit meilleur après les premières gelées lorsqu'il devient blet. Il est très riche en glucose (20 %), en vitamine C, en provitamine A, en sels minéraux et en phénols ; il est donc très utile dans la prévention des maladies cardio-vasculaires.
On le consomme nature, en confiture, en dessert ou séché comme les figues.
Il existe aujourd'hui différents cultivars4 : sharon, fuyu, etc. ; certains, à fort développement donnent des fruits sans pépins, au goût moins astringent, que l'on croque comme une pomme ; ils arrivent d'Espagne, d'Israël ou d'Afrique du Sud.
Il se multiplie essentiellement par greffe, le meilleur porte-greffe étant l'espèce d'origine virginienne.
De culture facile, il a besoin d'un arrosage régulier pendant sa première année (un jour sur deux). Très résistant, il supporte des températures de -15°,-20°. Robuste, il apprécie un sol riche, profond et bien drainé ; il est peu sensible aux maladies. La récolte peut atteindre 150 kilos.
Son bois dur rappelle celui de l'ébène. Aux États-Unis, il sert à fabriquer la tête des clubs de golf, les queues de billard et les arcs. En Orient, Chine, Corée et Japon, il est utilisé pour la réalisation de panneaux de meubles.
Bien mis en valeur, un peu isolé, au soleil et à l'abri du vent, le plaqueminier est l'ornement hivernal de nombreux jardins méditerranéens. Ses fruits font le régal des étourneaux. Pour nous, provençaux, il semble annoncer la fête de Noël.
1. population indienne du Québec
2 qui a l’aspect du duvet
3. couche cireuse, légèrement poudreuse, présente sur certains fruits
4. variété obtenue en culture dont les caractères génétiques ne sont pas transmissibles. Cultivar est un néologisme fabriqué à partir des mots cultivé et variété.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar


Cliquez sur une photo
pour les agrandir
L’amandier [ par Brigitte Rochas ]
Premier arbre en fleurs alors qu’il gèle encore, l’amandier annonce l’arrivée prochaine du printemps et sa floraison légère et aérienne évoque la robe d’une mariée selon un récit de la Grèce antique.
Venu d’Iran, il est introduit en Europe par les Grecs et se répand dans tout le bassin méditerranéen où il trouve un climat favorable à son développement. En France, il apparaît vers le XVe siècle.
Cet arbre de cinq à dix mètres de haut a un houppier ample, une écorce grise et lisse chez le sujet jeune puis qui se craquelle avec le temps. Les branches portent des feuilles étroites lancéolées de dix à douze centimètres, d’un vert brillant dessus et gris au dessous ; en position alterne, elles sont attachées à la branche par un pétiole de deux centimètres.
Les fleurs blanches ou légèrement rosées sont disposées en petits bouquets et apparaissent avant les feuilles si le gel ne les a pas détruites ; tous les éléments de la fleur sont en nombre de cinq ou de multiple de cinq (pentamère).
Les fruits ou drupes sont formés d’un noyau, l’amande, protégé par une coque dure elle-même entourée par une enveloppe veloutée. Consommables, les fruits sont récoltés verts en juin-juillet ou, plus tard, mûrs en septembre-octobre.
Vivant de cinquante à cent ans l’amandier est très résistant aux conditions climatiques extrêmes. Il se plait dans un sol profond bien drainé, même calcaire, dans un espace abrité du vent, exposé au soleil baigné de lumière et de chaleur. Il se reproduit soit par greffe soit par semis. Il est conseillé de le planter en automne et de l’arroser lors qu’il fait très sec pendant les premières années ; toutefois un excès d’humidité peut lui être néfaste car il est sensible aux champignons alors qu’il ne craint guère d’autres maladies.
La production mondiale est assurée à 50 % par la Californie avec une monoculture qui fait la part belle à la mécanisation, l’utilisation des pesticides et le développement de cultivars soigneusement sélectionnés. Les pays méditerranéens ne fournissent pas toujours la quantité nécessaire à leur propre consommation, ce qui est le cas de la France qui n’en produit que 10 %. Le soin apporté à cette culture trouve sa raison d’être dans les caractéristiques de l’amande très riche en acides gras, protéines, minéraux : calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium et en vitamines B1, B2 et E.
On trouve deux types d’amande :
– l’amande amère, fruit de l’amandier sauvage, particulièrement riche en amygdaline à l’origine de l’acide cyanhydrique, est dangereuse pour la consommation puisque l’ingestion de cinquante amandes amères suffit à tuer un individu ;
– l’amande douce est utilisée en cuisine, pâtisserie, confiserie, pharmacie, dermatologie, cosmétique ; en cuisine et en pâtisserie, l’amande accompagne ou garnit des nombreuses préparations ; en confiserie, citons les pralines, les dragées, la pâte d’amande, le sirop d’orgeat ; en pharmacie et en dermatologie, elle doit sa place à ses qualités adoucissantes et calmantes ;
– traitée par la pression elle donne une huile très fine dont les résidus servent à la préparation de masques et de cataplasmes.
En botanique, l’amandier appartient à la famille des rosacées ; il est du genre amygdalacées ou prunus comme l’abricotier, le cerisier, le merisier, le pêcher et le prunier.
Sa beauté a inspiré des artistes ; La branche d’amandier d’Alphonse de Lamartine ou le tableau Branches fleuries d’amandier de Vincent Van Gogh.
Venu d’Iran, il est introduit en Europe par les Grecs et se répand dans tout le bassin méditerranéen où il trouve un climat favorable à son développement. En France, il apparaît vers le XVe siècle.
Cet arbre de cinq à dix mètres de haut a un houppier ample, une écorce grise et lisse chez le sujet jeune puis qui se craquelle avec le temps. Les branches portent des feuilles étroites lancéolées de dix à douze centimètres, d’un vert brillant dessus et gris au dessous ; en position alterne, elles sont attachées à la branche par un pétiole de deux centimètres.
Les fleurs blanches ou légèrement rosées sont disposées en petits bouquets et apparaissent avant les feuilles si le gel ne les a pas détruites ; tous les éléments de la fleur sont en nombre de cinq ou de multiple de cinq (pentamère).
Les fruits ou drupes sont formés d’un noyau, l’amande, protégé par une coque dure elle-même entourée par une enveloppe veloutée. Consommables, les fruits sont récoltés verts en juin-juillet ou, plus tard, mûrs en septembre-octobre.
Vivant de cinquante à cent ans l’amandier est très résistant aux conditions climatiques extrêmes. Il se plait dans un sol profond bien drainé, même calcaire, dans un espace abrité du vent, exposé au soleil baigné de lumière et de chaleur. Il se reproduit soit par greffe soit par semis. Il est conseillé de le planter en automne et de l’arroser lors qu’il fait très sec pendant les premières années ; toutefois un excès d’humidité peut lui être néfaste car il est sensible aux champignons alors qu’il ne craint guère d’autres maladies.
La production mondiale est assurée à 50 % par la Californie avec une monoculture qui fait la part belle à la mécanisation, l’utilisation des pesticides et le développement de cultivars soigneusement sélectionnés. Les pays méditerranéens ne fournissent pas toujours la quantité nécessaire à leur propre consommation, ce qui est le cas de la France qui n’en produit que 10 %. Le soin apporté à cette culture trouve sa raison d’être dans les caractéristiques de l’amande très riche en acides gras, protéines, minéraux : calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium et en vitamines B1, B2 et E.
On trouve deux types d’amande :
– l’amande amère, fruit de l’amandier sauvage, particulièrement riche en amygdaline à l’origine de l’acide cyanhydrique, est dangereuse pour la consommation puisque l’ingestion de cinquante amandes amères suffit à tuer un individu ;
– l’amande douce est utilisée en cuisine, pâtisserie, confiserie, pharmacie, dermatologie, cosmétique ; en cuisine et en pâtisserie, l’amande accompagne ou garnit des nombreuses préparations ; en confiserie, citons les pralines, les dragées, la pâte d’amande, le sirop d’orgeat ; en pharmacie et en dermatologie, elle doit sa place à ses qualités adoucissantes et calmantes ;
– traitée par la pression elle donne une huile très fine dont les résidus servent à la préparation de masques et de cataplasmes.
En botanique, l’amandier appartient à la famille des rosacées ; il est du genre amygdalacées ou prunus comme l’abricotier, le cerisier, le merisier, le pêcher et le prunier.
Sa beauté a inspiré des artistes ; La branche d’amandier d’Alphonse de Lamartine ou le tableau Branches fleuries d’amandier de Vincent Van Gogh.

Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
Quel guêpier ! [ par Brigitte Rochas ]
Le printemps est partout, tout autour de nous. Dès les premiers
jours de mai, même si le thermomètre affiche des températures
encore fraîches, il suffit, pour s’en convaincre, de regarder la
luxuriante floraison du rosier de Banks et les hampes fières des iris
aux coloris parfois surprenants. Il faut aussi prendre le temps
d’écouter la grande diversité des chants d’oiseaux très actifs dès les
premières heures du jour.
L’arrivée du printemps voit aussi le retour des migrateurs qui nous ont quittés en septembre : hirondelles, martinets, huppes fasciées et bien d'autres. L’un d’entre eux, le guêpier d’Europe, réussit très vite à attirer l’attention par son chant si caractéristique. En levant la tête vers le ciel, on découvre cet oiseau, aux couleurs chatoyantes, qui occupe l’espace avec ses multiples acrobaties aériennes : chandelles, vrilles, loopings, piqués, glissades. Ses évolutions s’accompagnent d’un fonds musical très particulier, sifflements roulés et rauques, qui atteint son paroxysme en cette période de parade nuptiale.
Originaire d'Asie, cet oiseau a conquis de nombreux territoires en Europe et en Afrique, il n'a pas encore atteint l'Amérique. Le guêpier, de la famille des « méropidés », appartient à l'ordre des « coraciiformes ». Il migre dans le sud de l'Europe, en France, en Espagne, en Italie, mais remonte à nouveau vers le Nord de la France ainsi qu’en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suède.
De la taille d'un merle, son corps mesure de 27 à 30 centimètres pour un poids de 45 à 75 grammes et une envergure d’un demimètre.
Son attrait réside dans les magnifiques couleurs de son plumage. Sa calotte est brune, sa bavette jaune encadrée de noir, son ventre bleu-vert à bleu-turquoise. Son dos brun-roux, ses ailes verdâtres à pointes noires, sa queue vert sombre d'où dépassent deux médianes à pointe effilée. De son bec noir et légèrement arqué part une bande noire au milieu de laquelle se trouve l'oeil à l'iris rouge. Femelles et mâles sont semblables.
Excellent chasseur, le guêpier se poste à découvert, sur un piquet, sur un arbuste ou sur un fil électrique, d’où il plonge en piqué pour capturer les insectes en vol : hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons, bourdons) qui constituent l'essentiel de son régime, auxquels peuvent s'ajouter des orthoptères (cigales, grillons, sauterelles, libellules, papillons) ainsi que des coléoptères comme les hannetons. S'il a capturé un insecte piqueur (abeille, guêpe, bourdon), il retourne habilement l'animal et lui écrase l'abdomen, où se trouve la poche à venin, en le frottant cinq ou six fois contre son perchoir. Ce faisant, le guêpier garde les yeux fermés pour ne pas recevoir de venin, ni être blessé par le dard, puis, après quelques petits coups sur la tête, il avale sa proie, tout cela en moins de dix secondes.
Afin de bénéficier des meilleures conditions de vie, sous un climat chaud, ensoleillé et sec, il s’installe dans un habitat ouvert : anciennes sablières, falaises d'éboulis, berges sablonneuses de rivières riches en nourriture potentielle.
Organisés en petites colonies d'une cinquantaine d'individus qui partagent le même territoire, les guêpiers vivent en petits clans familiaux. Pour construire leur nid, les couples, monogames, creusent, à l'aide de leurs pattes terminées par des griffes, une galerie d’environ 60 centimètres dans une falaise à laquelle ils s'agrippent pour dégager près de douze kilos de sable, le microclimat stable de ce nid souterrain étant particulièrement favorable au bon développement des oeufs et des petits. Vers la fin du mois de mai, la femelle pond de quatre à six oeufs directement dans la galerie. La couvaison dure 21 jours puis, pendant quatre semaines, les jeunes sont nourris et atteignent alors un poids supérieur à celui de leurs parents, ils doivent ensuite jeûner quelques jours pour pouvoir tenter leur premier vol.
À la fin septembre, les guêpiers se réunissent en grands groupes et partent vers le continent africain où ils passent l’hiver. Les guêpiers d'Europe occidentale choisissent de passer par Gibraltar avant de rejoindre, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et le Cameroun. Ceux venant d'Europe orientale franchissent la Méditerranée pour aller en Afrique du Sud. Leur vol a lieu de jour, et au cours de ce périple, 30 % d'entre eux perdent la vie, chassés et attaqués par les faucons qui, à cette période, ont des jeunes à nourrir.
Cependant, pour notre plus grand plaisir, la majorité de ces oiseaux retrouve le ciel de notre pays dès la fin avril. Cette espèce est protégée depuis 1981 en France.
L’arrivée du printemps voit aussi le retour des migrateurs qui nous ont quittés en septembre : hirondelles, martinets, huppes fasciées et bien d'autres. L’un d’entre eux, le guêpier d’Europe, réussit très vite à attirer l’attention par son chant si caractéristique. En levant la tête vers le ciel, on découvre cet oiseau, aux couleurs chatoyantes, qui occupe l’espace avec ses multiples acrobaties aériennes : chandelles, vrilles, loopings, piqués, glissades. Ses évolutions s’accompagnent d’un fonds musical très particulier, sifflements roulés et rauques, qui atteint son paroxysme en cette période de parade nuptiale.
Originaire d'Asie, cet oiseau a conquis de nombreux territoires en Europe et en Afrique, il n'a pas encore atteint l'Amérique. Le guêpier, de la famille des « méropidés », appartient à l'ordre des « coraciiformes ». Il migre dans le sud de l'Europe, en France, en Espagne, en Italie, mais remonte à nouveau vers le Nord de la France ainsi qu’en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suède.
De la taille d'un merle, son corps mesure de 27 à 30 centimètres pour un poids de 45 à 75 grammes et une envergure d’un demimètre.
Son attrait réside dans les magnifiques couleurs de son plumage. Sa calotte est brune, sa bavette jaune encadrée de noir, son ventre bleu-vert à bleu-turquoise. Son dos brun-roux, ses ailes verdâtres à pointes noires, sa queue vert sombre d'où dépassent deux médianes à pointe effilée. De son bec noir et légèrement arqué part une bande noire au milieu de laquelle se trouve l'oeil à l'iris rouge. Femelles et mâles sont semblables.
Excellent chasseur, le guêpier se poste à découvert, sur un piquet, sur un arbuste ou sur un fil électrique, d’où il plonge en piqué pour capturer les insectes en vol : hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons, bourdons) qui constituent l'essentiel de son régime, auxquels peuvent s'ajouter des orthoptères (cigales, grillons, sauterelles, libellules, papillons) ainsi que des coléoptères comme les hannetons. S'il a capturé un insecte piqueur (abeille, guêpe, bourdon), il retourne habilement l'animal et lui écrase l'abdomen, où se trouve la poche à venin, en le frottant cinq ou six fois contre son perchoir. Ce faisant, le guêpier garde les yeux fermés pour ne pas recevoir de venin, ni être blessé par le dard, puis, après quelques petits coups sur la tête, il avale sa proie, tout cela en moins de dix secondes.
Afin de bénéficier des meilleures conditions de vie, sous un climat chaud, ensoleillé et sec, il s’installe dans un habitat ouvert : anciennes sablières, falaises d'éboulis, berges sablonneuses de rivières riches en nourriture potentielle.
Organisés en petites colonies d'une cinquantaine d'individus qui partagent le même territoire, les guêpiers vivent en petits clans familiaux. Pour construire leur nid, les couples, monogames, creusent, à l'aide de leurs pattes terminées par des griffes, une galerie d’environ 60 centimètres dans une falaise à laquelle ils s'agrippent pour dégager près de douze kilos de sable, le microclimat stable de ce nid souterrain étant particulièrement favorable au bon développement des oeufs et des petits. Vers la fin du mois de mai, la femelle pond de quatre à six oeufs directement dans la galerie. La couvaison dure 21 jours puis, pendant quatre semaines, les jeunes sont nourris et atteignent alors un poids supérieur à celui de leurs parents, ils doivent ensuite jeûner quelques jours pour pouvoir tenter leur premier vol.
À la fin septembre, les guêpiers se réunissent en grands groupes et partent vers le continent africain où ils passent l’hiver. Les guêpiers d'Europe occidentale choisissent de passer par Gibraltar avant de rejoindre, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et le Cameroun. Ceux venant d'Europe orientale franchissent la Méditerranée pour aller en Afrique du Sud. Leur vol a lieu de jour, et au cours de ce périple, 30 % d'entre eux perdent la vie, chassés et attaqués par les faucons qui, à cette période, ont des jeunes à nourrir.
Cependant, pour notre plus grand plaisir, la majorité de ces oiseaux retrouve le ciel de notre pays dès la fin avril. Cette espèce est protégée depuis 1981 en France.

Quelle envergure !

Ils s’agrippent pour dégager près de 12 kilos de sable
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Le « genêt d'Espagne », ce mal nommé... [ par Jean-Pierre Rogel ]
En mai et juin, les genêts
d’Espagne fleurissent et
dressent leurs fleurs jaunes un
peu partout, en bosquets éclatants
qui égayent le paysage.
« Genêts d’Espagne », avez-vous
dit ? Ici, dans la région du
Ventoux, les guillemets s’imposent,
car il existe aussi un tout
petit genêt, rampant et piquant,
poussant en coussinets sur des
sols secs. Son nom scientifique
est Genista hispanica (1) : c’est le
véritable genêt d’Espagne, il est
originaire de ce pays, mais fort
bien acclimaté chez nous.
Mais alors, qu’en est-il du fameux « genêt d’Espagne », que tout le monde connaît ? Celui qui a de longs rameaux verts, souples et creux, ressemblant à des joncs, et des fleurs jaunes, dressées, odorantes ? Oui, celui dont les corolles très jaunes sont à cinq pétales, ressemblant aux ailes d’un papillon ? Eh bien, il s’agit de Spartium junceum (2) et vous avez parfaitement le droit de l’appeler genêt d’Espagne. C’est d’ailleurs ce que vous diront les guides botaniques, bien que plusieurs mentionnent l’ambiguïté de l’appellation, certains utilisant les guillemets pour la souligner.
Ce « genêt d’Espagne », n’a pas d’épines et n’est pas très exigeant, il pousse dans les talus en bosquets, sur les friches, dans plusieurs types de sols. Dans la région, on croise aussi son cousin, le genêt scorpion, Genista scorpius (3), qui est très épineux. Celui-là, on le trouve plutôt dans les collines, il aime les rocailles et les endroits ensoleillés. On le voit aussi dans des trous de lumière au milieu des forêts de chênes. Il paraît qu’on s’en servait jadis pour ramoner les cheminées, mais aussi (plus étonnant), pour retenir le marc de raisin dans les cuves.
Enfin, il faut parler un peu du genêt cendré, Genista cinerea (4), un autre genêt commun qu’on croise dans la région, essentiellement sur les côteaux secs des massifs calcaires. Le buisson est très étalé, les rameaux sont denses et minces, ses fleurs sont plutôt jaune pâle, mais il a aussi fière allure, un peu plus ébouriffé toutefois que le « genêt d’Espagne ».
Un mot sur les fruits. Ce sont des gousses de quelques centimètres de long. Dans le cas du « genêt d’Espagne », elles sont longues, plates, verdâtres devenant noires plus tard dans la saison et soyeuses. Le genêt scorpion a des gousses bosselées, le genêt cendré a des gousses brunes et velues (il existe d’ailleurs un autre genêt, plus rare, qui s’appelle le genêt poilu, Genista pilosa (5) à cause de ses gousses très velues).
En cette période de l’année, les genêts ne sont plus en fleurs… Ce moment de beauté est passé. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on peut déjà anticiper le retour au printemps prochain de la floraison de la ginesta ou lo ginest, selon l’appellation la plus fréquente en provençal de cette plante familière.
Mais alors, qu’en est-il du fameux « genêt d’Espagne », que tout le monde connaît ? Celui qui a de longs rameaux verts, souples et creux, ressemblant à des joncs, et des fleurs jaunes, dressées, odorantes ? Oui, celui dont les corolles très jaunes sont à cinq pétales, ressemblant aux ailes d’un papillon ? Eh bien, il s’agit de Spartium junceum (2) et vous avez parfaitement le droit de l’appeler genêt d’Espagne. C’est d’ailleurs ce que vous diront les guides botaniques, bien que plusieurs mentionnent l’ambiguïté de l’appellation, certains utilisant les guillemets pour la souligner.
Ce « genêt d’Espagne », n’a pas d’épines et n’est pas très exigeant, il pousse dans les talus en bosquets, sur les friches, dans plusieurs types de sols. Dans la région, on croise aussi son cousin, le genêt scorpion, Genista scorpius (3), qui est très épineux. Celui-là, on le trouve plutôt dans les collines, il aime les rocailles et les endroits ensoleillés. On le voit aussi dans des trous de lumière au milieu des forêts de chênes. Il paraît qu’on s’en servait jadis pour ramoner les cheminées, mais aussi (plus étonnant), pour retenir le marc de raisin dans les cuves.
Enfin, il faut parler un peu du genêt cendré, Genista cinerea (4), un autre genêt commun qu’on croise dans la région, essentiellement sur les côteaux secs des massifs calcaires. Le buisson est très étalé, les rameaux sont denses et minces, ses fleurs sont plutôt jaune pâle, mais il a aussi fière allure, un peu plus ébouriffé toutefois que le « genêt d’Espagne ».
Un mot sur les fruits. Ce sont des gousses de quelques centimètres de long. Dans le cas du « genêt d’Espagne », elles sont longues, plates, verdâtres devenant noires plus tard dans la saison et soyeuses. Le genêt scorpion a des gousses bosselées, le genêt cendré a des gousses brunes et velues (il existe d’ailleurs un autre genêt, plus rare, qui s’appelle le genêt poilu, Genista pilosa (5) à cause de ses gousses très velues).
En cette période de l’année, les genêts ne sont plus en fleurs… Ce moment de beauté est passé. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on peut déjà anticiper le retour au printemps prochain de la floraison de la ginesta ou lo ginest, selon l’appellation la plus fréquente en provençal de cette plante familière.
Les graines du genêt d'Espagne contiennent un alcaloïde toxique,
la cytisine, voisin de la nicotine, très utilisée dans le sevrage tabagique
dans l'est de l'Europe. Son usage n'est pas autorisé en
France, faute d'essais suffisants, mais certaines mauvaises
langues suggèrent que son faible coût n'intéresserait pas l'industrie
pharmaceutique. En ce domaine, un autre genêt très courant, Sarothamnus scoparius (6), dit genêt à balais (entre autres appellations), contient un alcaloïde, peu toxique celui-ci, la spartéine, longtemps utilisé comme efficace régulateur du rythme cardiaque, supplanté désormais par d'onéreuses molécules de synthèse, peut-être pour les mêmes raisons qu'au paragraphe précédent. Ce genêt pousse exclusivement en terrain siliceux et boude donc le pays Voconce. On en faisait aussi des balais, d'où son nom commun, et des cordes grossières. La famille des genêts est « nombreuse » : si le genre Spartium ne comporte qu'une seule espèce, le genre Sarothamnus trois, le genre Genista est représenté par treize espèces auxquelles il faut ajouter vingt-six variétés. Ainsi, avec les genêts déjà cités, on a celui d'Allemagne, d'Angleterre, le très épineux, le Faux-Aspalath, le radié, le sagitté, celui des teinturiers, celui à feuilles de lin, etc. Pour compliquer un peu, comme les divers botanistes aiment bien baptiser la plante qu'ils décrivent, mais qu'un nouveau nom ne chasse pas l'autre nécessairement, on risque fort de s'égarer : ainsi le Sarothamnus scoparius, cité ci-dessus, et nommé ainsi par Koch, s'appelle Spartium scoparium pour Linné et Genista scoparia pour Lamarck ! Jean-Jacques Sibourg |

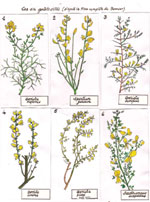
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
Au fil des randonnées dans la Drôme [ par Jean-Pierre Rogel ]
Comme beaucoup, j’aime me
promener à pied pour la
diversité des paysages, le contact
avec la nature, le grand air et
l’exercice. Dans la région, nous
avons la chance d’avoir de splendides
paysages et un climat idéal
pour les apprécier. Qu’il s’agisse
de promenades autour d’un village,
de petites ou de grandes
randonnées pédestres, il y a toujours
à observer et à découvrir.
En marchant, on savoure les paysages, on apprécie le jeu que les hommes en ont fait, là où ils ont posé leurs maisons, leurs cultures, leurs villages. Et l’on apprécie les lieux où la nature garde ses droits, dans ces collines boisées dont la végétation est tantôt méditerranéenne, tantôt presque alpine.
Je trouve le meilleur de tout cet univers dans les collines de la Drôme, toutes proches. J’aime beaucoup celles de la vallée de l’Aygues, la rive droite jusqu’à Rémuzat, comme la rive gauche jusqu’à La Vanige et la superbe vallée de l’Ennuye. J’aime aussi la moyenne Ouvèze, autour de Buis-les-Baronnies. Que de superbes balades, avec le jeu des couleurs, des senteurs, des paysages sans cesse renouvelés !
On ne croise pas beaucoup d’animaux dans ces collines, à part, sur les hauteurs, les troupeaux de moutons ou de chèvres. En forêt, les sangliers ne sont jamais loin, on voit leurs traces par tout, mais on se retrouve rarement face à face avec ces grosses bêtes. J’ai vu quelques fois des cerfs, fuyant rapidement (pour cela, cependant, pas besoin d’aller très loin, on en voit dans les vignes autour de Villedieu...). En fait, sur les sentiers, ce sont les lézards qui font le plus de bruit, remuant le feuillage à l’approche des pas. Ou encore les insectes, du moins en été. On entend aussi et on aperçoit facilement en forêt de petits oiseaux ; sur les hauteurs près des cols on aperçoit parfois des buses, des aigles et les fameux vautours des Baronnies, mais c’est à peu près tout. Par contre, l’amateur d’arbres et de plantes, notamment les plantes aromatiques, est comblé. C’est l’abondance, il y a de quoi faire en toutes saisons.
Ceux que la nature intéresse moins peuvent apprécier le tracé et l’ancienneté des sentiers. Pour ma part, je ne me lasse jamais de découvrir les marques anciennes d’occupation humaine. Il y a des sentiers qui sont de pures merveilles, avec leur sol empierré qui peut dater de plusieurs siècles et leurs murets de bordure. Que de volonté et de patience il a fallu pour défricher, construire et entretenir ces voies simples, moyens de passage entre les villages ! Certains chemins en vallée datent de l’époque romaine, on voit même encore les ornières laissées par les roues de chariot. Plus haut dans les collines, on trouve de vieux sentiers empierrés qui franchissent les cols entre les vallées. On imagine des hommes et des animaux de bât lourdement chargés de marchandises ou de nourriture.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la circulation des hommes et des produits de toutes sortes s’est faite non par les routes que nous connaissons, mais par un réseau de chemins de montagne. Lors d’une de ces balades, j’ai rencontré un jour un enseignant à la retraite qui semblait s’y connaître. Il m’a expliqué que les muletiers de Rémuzat livrant le grain à Buis ou à Nyons mettaient trois jours, aller et retour. Ils longeaient le lit des rivières quand ils le pouvaient, mais souvent, ils étaient contraints de grimper dans les hauteurs pour franchir des cols.
Ainsi, de Rémuzat à Sainte-Jalle, me disait cet homme savant, il fallait prendre un sentier vers le col de Soubeyrand, passer les bergeries situées sous le col d’Ambonne et redescendre dans la vallée en passant par Le Poët-Sigillat. En fait, cet itinéraire existe toujours et emprunte les sentiers de la Drôme, balisés 49 et 51, ainsi qu’un itinéraire balisé équestre. Au passage, c’est une des balades les plus spectaculaires que je connaisse. On peut y savourer le plaisir du passage des cols et passer constamment d’un paysage à l’autre, découvrant un relief varié. En musardant, on peut encore se prendre pour un villageois d’antan accompagné de son âne, se pressant pour arriver à temps à la foire du Buis.
En marchant, on savoure les paysages, on apprécie le jeu que les hommes en ont fait, là où ils ont posé leurs maisons, leurs cultures, leurs villages. Et l’on apprécie les lieux où la nature garde ses droits, dans ces collines boisées dont la végétation est tantôt méditerranéenne, tantôt presque alpine.
Je trouve le meilleur de tout cet univers dans les collines de la Drôme, toutes proches. J’aime beaucoup celles de la vallée de l’Aygues, la rive droite jusqu’à Rémuzat, comme la rive gauche jusqu’à La Vanige et la superbe vallée de l’Ennuye. J’aime aussi la moyenne Ouvèze, autour de Buis-les-Baronnies. Que de superbes balades, avec le jeu des couleurs, des senteurs, des paysages sans cesse renouvelés !
On ne croise pas beaucoup d’animaux dans ces collines, à part, sur les hauteurs, les troupeaux de moutons ou de chèvres. En forêt, les sangliers ne sont jamais loin, on voit leurs traces par tout, mais on se retrouve rarement face à face avec ces grosses bêtes. J’ai vu quelques fois des cerfs, fuyant rapidement (pour cela, cependant, pas besoin d’aller très loin, on en voit dans les vignes autour de Villedieu...). En fait, sur les sentiers, ce sont les lézards qui font le plus de bruit, remuant le feuillage à l’approche des pas. Ou encore les insectes, du moins en été. On entend aussi et on aperçoit facilement en forêt de petits oiseaux ; sur les hauteurs près des cols on aperçoit parfois des buses, des aigles et les fameux vautours des Baronnies, mais c’est à peu près tout. Par contre, l’amateur d’arbres et de plantes, notamment les plantes aromatiques, est comblé. C’est l’abondance, il y a de quoi faire en toutes saisons.
Ceux que la nature intéresse moins peuvent apprécier le tracé et l’ancienneté des sentiers. Pour ma part, je ne me lasse jamais de découvrir les marques anciennes d’occupation humaine. Il y a des sentiers qui sont de pures merveilles, avec leur sol empierré qui peut dater de plusieurs siècles et leurs murets de bordure. Que de volonté et de patience il a fallu pour défricher, construire et entretenir ces voies simples, moyens de passage entre les villages ! Certains chemins en vallée datent de l’époque romaine, on voit même encore les ornières laissées par les roues de chariot. Plus haut dans les collines, on trouve de vieux sentiers empierrés qui franchissent les cols entre les vallées. On imagine des hommes et des animaux de bât lourdement chargés de marchandises ou de nourriture.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la circulation des hommes et des produits de toutes sortes s’est faite non par les routes que nous connaissons, mais par un réseau de chemins de montagne. Lors d’une de ces balades, j’ai rencontré un jour un enseignant à la retraite qui semblait s’y connaître. Il m’a expliqué que les muletiers de Rémuzat livrant le grain à Buis ou à Nyons mettaient trois jours, aller et retour. Ils longeaient le lit des rivières quand ils le pouvaient, mais souvent, ils étaient contraints de grimper dans les hauteurs pour franchir des cols.
Ainsi, de Rémuzat à Sainte-Jalle, me disait cet homme savant, il fallait prendre un sentier vers le col de Soubeyrand, passer les bergeries situées sous le col d’Ambonne et redescendre dans la vallée en passant par Le Poët-Sigillat. En fait, cet itinéraire existe toujours et emprunte les sentiers de la Drôme, balisés 49 et 51, ainsi qu’un itinéraire balisé équestre. Au passage, c’est une des balades les plus spectaculaires que je connaisse. On peut y savourer le plaisir du passage des cols et passer constamment d’un paysage à l’autre, découvrant un relief varié. En musardant, on peut encore se prendre pour un villageois d’antan accompagné de son âne, se pressant pour arriver à temps à la foire du Buis.

Chemin faisant

Horizon drômois
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Le blaireau [ par Brigitte Rochas ]
Parmi les animaux nocturnes qui vivent dans notre pays, certains
sont mal connus et parfois victimes du trafic routier. C’est le cas
du blaireau, ou taisson, qui a trouvé la mort en bordure de la route
de Villedieu à Vaison, vers la fin septembre.
Reconnaissable aux deux bandes noires de son museau allongé, à son allure pataude proche de celle des ursidés (plantigrades), ce mammifère carnivore appartient à la famille des mustélidés tout comme la belette, le putois, le vison, la loutre et, en Amérique, le ratel et le carcajou (glouton).
Avec sa silhouette trapue, 30 centimètres au garrot pour 70 à 90 centimètres de long, queue comprise, la couleur de son pelage allant du gris au beige sur le dos, les pattes noires, la queue et le ventre blancs et la tête noire et blanche, le blaireau sort dès la nuit tombée pour se nourrir et déféquer dans de petits entonnoirs creusés à cet effet.
Une séance d’épouillage précède les sorties nocturnes. L’animal couché sur le dos se sert de son museau et de ses pattes antérieures pour éliminer les parasites installés dans son pelage : poux, puces, tiques… Au cours de ses vagabondages, il marque son territoire, de 50 à 400 hectares, à l’aide de ses glandes annales.
Ce carnivore fouisseur, à l’odorat et l’ouïe très sensibles, est friand de lombrics (il peut en dévorer jusqu’à 100 kilos par an), de vers blancs, de taupes, de petits rongeurs, de batraciens, de nids de guêpes et de frelons, de serpents (il ne craint pas la morsure de la vipère), débarrassant ainsi les cultures de nombreux parasites. Il est aussi omnivore : les raisins, les mûres, les baies de sureau, les champignons viennent alors enrichir son menu. En cas de disette, il peut s’en prendre aux épis de maïs encore laiteux ou aux céréales. À la fin de l’été, le blaireau peut atteindre un poids de 20 kilos, car il stocke de la graisse en vue de l’hiver à venir, période d’activité ralentie, mais pas d’hibernation.
Ce mal-aimé ne mérite donc pas la mauvaise réputation qui l’accompagne trop souvent aux dires des agriculteurs et des chasseurs. Sédentaires, les blaireaux vivent en clan de cinq à dix adultes avec des jeunes dans un terrier aux nombreuses entrées, où les générations précédentes ont vécu parfois depuis plus d’un siècle. Ce terrier profond de quatre à cinq mètres est creusé dans un talus, une butte ou une falaise ; il est constitué de galeries pouvant mesurer jusqu’à quinze mètres, qui conduisent à des chambres tapissées de feuilles mortes, d’herbes sèches et de mousses. L’ensemble de ces galeries porte le nom de « forteresse » ou « donjon ». Pour agrandir son logis, le blaireau utilise les griffes acérées de ses pattes avant et repousse vers l’extérieur jusqu’à 40 tonnes de déblais formant un toboggan, ou « coulée ». Hospitalier, le blaireau partage souvent son terrier avec le renard, le putois ou le lapin.
Très soucieux de son bien-être, le blaireau sort régulièrement sa litière pour l’aérer ou la renouveler en coinçant les matériaux entre sa tête et ses membres antérieurs pour rentrer à reculons dans le trou. L’animal s’y repose dans la journée et s’y réfugie en période hivernale. C’est là que naissent les blaireautins mis au monde par la blairelle. La période de reproduction a lieu de février à avril, la femelle peut être fécondée par différents mâles, mais l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus et le développement de l’embryon se produisent huit mois plus tard. Après une gestation de deux mois, les petits, au nombre de cinq à sept, voient le jour en février ou mars, tout rose et les yeux fermés. Leur mère les allaite pendant trois mois, ensuite ils commencent à chercher tout seuls leur nourriture et jouent à imiter les adultes, très joueurs eux-mêmes, se préparant ainsi à leur vie future. Ils atteignent la taille adulte dix mois plus tard. La maturité sexuelle arrive vers l’âge de deux ans. Sa longévité est de 15 ans environ. Ces animaux communiquent entre eux par des émissions sonores diversifiées : grognements, cris aigus, hurlements.
Entre 1960 et 1980, leur population était en régression à cause du piégeage et du gazage pratiqués pour exterminer les animaux susceptibles d’être porteurs de la rage. Aujourd’hui, malgré un taux de mortalité de 50 % des jeunes au cours de leur première année et de 30 % des adultes souvent victimes du trafic routier, leur population retrouve une certaine stabilité.
« Blaireau » désigne aussi l’objet utilisé pour faire mousser la crème à raser, tout simplement parce qu’il est fabriqué avec les poils de l’animal.
Reconnaissable aux deux bandes noires de son museau allongé, à son allure pataude proche de celle des ursidés (plantigrades), ce mammifère carnivore appartient à la famille des mustélidés tout comme la belette, le putois, le vison, la loutre et, en Amérique, le ratel et le carcajou (glouton).
Avec sa silhouette trapue, 30 centimètres au garrot pour 70 à 90 centimètres de long, queue comprise, la couleur de son pelage allant du gris au beige sur le dos, les pattes noires, la queue et le ventre blancs et la tête noire et blanche, le blaireau sort dès la nuit tombée pour se nourrir et déféquer dans de petits entonnoirs creusés à cet effet.
Une séance d’épouillage précède les sorties nocturnes. L’animal couché sur le dos se sert de son museau et de ses pattes antérieures pour éliminer les parasites installés dans son pelage : poux, puces, tiques… Au cours de ses vagabondages, il marque son territoire, de 50 à 400 hectares, à l’aide de ses glandes annales.
Ce carnivore fouisseur, à l’odorat et l’ouïe très sensibles, est friand de lombrics (il peut en dévorer jusqu’à 100 kilos par an), de vers blancs, de taupes, de petits rongeurs, de batraciens, de nids de guêpes et de frelons, de serpents (il ne craint pas la morsure de la vipère), débarrassant ainsi les cultures de nombreux parasites. Il est aussi omnivore : les raisins, les mûres, les baies de sureau, les champignons viennent alors enrichir son menu. En cas de disette, il peut s’en prendre aux épis de maïs encore laiteux ou aux céréales. À la fin de l’été, le blaireau peut atteindre un poids de 20 kilos, car il stocke de la graisse en vue de l’hiver à venir, période d’activité ralentie, mais pas d’hibernation.
Ce mal-aimé ne mérite donc pas la mauvaise réputation qui l’accompagne trop souvent aux dires des agriculteurs et des chasseurs. Sédentaires, les blaireaux vivent en clan de cinq à dix adultes avec des jeunes dans un terrier aux nombreuses entrées, où les générations précédentes ont vécu parfois depuis plus d’un siècle. Ce terrier profond de quatre à cinq mètres est creusé dans un talus, une butte ou une falaise ; il est constitué de galeries pouvant mesurer jusqu’à quinze mètres, qui conduisent à des chambres tapissées de feuilles mortes, d’herbes sèches et de mousses. L’ensemble de ces galeries porte le nom de « forteresse » ou « donjon ». Pour agrandir son logis, le blaireau utilise les griffes acérées de ses pattes avant et repousse vers l’extérieur jusqu’à 40 tonnes de déblais formant un toboggan, ou « coulée ». Hospitalier, le blaireau partage souvent son terrier avec le renard, le putois ou le lapin.
Très soucieux de son bien-être, le blaireau sort régulièrement sa litière pour l’aérer ou la renouveler en coinçant les matériaux entre sa tête et ses membres antérieurs pour rentrer à reculons dans le trou. L’animal s’y repose dans la journée et s’y réfugie en période hivernale. C’est là que naissent les blaireautins mis au monde par la blairelle. La période de reproduction a lieu de février à avril, la femelle peut être fécondée par différents mâles, mais l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus et le développement de l’embryon se produisent huit mois plus tard. Après une gestation de deux mois, les petits, au nombre de cinq à sept, voient le jour en février ou mars, tout rose et les yeux fermés. Leur mère les allaite pendant trois mois, ensuite ils commencent à chercher tout seuls leur nourriture et jouent à imiter les adultes, très joueurs eux-mêmes, se préparant ainsi à leur vie future. Ils atteignent la taille adulte dix mois plus tard. La maturité sexuelle arrive vers l’âge de deux ans. Sa longévité est de 15 ans environ. Ces animaux communiquent entre eux par des émissions sonores diversifiées : grognements, cris aigus, hurlements.
Entre 1960 et 1980, leur population était en régression à cause du piégeage et du gazage pratiqués pour exterminer les animaux susceptibles d’être porteurs de la rage. Aujourd’hui, malgré un taux de mortalité de 50 % des jeunes au cours de leur première année et de 30 % des adultes souvent victimes du trafic routier, leur population retrouve une certaine stabilité.
« Blaireau » désigne aussi l’objet utilisé pour faire mousser la crème à raser, tout simplement parce qu’il est fabriqué avec les poils de l’animal.

Le blaireau mort sur la route de Villedieu à Vaison

Signes distinctifs du blaireau
Cliquez sur une photo
pour les agrandir
et en voir plus
Un jardin médicinal [ par Jean-Jacques Sibourg ]
L'exploitation des
ressources médicinales
de quelques centaines
de mètres carrés
de terrain, à Villedieu,
passerait pour une grave
menace de concurrence
pour les pharmaciens, si
toutes les vertus prêtées
à ces plantes, prises au
pied de la lettre, étaient
confirmées par l'expérience
et/ou la caution
scientifique. Celle-ci n'est
pas toujours au rendezvous,
il faut en convenir.
Ces plantes permettraient de soigner de la tête aux pieds, appareil par appareil. Pourtant le chroniqueur ne prétend pas reconnaître, dans son herborisation sommaire, toutes les plantes locales à caractère médicinal, d'autant que la saison actuelle en masque un grand nombre. Pourtant plus de cinquante autres, d'importances diverses, viennent à l'esprit et pourraient prétendre figurer ci-dessous, si l’on voulait être plus exhaustif.
En regard de cette énumération sélective figurent des indications piochées dans la médecine allopathique (classique), l'homéopathie et ses avatars (gemmothérapie, anthroposophie), la phytothérapie, l'aromathérapie, et la médecine dite populaire (que le féminisme ambiant interdit d'appeler désormais remèdes de bonne femme !), voire exotique.
Les parties de plante utilisées sont très variables, de la fleur à la racine, après transformation (extractions diverses) ou à l'état brut, fraîches ou desséchées, fermentées, etc.
Peu sont nettement toxiques parmi celles que l'on peut trouver à Villedieu à l'état spontané ou introduites dans le jardin d'agrément : l'if, le muguet, la morelle noire, le laurier rose, l'amande amère, le gui (en particulier celui du peuplier).
Alors, au hasard d'un tour sélectif de jardin et de mémoire, et dans un désordre assumé...
Elytrigia repens (LE CHIENDENT) : diurétique, contre calculs rénaux et biliaires.
Acanthus mollis (L'ACANTHE) : inflammations diverses, dysenteries ; la sève était bue comme stimulant pour les guerriers partant au combat.
Zizyphus jujuba (LE JUJUBE) : contre toux, bronchite, pneumonie, et dans la tradition musulmane, servirait dans les cas de sorcellerie (ou contre les sorciers et les sorcières ?). La tradition chrétienne était, semblait-il, plus expéditive.
Olea europea (L'OLIVIER) : symbole de paix quant à lui, diurétique, hypotenseur, vasodilatateur et antidiabétique ; on utilise d'autre par t l'huile comme excipient dans de nombreux médicaments.
Asparagus officinalis (L'ASPERGE) : diurétique, dépurative, et aphrodisiaque (Pline) ; là, on rejoint la théorie dite des « signatures », une belle asperge pouvant ressembler à..., mais bon, passons.
En application de cette même théorie, les Bambusa (BAMBOUS D'ESPèCES DIVERSES), ressemblant à des empilements de corps ver tébraux, auraient une action bénéfique sur ceux-ci.
Viscum album (LE GUI), parasite notoire, sur les tumeurs (à côté d'autres indications confirmées comme hypotenseur et diurétique), mais n'oublions pas sa toxicité.
Chelidonium majus (LA CHÉLIDOINE), avec son latex jaune-orangé caractéristique, évoquant la bile, semble alors indiquée dans les troubles hépatobiliaires. Les feuilles rouges du Cornus sanguinea (LE CORNOUILLER SANGUIN) seront utilisées en prévention d'infarctus.
Juglans regia (LE NOYER) : le cerneau de sa noix ressemble de toute évidence à un cerveau, donc il en sera un médicament. Les biochimistes y ont trouvé une concentration élevée de sérotonine, qui en fait un neurotransmetteur dans les fonctions cérébrales. Car il est curieux de constater que la recherche médicale (de temps à autre du moins, pas d'affolement !) confirme les indications proposées par la théorie des signatures. D'autre part, le lien embryologique avéré entre peau et cerveau justifie l'utilisation du noyer dans les inflammations de la peau.
Hypericum perforatum (LE MILLEPERTUIS) répond lui aussi à la théorie. Ses feuilles, avec leurs petits trous (les pertuis) font penser à la peau, dont elle soignera brûlures, douleurs et plaies, et sera aussi un antidépresseur, car ce qui soigne la peau est actif sur le cerveau (et inversement).
Ajoutons, pour l’anecdote, du moins en Alsace, que si une femme veut garder son mari (et pourquoi pas d'ailleurs), elle doit mettre une feuille de noyer cueillie la nuit de la Saint-Jean dans son soulier gauche. Mais la source n'est pas très claire : soulier du mari ou de la femme ?
Phytolacca decandra (LE PHYTOLAQUE) : angines, rhumatismes, règles douloureuses, antiscorbutique et vomitif.
Symphoricarpus racemosus (LA SYMPHORINE) : vomissements de la grossesse.
Arbutus unedo (L'ARBOUSIER) : diurétique, remède d'hypertension, de rhumatismes et de diarrhées.
Cupressus sempervirens (LE CYPRèS) : pour la circulation veineuse (vasoconstricteur).
Diospyros kaki (LE PLAQUEMINIER) : dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
Crataegus oxyacantha (L'AUBÉPINE) : anxiété, palpitation, hypertension.
Wisteria sinensis (LA GLYCINE) : rien de notable comme utilisation pharmaceutique... mais son homonyme, qui n'a vraiment rien à voir, la glycine, le plus simple de nos acides aminés, est à ce titre absolument vital pour nos organismes.
Cydonia oblunga (LE COGNASSIER) : contre la pneumonie (du moins en médecine afghane), l'inconfort intestinal (à Malte). Figurant parmi les 14 composés du Diaprun solutif de la Pharmacopée maritime occidentale, il guérit finalement à peu près tout (il faut bien résumer !).
Convallaria maialis (LE MUGUET) : a été utilisé comme tonicardiaque et diurétique. Toxique.
Prunus avium (lE CERISIER) : les queues des fruits sont célèbres comme diurétique et dépuratif, et indiquées dans les coliques néphrétiques.
Trifolium (DIVERS TRèFLES) : troubles de la ménopause, des yeux fatigués, des diarrhées, toux et éruptions cutanées.
Corylus avellana (LE NOISETIER) : riche en oméga 3, antidiarrhéique, antianémique, antistress, vermifuge, et qui nous fournit en prime la fameuse baguette de coudrier utilisée par les sourciers comme par certains guérisseurs !
Laurus nobilis (lE LAURIERSAUCE) : cité pour combattre les crampes abdominales (un peu tard pour celle des lycéens en fin d'études, que l'on honorait d'une couronne de laurier avec des baies, (BACCA LAUREA).
Mespilus germanica (LE NÉFLIER) : diurétique, astringent, tonique.
Calendula arvensis (LE SOUCIS DES CHAMPS) : antiseptique, antispasmodique, anti-inflammatoire.
Petroselinum sativum (LE PERSIL) : diurétique, stimulant, emménagogue (provoque les règles), et à ce titre, connu depuis Hippocrate comme abortif. Il serait utilisé à cette fin en Amérique latine jusqu'à ce jour.
Allium porum (LE POIREAU) : diurétique et riche en fibre.
Arundo donax (lA CANNE DE PROVENCE) : parmi les rares plantes ayant bien peu d'indications thérapeutiques, à moins de parler de musicothérapie, où elle a une place de choix puisque cette canne sert à fabriquer la presque totalité des anches des instruments à vent utilisés dans le monde (clarinettes, hautbois, saxos, etc.).
Pinus silvestris (LE PIN SYLVESTRE) : antiseptique, diurétique, expectorant.
Calamintha officinalis (LE CALAMENT OFFICINAL) : digestif, tonique... et sédatif à la fois. De telles indications contradictoires ne sont pas exceptionnelles.
Malva rotundifolia (LA MAUVE À FEUILLES RONDES) : inflammations diverses, gastriques, oculaires, urinaires.
Spartium junceum (LE GENÊT D'ESPAGNE) : évoqué dans une Gazette récente, avec ses propriétés antitabagiques.
Plantago major et Plantago lanceolata (lES PLANTAINS) : maux de dents, cicatrisant et traitement de l'arbre respiratoire.
Punica granatum (LA GRENADE) : propriétés nombreuses, antidiarrhéiques, antiparasitaires, asthme... et, soit dit en passant, rigoureusement absente des sirops dits de grenadine.
Oxalis acetosella (LA PETITE OSEILLE) : dépurative, utilisée en cuisine, mais assez toxique.
Solanum nigrum (LA MORELLE NOIRE OU TUECHIEN) : antispasmodique, analgésique, mais rapidement toxique, voire mortelle.
Vitis vinifera (LA VIGNE) : bien connue pour ses effets bénéfiques sur la circulation veineuse, hémostatique.
Salvia officinalis (LA SAUGE MÉDICINALE) : antiseptique et fébrifuge ; véritable panacée au Moyen Âge. Son nom vient du latin salvare, sauver, et quiconque a un pied de sauge dans son jardin n'a aucune raison de mourir. Pensez-y !
Nerium oleander (LE LAURIER ROSE) : tonicardiaque, diurétique, antiparasitaire. Toxique par toutes ses parties. Même l'eau stagnant au pied des plants peut être toxique pour les animaux.
Thymus vulgaris (LE THYM) : suivant les variétés, anti-infectieux, antifungique, indiqué dans des dermatoses, antalgique et antiviral.
Taxus baccata (L'IF) : utilisé en cancérologie après extraction d'un principe actif ; indications très différentes en homéopathie (tremblements, convulsions, névralgies). Mais ne pas oublier la très haute toxicité de toutes ses parties (quelques baies sont mor telles). D'ailleurs taxus vient du grec taxon, flèche empoisonnée, d'où vient le mot « toxique ».
Lonicera caprifolium (LE CHèVREFEUILLE) : combat les attachements excessifs au passé !
Viburnum tinus (lE LAURIER-TIN) : semble n'avoir intéressé aucun des divers thérapeutes, des plus classiques aux plus farfelus !
Ranunculus bulbosus (LE BOUTON D'OR) : dans les dermatoses, antalgique (maux de tête surtout), diverses indications ORL.
Rubus fruticosus (lA RONCE) : utilisée... pour un peu tout, et dès la Grèce ancienne (Dioscoride) pour soigner les plaies.
Morus nigra (lE MûRIER) : diurétique et laxatif.
Juniperus oxycedrus (LE GENÉVRIER CADE) : dermatoses (cuir chevelu), lithiases, vermifuge.
Amygdalus communis (L'AMANDIER) : coqueluche, constipation, laxatif, engelures, antiscléreux ; mais il faut faire attention : l'amande amère est toxique, voire mor telle à cer taines doses (acide cyanhydrique). On peut cependant manger sans angoisse la galette des Rois.
Hedera hélix (LE LIERRE GRIMPANT) : purgatif, toux, ulcères variqueux.
Buxus sempervirens (LE BUIS) : sudorifique et fébrifuge, toxique à haute dose.
Tilia europea (LE TILLEUL) : propriétés calmantes bien connues.
Quercus robur (LE CHÊNE ROUVRE) : inflammations ganglionnaires, diarrhées.
Rosmarinus officinalis (LE ROMARIN) : troubles digestifs et hépatiques, maux de tête.
Lavendula vera (LA LAVAN DE) : antalgique, antiseptique, passée en revue dans une Gazette récente.
Taraxacum dens leonis (LE PISSENLIT) : évidemment diurétique.
Foeniculum vulgare (lE FENOUIL) : antispasmodique, flatulences, diurétique, asthme, problèmes gynécologiques.
Sambucus nigra (LE SUREAU NOIR) : s'adresse en priorité à l'arbre respiratoire.
Allons chercher maintenant la petite bête.
Seule l'homéopathie semble faire appel à quelques insectes ici familiers.
Apis mellifica (L'ABEILLE) : a un grand usage homéopathique dans les brûlures, piqûres d'insectes et beaucoup d'autres indications. On utilise, mais après transformation, soit l'abeille entière, soit son venin.
Vespa vulgaris (LA GUÊPE) et Vespa crabro (LE FRELON) : partagent un certain nombre d'indications avec l'abeille.
Coccus cacti (LA COCHENILLE) : est un classique dans le traitement de la coqueluche et autres toux spasmodiques.
Citons encore, quoique passé de mode, Armadillidium vulgare, LE CLOPORTE, seul crustacé terrestre, dont la confiture figurait encore dans la Pharmacopée française jusqu'au Codex de 1905, donc dans la médecine officielle de l'époque. La bestiole était réputée riche en fer, on lui prêtait des ver tus reconstituantes. Je pense que Popeye, non pas le Villadéen bien connu, mais le héros de dessin animé, en aura eu raison, par sa promotion de l'épinard, à la suite, diton, de la faute de frappe d'une secrétaire, qui multiplia par dix sa teneur en fer, alors que celle-ci est très banale.
En revanche, Helix pomatia (L'ESCARGOT DE BOURGOGNE) : fournit le principe actif d'un sirop antitussif très utilisé depuis plusieurs années (l'Hélicidine).
Quitte à froisser des âmes sensibles, citons pour mémoire l'utilisation antirhumatismale avérée mais un peu délaissée de la peau de Felis silvestris catus (LE CHAT DOMESTIQUE). Quant à l'utilisation de ses boyaux pour fabriquer les fils de suture chirurgicaux (les catguts), elle serait seulement une légende due à une erreur de traduction, de même que leur usage pour corder violons et autres instruments (on aurait retrouvé ici la musicothérapie), voire les diverses raquettes (et l’on aurait eu une mention de la médecine du sport !)
Pour conclure, pensons à Trifolium pratense (LE TRÈFLE), déjà cité, mais à quatre feuilles (ce qui est vraiment antinomique) qui aidera toujours les superstitieux, et, si ça tourne vraiment, vraiment mal, au bois de Quercus robur (LE CHÊNE) qui aura toujours son utilité, ultime, et hélas non thérapeutique.
Ces plantes permettraient de soigner de la tête aux pieds, appareil par appareil. Pourtant le chroniqueur ne prétend pas reconnaître, dans son herborisation sommaire, toutes les plantes locales à caractère médicinal, d'autant que la saison actuelle en masque un grand nombre. Pourtant plus de cinquante autres, d'importances diverses, viennent à l'esprit et pourraient prétendre figurer ci-dessous, si l’on voulait être plus exhaustif.
En regard de cette énumération sélective figurent des indications piochées dans la médecine allopathique (classique), l'homéopathie et ses avatars (gemmothérapie, anthroposophie), la phytothérapie, l'aromathérapie, et la médecine dite populaire (que le féminisme ambiant interdit d'appeler désormais remèdes de bonne femme !), voire exotique.
Les parties de plante utilisées sont très variables, de la fleur à la racine, après transformation (extractions diverses) ou à l'état brut, fraîches ou desséchées, fermentées, etc.
Peu sont nettement toxiques parmi celles que l'on peut trouver à Villedieu à l'état spontané ou introduites dans le jardin d'agrément : l'if, le muguet, la morelle noire, le laurier rose, l'amande amère, le gui (en particulier celui du peuplier).
Alors, au hasard d'un tour sélectif de jardin et de mémoire, et dans un désordre assumé...
Elytrigia repens (LE CHIENDENT) : diurétique, contre calculs rénaux et biliaires.
Acanthus mollis (L'ACANTHE) : inflammations diverses, dysenteries ; la sève était bue comme stimulant pour les guerriers partant au combat.
Zizyphus jujuba (LE JUJUBE) : contre toux, bronchite, pneumonie, et dans la tradition musulmane, servirait dans les cas de sorcellerie (ou contre les sorciers et les sorcières ?). La tradition chrétienne était, semblait-il, plus expéditive.
Olea europea (L'OLIVIER) : symbole de paix quant à lui, diurétique, hypotenseur, vasodilatateur et antidiabétique ; on utilise d'autre par t l'huile comme excipient dans de nombreux médicaments.
Asparagus officinalis (L'ASPERGE) : diurétique, dépurative, et aphrodisiaque (Pline) ; là, on rejoint la théorie dite des « signatures », une belle asperge pouvant ressembler à..., mais bon, passons.
En application de cette même théorie, les Bambusa (BAMBOUS D'ESPèCES DIVERSES), ressemblant à des empilements de corps ver tébraux, auraient une action bénéfique sur ceux-ci.
Viscum album (LE GUI), parasite notoire, sur les tumeurs (à côté d'autres indications confirmées comme hypotenseur et diurétique), mais n'oublions pas sa toxicité.
Chelidonium majus (LA CHÉLIDOINE), avec son latex jaune-orangé caractéristique, évoquant la bile, semble alors indiquée dans les troubles hépatobiliaires. Les feuilles rouges du Cornus sanguinea (LE CORNOUILLER SANGUIN) seront utilisées en prévention d'infarctus.
Juglans regia (LE NOYER) : le cerneau de sa noix ressemble de toute évidence à un cerveau, donc il en sera un médicament. Les biochimistes y ont trouvé une concentration élevée de sérotonine, qui en fait un neurotransmetteur dans les fonctions cérébrales. Car il est curieux de constater que la recherche médicale (de temps à autre du moins, pas d'affolement !) confirme les indications proposées par la théorie des signatures. D'autre part, le lien embryologique avéré entre peau et cerveau justifie l'utilisation du noyer dans les inflammations de la peau.
Hypericum perforatum (LE MILLEPERTUIS) répond lui aussi à la théorie. Ses feuilles, avec leurs petits trous (les pertuis) font penser à la peau, dont elle soignera brûlures, douleurs et plaies, et sera aussi un antidépresseur, car ce qui soigne la peau est actif sur le cerveau (et inversement).
Ajoutons, pour l’anecdote, du moins en Alsace, que si une femme veut garder son mari (et pourquoi pas d'ailleurs), elle doit mettre une feuille de noyer cueillie la nuit de la Saint-Jean dans son soulier gauche. Mais la source n'est pas très claire : soulier du mari ou de la femme ?
Phytolacca decandra (LE PHYTOLAQUE) : angines, rhumatismes, règles douloureuses, antiscorbutique et vomitif.
Symphoricarpus racemosus (LA SYMPHORINE) : vomissements de la grossesse.
Arbutus unedo (L'ARBOUSIER) : diurétique, remède d'hypertension, de rhumatismes et de diarrhées.
Cupressus sempervirens (LE CYPRèS) : pour la circulation veineuse (vasoconstricteur).
Diospyros kaki (LE PLAQUEMINIER) : dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
Crataegus oxyacantha (L'AUBÉPINE) : anxiété, palpitation, hypertension.
Wisteria sinensis (LA GLYCINE) : rien de notable comme utilisation pharmaceutique... mais son homonyme, qui n'a vraiment rien à voir, la glycine, le plus simple de nos acides aminés, est à ce titre absolument vital pour nos organismes.
Cydonia oblunga (LE COGNASSIER) : contre la pneumonie (du moins en médecine afghane), l'inconfort intestinal (à Malte). Figurant parmi les 14 composés du Diaprun solutif de la Pharmacopée maritime occidentale, il guérit finalement à peu près tout (il faut bien résumer !).
Convallaria maialis (LE MUGUET) : a été utilisé comme tonicardiaque et diurétique. Toxique.
Prunus avium (lE CERISIER) : les queues des fruits sont célèbres comme diurétique et dépuratif, et indiquées dans les coliques néphrétiques.
Trifolium (DIVERS TRèFLES) : troubles de la ménopause, des yeux fatigués, des diarrhées, toux et éruptions cutanées.
Corylus avellana (LE NOISETIER) : riche en oméga 3, antidiarrhéique, antianémique, antistress, vermifuge, et qui nous fournit en prime la fameuse baguette de coudrier utilisée par les sourciers comme par certains guérisseurs !
Laurus nobilis (lE LAURIERSAUCE) : cité pour combattre les crampes abdominales (un peu tard pour celle des lycéens en fin d'études, que l'on honorait d'une couronne de laurier avec des baies, (BACCA LAUREA).
Mespilus germanica (LE NÉFLIER) : diurétique, astringent, tonique.
Calendula arvensis (LE SOUCIS DES CHAMPS) : antiseptique, antispasmodique, anti-inflammatoire.
Petroselinum sativum (LE PERSIL) : diurétique, stimulant, emménagogue (provoque les règles), et à ce titre, connu depuis Hippocrate comme abortif. Il serait utilisé à cette fin en Amérique latine jusqu'à ce jour.
Allium porum (LE POIREAU) : diurétique et riche en fibre.
Arundo donax (lA CANNE DE PROVENCE) : parmi les rares plantes ayant bien peu d'indications thérapeutiques, à moins de parler de musicothérapie, où elle a une place de choix puisque cette canne sert à fabriquer la presque totalité des anches des instruments à vent utilisés dans le monde (clarinettes, hautbois, saxos, etc.).
Pinus silvestris (LE PIN SYLVESTRE) : antiseptique, diurétique, expectorant.
Calamintha officinalis (LE CALAMENT OFFICINAL) : digestif, tonique... et sédatif à la fois. De telles indications contradictoires ne sont pas exceptionnelles.
Malva rotundifolia (LA MAUVE À FEUILLES RONDES) : inflammations diverses, gastriques, oculaires, urinaires.
Spartium junceum (LE GENÊT D'ESPAGNE) : évoqué dans une Gazette récente, avec ses propriétés antitabagiques.
Plantago major et Plantago lanceolata (lES PLANTAINS) : maux de dents, cicatrisant et traitement de l'arbre respiratoire.
Punica granatum (LA GRENADE) : propriétés nombreuses, antidiarrhéiques, antiparasitaires, asthme... et, soit dit en passant, rigoureusement absente des sirops dits de grenadine.
Oxalis acetosella (LA PETITE OSEILLE) : dépurative, utilisée en cuisine, mais assez toxique.
Solanum nigrum (LA MORELLE NOIRE OU TUECHIEN) : antispasmodique, analgésique, mais rapidement toxique, voire mortelle.
Vitis vinifera (LA VIGNE) : bien connue pour ses effets bénéfiques sur la circulation veineuse, hémostatique.
Salvia officinalis (LA SAUGE MÉDICINALE) : antiseptique et fébrifuge ; véritable panacée au Moyen Âge. Son nom vient du latin salvare, sauver, et quiconque a un pied de sauge dans son jardin n'a aucune raison de mourir. Pensez-y !
Nerium oleander (LE LAURIER ROSE) : tonicardiaque, diurétique, antiparasitaire. Toxique par toutes ses parties. Même l'eau stagnant au pied des plants peut être toxique pour les animaux.
Thymus vulgaris (LE THYM) : suivant les variétés, anti-infectieux, antifungique, indiqué dans des dermatoses, antalgique et antiviral.
Taxus baccata (L'IF) : utilisé en cancérologie après extraction d'un principe actif ; indications très différentes en homéopathie (tremblements, convulsions, névralgies). Mais ne pas oublier la très haute toxicité de toutes ses parties (quelques baies sont mor telles). D'ailleurs taxus vient du grec taxon, flèche empoisonnée, d'où vient le mot « toxique ».
Lonicera caprifolium (LE CHèVREFEUILLE) : combat les attachements excessifs au passé !
Viburnum tinus (lE LAURIER-TIN) : semble n'avoir intéressé aucun des divers thérapeutes, des plus classiques aux plus farfelus !
Ranunculus bulbosus (LE BOUTON D'OR) : dans les dermatoses, antalgique (maux de tête surtout), diverses indications ORL.
Rubus fruticosus (lA RONCE) : utilisée... pour un peu tout, et dès la Grèce ancienne (Dioscoride) pour soigner les plaies.
Morus nigra (lE MûRIER) : diurétique et laxatif.
Juniperus oxycedrus (LE GENÉVRIER CADE) : dermatoses (cuir chevelu), lithiases, vermifuge.
Amygdalus communis (L'AMANDIER) : coqueluche, constipation, laxatif, engelures, antiscléreux ; mais il faut faire attention : l'amande amère est toxique, voire mor telle à cer taines doses (acide cyanhydrique). On peut cependant manger sans angoisse la galette des Rois.
Hedera hélix (LE LIERRE GRIMPANT) : purgatif, toux, ulcères variqueux.
Buxus sempervirens (LE BUIS) : sudorifique et fébrifuge, toxique à haute dose.
Tilia europea (LE TILLEUL) : propriétés calmantes bien connues.
Quercus robur (LE CHÊNE ROUVRE) : inflammations ganglionnaires, diarrhées.
Rosmarinus officinalis (LE ROMARIN) : troubles digestifs et hépatiques, maux de tête.
Lavendula vera (LA LAVAN DE) : antalgique, antiseptique, passée en revue dans une Gazette récente.
Taraxacum dens leonis (LE PISSENLIT) : évidemment diurétique.
Foeniculum vulgare (lE FENOUIL) : antispasmodique, flatulences, diurétique, asthme, problèmes gynécologiques.
Sambucus nigra (LE SUREAU NOIR) : s'adresse en priorité à l'arbre respiratoire.
Allons chercher maintenant la petite bête.
Seule l'homéopathie semble faire appel à quelques insectes ici familiers.
Apis mellifica (L'ABEILLE) : a un grand usage homéopathique dans les brûlures, piqûres d'insectes et beaucoup d'autres indications. On utilise, mais après transformation, soit l'abeille entière, soit son venin.
Vespa vulgaris (LA GUÊPE) et Vespa crabro (LE FRELON) : partagent un certain nombre d'indications avec l'abeille.
Coccus cacti (LA COCHENILLE) : est un classique dans le traitement de la coqueluche et autres toux spasmodiques.
Citons encore, quoique passé de mode, Armadillidium vulgare, LE CLOPORTE, seul crustacé terrestre, dont la confiture figurait encore dans la Pharmacopée française jusqu'au Codex de 1905, donc dans la médecine officielle de l'époque. La bestiole était réputée riche en fer, on lui prêtait des ver tus reconstituantes. Je pense que Popeye, non pas le Villadéen bien connu, mais le héros de dessin animé, en aura eu raison, par sa promotion de l'épinard, à la suite, diton, de la faute de frappe d'une secrétaire, qui multiplia par dix sa teneur en fer, alors que celle-ci est très banale.
En revanche, Helix pomatia (L'ESCARGOT DE BOURGOGNE) : fournit le principe actif d'un sirop antitussif très utilisé depuis plusieurs années (l'Hélicidine).
Quitte à froisser des âmes sensibles, citons pour mémoire l'utilisation antirhumatismale avérée mais un peu délaissée de la peau de Felis silvestris catus (LE CHAT DOMESTIQUE). Quant à l'utilisation de ses boyaux pour fabriquer les fils de suture chirurgicaux (les catguts), elle serait seulement une légende due à une erreur de traduction, de même que leur usage pour corder violons et autres instruments (on aurait retrouvé ici la musicothérapie), voire les diverses raquettes (et l’on aurait eu une mention de la médecine du sport !)
Pour conclure, pensons à Trifolium pratense (LE TRÈFLE), déjà cité, mais à quatre feuilles (ce qui est vraiment antinomique) qui aidera toujours les superstitieux, et, si ça tourne vraiment, vraiment mal, au bois de Quercus robur (LE CHÊNE) qui aura toujours son utilité, ultime, et hélas non thérapeutique.
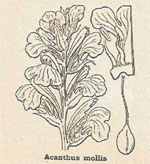
Cliquez sur la photo
pour l'agrandir
et en voir plus
